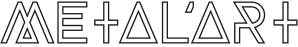Steve Haggis
15-16.10.21 - Omega Sound Festival
Heureux qui, après des mois confinés et sevrés de concerts, prennent la route cap vers l’ouest jusqu’au confluent de la Maine et de la Loire ! Mais du balai Du Bellay, point de douceur angevine ici, car ce beau week-end d’octobre accueille une horde d’énervés qui ont dû lire en anglais le nom de la ville voisine : ANGERS, « haines » dans la langue de Shakespeare.
L’OMEGA SOUND festival est une nouvelle création, dont la première édition devait avoir lieu en novembre 2020, mais a été annulée pour les raisons qu’on sait et qu’on en a marre. Organisé par les associations AMC prod et CROM (pour « Chevelus Rassemblés pour Orgie Métallique » !) à l’Espace Jean Carmet de la petite ville de Mûrs-Erigné, il prend la suite du MEGASOUND festival qui avait réuni en 2009 la crème de la scène française : Bukowski, les Ramoneurs de menhirs, Dagoba, Tagada Jones, No one is innocent, Ultra vomit entre autres.
CROM avait déjà organisé auparavant des concerts metal à Angers, puis les tremplins « Angers likes Metal » qui permettent aux groupes locaux de se produire sur scène et dont les finalistes jouent au festival d’ailleurs.
Cette affiche 2021 est finalement assez différente de celle annoncée pour 2020 : demeurent Black Bomb A, Sidilarsen, Smash Hit Combo, ainsi que les régionaux Arcania, Grand Master Krang et Nervous decay, mais pas de Benighted, Sales Majestés, Lofofora et Fatals Picards. A la place, on a droit à The Great Old Ones, Blackrain, Betraying the martyrs, Tagada Jones et les grecs de Rotting Christ, seul groupe non français à l’affiche.
Les deux assos ont fait les choses très bien pour pérenniser le festival, avec un logo et des visuels soignés, ainsi qu’une exposition dans la médiathèque voisine de la salle. Cet événement, intitulé « Contraste – Plongeons dans les arts sombres », met en lumière six artistes peintres, illustrateurs, plasticiens ou photographes affiliés à la scène metal. Superbe initiative qui prolonge l’expérience du festival pendant trois semaines, les six artistes étant présents le samedi pour des dédicaces et échanges.
Au niveau des installations, l’Espace Jean Carmet est une salle de taille moyenne, que les organisateurs ont eu la bonne idée de prolonger avec un espace extérieur dans lequel on trouve un bar supplémentaire et des stands de restauration ainsi que des tables. Une impression d’open air en automne !
Les groupes se succèdent sur la scène avec une vingtaine de minutes entre chaque groupe, devant un public démasqué qui (moyennant un Pass sanitaire valide) retrouve le temps de quelques heures le monde d’avant, celui de la fraternité metal vécue sans distanciation sociale.
VENDREDI 15 OCTOBRE
SIDILARSEN (21 h 30 – 22 h 30)
On a raté les deux premiers concerts, ceux de Grand Master Krang (thrash crossover d’Angers) et Smash Hit Combo (rap metal alsacien), mais le public répond présent pour Sidilarsen, groupe toulousain de metal indus engagé dont les dernières sorties ont marqué les esprits. Un set très énergique appuyé sur deux écrans en fond de scène qui diffusent des images et des textes raccord avec la musique à la fois brutale et dansante du combo. Les deux vocalistes se donnent la réplique et mènent la troupe. On retient de cette heure de concert l’enthousiasme des musiciens, heureux de retrouver la scène : leur classique « Comme on vibre » met le public en transe avec un son proche des premiers Mass Hysteria, tandis que l’hymne final « Des milliards » est repris par la foule et poursuivi après la fin du morceau. Sur cette chanson d’ailleurs, le chanteur Didou fait s’asseoir le public qui s’exécute rapidement, avant de sauter comme un seul homme. Gimmick maintenant peu original mais qui fait toujours son petit effet ! En somme, une prestation remarquable servie par un très bon son.
BLACK BOMB A (22 h 55 – 23 h 55)
Changement de registre avec Black Bomb A, qui balance son hardcore / groove metal et laisse peu de répit au public. La frappe du batteur Hervé Coquerel (également membre des parrains du death français Loudblast) propulse la décharge de violence, avec le duel des deux chanteurs Arno (voix gutturale) et Poun (voix criée aiguë). Le premier arrive sur la scène avant les autres et blague avec le public, alors que le second commence le concert encagoulé et dévoile son sourire béat constant dès le deuxième morceau. Amusant d’ailleurs de voir le contraste entre les deux hurleurs à la banane et les deux gratteux qui tirent une tronche badass pas commode à la Kerry King. L’énergie impressionnante déployée par les cinq types sauteurs donne une irrésistible envie de bouger, même si la mélodie est plutôt absente du tableau : dans le public, ça headbangue, ça saute, ça chante (sur « Mary », leur hymne à eux), ça slamme, et ça finit même en wall of death ! On partage sa sueur, et diable que ça fait du bien ! Quand le son s’éteint et que le public se dirige les yeux hagards vers les bars, on entend ce commentaire éclairé : « ça commence à sentir le fennec ! ». Bien analysé, camarade, et sacré défouloir.
TAGADA JONES (0 h 20 – 1 h 30)
Les Rennais sont en tête d’affiche du jour, et ont soigné leur décor de scène : des barils enflammés reprenant les lettres du nom du groupe « TGD JNS » sont positionnés devant un grand backdrop avec le logo de la bande. Les punks font une entrée fracassante sur la scène en jouant le premier morceau éponyme de leur dernier album en date, « A feu et à sang », dont la sortie remonte à octobre 2020. La setlist fait d’ailleurs la part belle à cette dernière livraison avec pas moins de six morceaux, soit presque la moitié des titres interprétés ce soir. Voilà une constante chez Tagada, qui met toujours très en avant son dernier opus, quitte à laisser perplexe une partie du public peu familière avec la nouveauté (on entend d’ailleurs un voisin de foule s’écrier : « Ah ça c’est du vrai Tagada » quand résonnent les premières secondes de « Cargo », presque le seul titre pré-2014). Il faut toutefois reconnaître que les torpilles de la cuvée 2020 sont excellentes et très variées, du punk à roulettes « Elle ne voulait pas » à l’indus heavy « Le dernier baril » en passant par le mélodique et émouvant « de rires et de larmes ». On retiendra aussi de ce show le ministryen « La peste et le choléra », la reprise de Parabellum « Cayenne » en hommage aux membres de ce groupe partis trop tôt, et le punk revendicateur et nostalgique « Mort aux cons », hymne final qui referme un gig hyper énergique mais desservi par un son trop fort et sale. Quel dommage de ne pas entendre les chœurs de Stef et Waner qui s’époumonent pour soutenir le chant de Niko, leader évident ! Au final, c’est donc sur une impression mitigée que s’achève cette première soirée de festival, Tagada Jones ayant produit une setlist courageuse mais laissant une partie du public sur la touche, d’autant que le son ne permettait pas d’apprécier à leur juste valeur des morceaux inconnus. La folie à laquelle on s’attendait a pété sur Black Bomb A, mais a attendu les deux derniers morceaux de Tagada Jones pour éclater réellement. Pas grave, les quatre coreux se montrent chaleureux au moment de quitter la scène, le batteur Job restant même faire des blagues pour ponctuer le discours de Camilo, représentant de CROM qui vient remercier le public et promettre une nouvelle édition en 2022. Tant mieux, mais il reste une journée en 2021, à demain !
SAMEDI 16 OCTOBRE
ARCANIA (19 h 10 – 19 h 45)
En ce deuxième jour de festival, nous ratons le premier groupe Nervous Decay, death metalleux de Nantes, pour cause d’interviews (présentes en ces pages), et la soirée commence avec les angevins d’Arcania. Le quatuor local propose un thrash d’école mélodique et technique, pouvant rappeler les travaux de Testament. Les morceaux speed succèdent aux titres mid-tempo, avec quelques incursions plus atmosphériques voire post. Le chanteur Cyril Peglion (sosie de Pepper Keenan de COC, si si !) montre une certaine classe (même face aux traditionnels « À poil ! » du public un brin taquin) et un chant assuré dans un registre mélodique autant que rageur, tandis que le guitariste Niko Beleg impressionne par ses soli fluides et inventifs. Les deux derniers morceaux joués méritent les éloges : le premier, forcément récent, est introduit par un discours de confinement du président Macron et un détournement de la Marseillaise, et le second « No end » est très prenant et varié avec ses accélérations black. Le combo est soutenu par ses amis venus en nombre, qui lancent même un circle pit, léger mais énergique. Solide et convaincant.
BLACKRAIN (20 h 00 – 21 h 00)
En cette journée typée metal extrême, les savoyards de Blackrain paraissent un peu en décalage avec leur hard rock mélodique (on pourrait aussi dire sleaze ou FM) et leur look plus exubérant que leurs camarades de jeu. Mais le groupe sait y faire pour fédérer et faire bouger un public qui ne le connaît pas forcément : chaque morceau est un tube potentiel, et que ça fait gueuler chaque côté de la salle pour voir qui hurle le plus fort, et que ça sollicite des « hey hey hey » (sur leur classique « Rock your city »), et que ça sourit en continu, et que ça communique avec les membres de l’assistance. Le groupe met en avant son dernier album en date, « Dying breed » (2019), mais aussi des titres issus de toute sa carrière de 20 ans. On peut d’ailleurs constater l’évolution du look des quatre musiciens, bien moins sophistiqué qu’il y a une dizaine d’années, plus dans le trip biker dorénavant que hair metal androgyne. Autrefois très influencés par Mötley Crüe, comme l’atteste la voix à la Vince Neil du chanteur / leader Swan, les morceaux ont pour dénominateur commun d’envoyer un bon hard rock n’ roll groovy et facile à chanter, comme l’ACDCien « Blast me up », le speed « Overloaded » ou le radiophonique « Rock my funeral ». Les soli du guitariste Max sont gorgés de feeling, et il se montre comme ses compères très mobiles, donnant à cette heure de concert des airs de fête. Blackrain parvient à faire chanter toute la salle avec sa reprise très efficace du « We’re not gonna take it » de Twisted Sister, entonnée par le bassiste Matt. Première grosse claque du jour, merci messieurs !
BETRAYING THE MARTYRS (21 h 20 – 22 h 20)
Changement de registre avec les parisiens de Betraying The Martyrs, qui vivent ce soir un moment important de leur histoire. Le groupe, qui avait déjà accusé le coup en perdant tout son matos dans un incendie lors d’une tournée californienne en juillet 2019, puis avait subi (comme tout le monde) le confinement de 2020 après la tournée en support à « Rapture » (2019), a encaissé le départ de son chanteur emblématique Aaron Matts, annoncé début 2021. Cette date unique de l’année est donc l’occasion de présenter leur nouveau chanteur, Rui Martins, dont le nom n’a été dévoilé que deux jours avant le show, en même temps que la vidéo du nouveau titre « Black hole ». Nous vous invitons à lire l’interview en ces pages pour en savoir plus sur la période de préparation de ce grand retour… Car grand retour il y a ! Dès le début du concert, la folie est présente autant sur scène que dans la fosse : le metalcore du combo évite les écueils inhérents à ce genre, et joue la carte de l’énergie et de l’intensité. Le nouveau frontman est tout de suite adopté, montrant qu’il peut tenir la scène et growler comme son prédécesseur, et il aspire tous les regards, autant que Victor Guillet qui se charge des parties de chant mélodiques et headbangue derrière ses claviers, quand il ne saute pas comme un damné avec son instrument en bandoulière. C’est lui qui s’adresse au public pour dire l’importance de cette soirée pour le groupe, Rui ne parlant pas français (ce dernier glisse d’ailleurs à l’assistance que, si les autres membres disent du mal de lui, il faut le prévenir !). C’est lui aussi qui, sourire débordant de sincérité accroché au visage, se jette dans la foule à plusieurs reprises. Et dans la foule, impossible de résister à la puissance du metal technique mais très accrocheur de la bande : les furieux sont de sortie et ça se lâche à fond, avec des circle pits, des walls of death, des pogos. Le public saute et headbangue comme un seul homme. Quelques titres de morceaux ressortent du lot, comme le génial « Lost for words », « Parasite », « Imagine » (joué pour la toute première fois) et le susnommé et bien né « Black Hole », mais qu’importent les chansons, la musique de BTM est homogène et s’avère une véritable démonstration de maîtrise et de puissance… qui se termine par un bizutage en règle du petit nouveau avec une bouteille de Jägermeister apportée sur scène par le manager du groupe. Bienvenue, Rui !
ROTTING CHRIST (22 h 45 – 0 h 00)
Après ces deux gros cartons, pas facile de se mettre dans l’ambiance pour la fin de la soirée sous le signe d’un black metal plus contemplatif et mid tempo. Bon, Rotting Christ, c’est quand même le seul groupe international à l’affiche, et un groupe qui assume une carrière de trente ans et une place honorable dans l’histoire de la deuxième génération du black. Les Grecs bénéficient de lumières soignées, dans les tons bleus, et la pénombre sur scène ne laisse entrevoir que rarement leur superbe backdrop représentant la pochette de leur dernier rejeton,«The Heretics»(2019). Le leader Sakis Tolis (au chant et à la guitare) et son frangin Themis (à la batterie) mènent la barque de Charon, installant une ambiance grandiloquente et occulte, avec des références claires à l’illustre histoire de leur pays d’origine. Le propos est généralement plutôt lent, même si quelques accélérations et blast-beats surgissent parfois entre les incantations spartiates à trois voix. A droite et à gauche de la scène, George Emmanuel et Vangelis Karzis restent statiques mais font tournoyer leur longue chevelure, ce qui constituera la principale attraction visuelle de cette cérémonie païenne. Côté setlist, le groupe pioche dans toute sa longue carrière, mettant l’accent sur ses dernières productions… mais pas de nouveauté, un futur album n’étant pas prévu pour l’instant. Le public est tout acquis à la cause des Hellènes, et réclame un rappel après leur sortie de scène… qu’il n’obtiendra pas.
THE GREAT OLD ONES (0 h 35 – 1 h 35)
A cette heure avancée de la nuit, les rangs se clairsèment face à la scène, mais les courageux encore présents vont pouvoir prolonger l’expérience mystique Black Metal avec un fier représentant du genre français, The Great Old Ones. Ce groupe bordelais existant depuis une dizaine d’années tire son nom, son concept visuel et ses textes de l’univers de l’écrivain américain H. P. Lovecraft. Tout est fait pour installer une ambiance hostile et malsaine dans l’Espace Jean Carmet : backdrops représentant des créatures lovecraftiennes, pieds de micros métalliques illustrant une tête de pieuvre nommée Cthulhu, costumes (chaque musicien porte une robe de bure avec large capuche) qui maintiennent l’anonymat, aucune communication avec le public à l’exception de discrets « horns » entre les morceaux. La musique du collectif est hypnotique, avec de longs passages post metal, mais aussi des déflagrations black brumeuses d’obédience norvégienne. Alors que nos forces nous abandonnent, on peut ressentir face à ces Grands Anciens cette sidération que Gojira inspire aussi sur scène, dans un autre registre : un monstre effroyable se meut devant nous, créature sonique autant que physique, et nous ne pouvons que rester médusés. Une expérience saisissante, qui vient achever un jour 2 éclectique, et un festival qui a tenu toutes ses promesses. Longue vie à L'Oméga Sound !
Merci à Alexandre Saba, Camilo et toute l’équipe du festival.
LACUNA COIL - "Live from the Apocalypse"
Voilà un produit original et parfait témoin de l’époque formidable dans laquelle nous vivons : après les albums live parus en 2020 et début 2021 pour rappeler à notre bon souvenir la fureur et la sueur des concerts en présentiel (un mot qu’on aurait bien aimé ne jamais employer quotidiennement), ceux-ci paraissent maintenant pour des disques témoignant de concerts donnés sans public et diffusés en streaming. Ce « Live from the Apocalypse » des italiens de Lacuna Coil appartient à cette catégorie. Sa tracklist est constituée de l’intégralité du dernier album « Black anima » (paru en octobre 2019), ainsi que de ses morceaux bonus car il était censé, à sa diffusion le 11 septembre 2020, promouvoir le dernier rejeton de la formation metal moderne. Très bon album, mais une question se pose tout de même : quel est l’intérêt de publier la version audio de ce concert puisqu’il contient tout un album studio fatalement reproduit à l’identique puisque tout récent ? L’ordre des titres a beau être différent, la valeur ajoutée reste limitée. La pochette ne trompe d’ailleurs pas son monde, car elle reproduit le même visuel que celui de leur dernier opus. Comme sur l’œuvre susdite, on retiendra l’intro dramatique « Anima nera » enchaînée avec l’hymne « Sword of anger », les chœurs opératiques de « Veneficium », la puissance sauvage de « Now or never », le groove néo-metal du single « Reckless », les soli inspirés du guitariste Diego Cavallotti et bien-sûr les échanges « Belle et la Bête » des vocalistes Cristina Scabbia et Andrea Ferro.
Les titres bonus s’incluent parfaitement dans l’ensemble, à l’image du lent et intense « Through the flames ». Au final, l’interprétation pêchue des cinq protagonistes (assistés par des bandes qui prennent beaucoup de place) met en exergue les qualités indéniables de leur dernière livraison, mais reste réservée aux fans jusqu’au-boutistes qui voudraient garder un souvenir du « concert » auquel ils ont « assisté » à distance … ou à ceux qui ne posséderaient pas encore « Black anima ».
DEVIN TOWNSEND - "Devolution Series 2 – Galactic Quarantine"
Voici le deuxième volet des Devolution series, et il prend le contre-pied du précédent parce qu’après le live acoustique, on est dans le metal dur, avec des emprunts nombreux à Strapping Young Lad et Ziltoid, soit la frange la plus heavy et agressive de l’œuvre du divin canadien. Le concept est original : ce faux live publié en stream le 5 septembre 2020 a été enregistré avec des musiciens sortis du chapeau (Wes Hauch à la guitare, Liam Wilson de feu-Dillinger Escape Plan à la basse et Samus Paulicelli à la batterie), et avec une setlist choisie par les fans qui pouvaient voter avant les concerts des festivals européens de Bloodstock, Tuska et Hellfest. Cette tournée « By request » était censée être la deuxième partie du Empath tour, se plongeant dans le passé après la redéfinition musicale documentée sur le live « Order of Magnitude - Empath live vol.1 ». Ce disque sert donc à faire patienter avant que ces concerts aient réellement lieu en 2022, et on y trouve avec plaisir une moitié de morceaux de Strapping Young Lad plus joués depuis quinze ans, mêlés à du récent. L’ensemble des titres est parfaitement mis en son et interprété par les quatre musiciens, avec une performance vocale saisissante de Mr. Townsend. Ce qui ressort de cet échantillon de quinze chansons, c’est le côté planant jusqu’à la transe, autant que pesant et ultra heavy, ainsi que le caractère emphatique des lignes de chant, épiques et fortes (Epicloud !). Le disque parvient à rendre homogène cette sélection piochée dans 25 ans de carrière, de la furieuse entrée « All hail the hew flesh » à la grandiloquence de « Supercrush ! » et « Stormbending », en passant par le foutraque « By your command », le frénétique « Detox » et le rayonnant « Spirits will collide ». Hurlements et blast-beats sont au programme, mais la froideur de SYL a disparu, et toute cette heure et quelques de musique dégage une émotion toujours palpable. La quarantaine subie a permis de faire émerger cet inattendu best of metal de Devin Townsend, dont les morceaux intenses n’avaient jamais aussi bien sonné.
PHILM - "Time burner"
Philm est un trio de Los Angeles qui s’est fait connaître comme le refuge de Dave Lombardo hors Slayer, pratiquant un rock énervé (très) expérimental. « Time burner » a été long à venir, car le batteur star a acté la fin du groupe sans demander leur avis aux autres. Ils n’étaient pas d’accord, et voilà donc la troisième offrande du combo, rejoint par le frappeur expérimenté Anderson Quintero. On retrouve l’exploration tous azimuts et le laboratoire d’idées des œuvres précédentes, poussés encore plus loin : le disque navigue entre rock nerveux aux ambiances horrifiques qui peut faire penser ponctuellement à Blue Öyster Cult (belle référence), doom sabbathien, funk metal, ballade psyché recueillie et surtout impros jazz piano / basse / batterie instrumentales qui deviennent la norme dans la deuxième moitié de l’album. Et c’est là que le bât blesse : l’énergie disparaît pour laisser place à une musique plus cérébrale, plus sage aussi. Au final, l’album est bancal : le groupe ne fusionne pas les genres variés qu’il aborde, mais semble faire l’exposé de ses capacités sans affirmer de réelle identité propre. Et puis, Gerry Nestler est un pianiste inventif, un guitariste explosif, mais un chanteur rébarbatif. Il semble que M. Lombardo n’ait finalement pas été étranger à la réussite des épisodes précédents ! Une curiosité sympathique, à défaut d’être le retour gagnant de l’année.
MOS GENERATOR - "The lantern"
Pas facile de se repérer dans la très longue discographie de Tony Reed et de sa bande fondée il y a vingt ans dans l’état de Washington : entre splits (disques partagés avec un autre groupe), EPs, live, albums disponibles uniquement au format vinyle, il faut s’accrocher pour suivre l’évolution de la masse musicale générée par le groupe de heavy rock américain. Cette fois, nous avons droit à un EP de cinq morceaux qui est en fait la réédition (avec nouveau titre, nouvelle pochette et nouveau mix) d’un confidentiel maxi paru en 2007. Le patron Reed étant fier de son œuvre méconnue (et épuisée depuis longtemps), la dépoussière et la remet donc sur le marché. Et il a bien raison : il n’y a là que du très bon, groovy en diable, grungy (Soundgarden n’est pas loin), avec une forme libre et surprenante. En vingt-deux minutes, « The lantern » ne souffre d’aucune baisse de régime : le lent et plein de feeling « Dyin’ blues » laisse place à la ballade électrique habitée « In the upper room », avant l’hendrixien « The lantern », puis le swing rock aux multiples solos de guitare « Nightwolf » et la conclusion doom lumineuse (sic) « O’Cataa ». Voilà une parcelle infime de l’œuvre de Mos Generator ; elle peut sembler insignifiante, mais elle laisse entrevoir le génie de ce groupe, et contribuera peut-être à le mettre en lumière… comme une lanterne dans la nuit.
FATES WARNING - "Long day good night"
Les pionniers du metal progressif américain (à classer dans votre discothèque entre Queensrÿche et Dream Theater) qui s’apprêtent à célébrer leurs 40 ans d’activité publient leur treizième œuvre, « Long day good night ». Comme son titre l’indique, c’est à un voyage au long cours que l’auditeur est convié, et ce périple traverse des contrées très variées, parfois pop, parfois jazzy, parfois heavy, souvent surprenantes, mais presque toujours mid-tempo. Les dénominateurs communs de l’ensemble sont la section rythmique dynamique et groovy que forment Joey Vera et Bobby Jarzombek, ainsi que le refus des compositeurs Jim Matheos (guitariste subtil et versatile) et Ray Alder (chanteur doué, mais aux mélodies vocales pas toujours marquantes) de se complaire dans la facilité. La musique du quintet est très cérébrale, avec moult breaks élégants et effets sonores savoureux, différentes humeurs aussi (du tendu « The destination onward » au cotonneux « When snow falls », en passant par le mélancolique « Under the sun ») ; même si l’ensemble est fort bien tourné, les refrains peinent à faire mouche, et l’émotion ne grimpe jamais vraiment. Voilà ce qu’on pourrait reprocher à ce disque long de 73 minutes, dont la complexité peut parfois faire penser aux derniers Tool : son écoute peut s’avérer fastidieuse, et on est soulagé quand « The last song » arrive, marquant la fin du voyage. Allez, bonne nuit !
VOIVOD - "Lost Machine – live"
Les albums live qui paraissent par pelletées ces derniers temps témoignent bien du vide laissé par l’absence totale de concerts depuis bientôt un an. Quel plaisir (et quelle nostalgie !) de se replonger dans l’ambiance électrique et torride d’une salle obscure secouée par les assauts sonores amplifiés et les hurlements de la foule ! Ce nouvel album en public des vétérans canadiens de Voivod ne fait pas exception, et il nous propulse au cœur du show donné par le groupe à domicile, au Festival d’été de Québec en juillet 2019. Les morceaux sont introduits par le chanteur Snake en français, avec un délicieux accent musical, et dressent un panorama forcément incomplet de la carrière de ce groupe hors-norme. Voivod œuvre dans un thrash metal avec des relents punk, et surtout progressifs comme l’atteste la majorité de la setlist du soir. La moitié de celle-ci est constituée de titres extraits des récents « Post society » (EP, 2016) et « The Wake » (2018), les deux seuls enregistrés avec le line-up actuel ; l’autre moitié pioche dans les sept premiers albums du combo publiés entre 1984 et 1993. De cette succession de déflagrations speed et complexes se dégage une atmosphère postapocalyptique, sombre et dissonante. L’ensemble est très compact et homogène, mais on retiendra le plus rock et dansant « The prow », la reprise spatiale de Pink Floyd « Astronomy domine » et l’hymne punk final « Voivod » (dédié au guitariste Piggy, fondateur du groupe décédé en 2005). La qualité du son permet de bien saisir toutes les nuances dans le jeu des trois musiciens virtuoses (mention spéciale au gratteux Chewy !), la versatilité du chant qui peut évoquer un Johnny Rotten qui se mettrait à faire des vocalises, et l’enthousiasme d’un public qu’on devine remuant. On ferme les yeux, et on y est ! Mais si on les garde ouverts, on pourra apprécier la beauté et la bizarrerie de la pochette, réalisée comme toujours par le batteur Away. En attendant le prochain album studio…
PALLBEARER - "Forgotten days"
Pallbearer, carré d’as de l’Arkansas, sort en cet automne monotone un album de saison : le groupe de doom américain fait de son quatrième opus un nouveau manifeste de regret, de perte, de douleur, cette fois centré sur le thème de la famille, comme l’illustre la pochette dérangeante de « Forgotten days ». On y retrouve un heavy metal lent et massif, évoquant les icônes anglaises du genre Cathedral et Paradise Lost, mais aussi les regrettés Type O Negative. Dès l’entrée éponyme, les riffs lourds comme des cercueils règnent avec un son brut et saturé… mais le chant (qui rappelle celui de Brann Dailor de Mastodon) est quant à lui totalement clair, et les guitares lumineuses prennent des atours progressifs. Toute la patte du groupe réside dans cette cohabitation parfois discordante : le gros cafard rampant avance lourdement et lutte avec la mélodie aérienne qui tente de reprendre le dessus. La musique désincarnée et l’impression de malaise qui s’en dégage peuvent rappeler les compatriotes Mastodon et Baroness, chez qui on trouve cette même recherche de renouveau pour un rendu atone et tordu. On retiendra parmi les huit morceaux l’épique et fantomatique « Silver wings » et la conclusive « Caledonia » (le hit de l’album !), dont les nuances goth/dark wave désespérées laissent place à un motif de guitare médiéval qui achève le disque en beauté.
ARMORED SAINT - "Punching the sky"
Carrière atypique que celle d’Armored Saint, qui publie son huitième album (seulement !), quarante ans après ses débuts. Le groupe de Los Angeles pratique un heavy metal de tradition lorgnant parfois vers le hard rock ou le groove metal. Il a plusieurs armes secrètes : le bassiste Joey Vera de Fates Warning, qui compose et produit, mais surtout le fort sous-estimé John Bush au chant qui a été le frontman d’Anthrax pendant dix années (ses meilleures, non ?) et a failli être la voix de Metallica à une époque où James Hetfield voulait se consacrer à la guitare uniquement. Ce « Punching the sky » au titre frondeur s’avère un album homogène et compact mené par un groove d’enfer tout du long. Les guitares de Jeff Duncan et Phil Sandoval sont un régal, tant dans les rythmiques appuyées à la Pantera que dans les harmonies et soli que ne renieraient pas Thin Lizzy et Iron Maiden (avec cette teinte mélancolique à la « Somewhere in time », pour les connaisseurs). Le chant habité et écorché de Bush est souvent appuyé par des chœurs imposants, et la plupart des titres sont des mid tempos sublimés par un refrain emphatique. Voilà qui est très bien fait, mais la formule éprouvée du combo aurait peut-être gagné à être renouvelée par davantage que ces rares incartades (intro de cornemuse, break au piano, power ballad, intro à la flûte indienne) qu’on aurait voulues plus longues et assumées. En conclusion, le disque porte quand même bien son nom : comme évoqué sur le dantesque titre introductif « Standing on the shoulders of giants », la musique d’Armored Saint grimpe haut, et garde après toutes ces années l’énergie pour frapper le ciel jusqu’à en faire tomber les anges de sa ville natale.