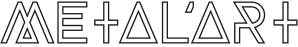Ale
MADSEN - "Lichtjahre Live"
Si la longue histoire du rock et du metal nous a prouvé que faire de la musique en famille, c’est fantastique, il est cependant toujours délicat de juger des morceaux chantés dans une langue que l’on ne comprend pas. Il reste les instrus donc, et ça tombe bien : ce live de Madsen se montre plutôt généreux avec ses vingt-deux titres (sans l’intro). Si le sentiment général vis-à-vis de l’album donne envie de les ranger dans la vaste famille des groupes rock jeunes, dynamiques et un peu pop ayant pullulé depuis le début des années 2000, ce serait se montrer bien snob et réfractaire à ce côté justement très pêchu et communicatif de la musique de ces mêmes groupes. Madsen n’est pas en reste : ils jouent avec leur public et le font très bien. Chaque titre transpire le peps et l’énergie : « Lass die Musik an » et son refrain aussi simple à retenir qu’efficace, le côté plus heavy de « Rückenwind » ou encore le côté lancinant de « Kompass », on peut reprocher aux frères Madsen un chant peut-être moins agréable pour les non-germanophones, mais clairement pas leur versatilité au niveau de leur répertoire. Que dire encore de « Goodbye Logik », avec sa longue intro instrumentale ? Ou « Nachtbaden », encore et toujours d’une patate exemplaire ? On ne peut pas dire que Madsen réinvente le rock, ou qu’il en a la prétention. Mais ce qu’il fait, il le fait bien. Et si cet album live n’apportera sans doute pas énormément à ceux ayant déjà entendu « Lichtjahre », le simple fait d’avoir le groupe au plus près de leur public, qui galvanise avec force des artistes toujours aussi fougueux quinze ans après leurs débuts, rend l’album très appréciable.
CB3 - "Aeons"
Cinq titres pour un LP, c’est dans la norme. Mais quand on parle de rock psyché, on se doute qu’on va avoir de la matière à se mettre sous la dent malgré tout… Et pas qu’à cause de la longueur des morceaux ! Si les vocals sont généralement en retrait dans le genre, le trio de Malmö choisit carrément de les occulter. Pour mieux se focaliser sur la musique ? On peut en tout cas le croire ! Le cosmique et onirique « Zodiac » parait court et intense pour du psyché, mais donne déjà le ton de la claque à venir, notamment par ses cordes hypergraves qui offrent un sacré impact ! Les deux titres suivants, « Sonic Blaze » et « Acid Haze » forment véritablement l’épine dorsale du LP : le premier offre un travail hallucinant sur les percus et donne une atmosphère qui groove tout en ayant beaucoup de corps et de versatilité. Le second commence de manière très cinématographique, voire guerrière. Il est beaucoup plus lent, mais beaucoup plus dense aussi : les riffs déchirant le lointain jusqu’à s’emballer au milieu du morceau et enfin revenir à une cadence plus musclée, plus rythmée. Les riffs stridents laissant leur place à des accords plus rapides et graves. Avec un peu plus de neuf minutes, ce titre est d’une versatilité exemplaire. Les deux titres suivants sont également très bons, mais moins mémorables que ces deux joyaux incroyables. Rappelant quelques titres de Death in Vegas par moment, Pink Floyd évidemment, mais clairement dans leur propre niche, on ne saurait que trop recommandé l’écoute de cette petite bombe suédoise !
RAGE - "Wings of Rage"
L’histoire est commune : un groupe des 80s ayant subi plusieurs changements de line-up, ayant perdu son éclat sur leurs dernières productions et pourtant toujours là, à carburer pour sortir des nouveaux sons bien loin de leur âge d’or. On saluera d’ailleurs Peavy, seul membre d’origine du trio. Concernant l’album lui-même… Il est somme toute assez convenu, sans fulgurance, mais tout à fait sympathique. Les thèmes de prédilection du groupe, tantôt lorgnant faire la fiction, tantôt s’attachant à des thématiques plus humaines, sont bien retranscrits. Le premier s’illustrant magnifiquement sur le titre « Chasing the Twilight Zone », samplant le fameux générique de la toute aussi célèbre série de Rod Serling. Certainement l’un des meilleurs morceaux de l’album tant par sa puissance que pour l’incorporation astucieuse du sample. La deuxième thématique s’illustre davantage sur « Shine a Light », « HTTS 2.0 » ou « Don’t Let Me Down ». Malheureusement, si musicalement on ne peut rien reprocher à ces titres, les paroles, elles, sont plutôt plates… Voire un peu niaises. On reprochera aussi un milieu d’album traînant en longueur : rien de mal à caser une balade ou deux, mais celles-ci semblent presque prises en sandwich entre le début et la fin, bien plus musclées. Il aurait peut-être été préférable de les mettre en clôture d’album que de les entasser ainsi en son centre. Il n’empêche que si l’album manque de relief, tant dans le genre que dans la discographie du groupe, il n’a rien de foncièrement mauvais et saura satisfaire le fan de heavy n’ayant rien à se mettre sous la dent.
YE BANISHED PRIVATEERS - "Hostis Humani Generis"
Pour les non-initiés fans d’Alestorm, la musique de l’équipage (ce n’est pas rien de le dire… plus de trente membres !) de Ye Banished Privateers est beaucoup moins dans le délire de la boisson et du gros metal et beaucoup plus dans les chansons de galérien, inspirées bien souvent de faits historiques revisités. Et la formule demeure inchangée pour ce quatrième album, traitant de thèmes lourds de la vie de marin avec des sonorités folk plus « traditionnelles » que leurs comparses. Que dire de l’entrainant, mémorable et magnifique « Hush Now My Child », l’un des morceaux forts de l’album ? Que dire de « Flintlock », plus posé, mais véritable conte en plein milieu de l’album ? Ou encore « Elephant’s Dance », gigue plus stéréotypique de récit de pirate, mais diablement efficace. La variation dans les vocals, tantôt masculines, tantôt féminines… Tantôt mixte, tantôt chœurs ! Avec un tel line-up, autant mettre à profit l’ensemble des talents à disposition. On saluera aussi le travail réalisé sur l’ambiance, l’atmosphère de l’album. Bruits de vagues et de mouettes à profusion, c’est peut-être convenu, mais ça marche. Et c’est peut-être le meilleur résumé de ce nouvel album : oui, c’est des chants de pirate comme on les imagine, comme le veulent les clichés. Mais quand c’est aussi bien fait, on ne va tout de même pas cracher dessus. Et après tout… Vous connaissez beaucoup de groupes récents opérants dans ce style si singulier ? Un album à écouter et à chanter, en sirotant un bon rhum brun !
TURBOKILL - "Vice World"
Se lancer dans le heavy à l’heure actuelle est soit un pari un peu fou, soit le projet de vrais passionnés. On serait bien tenté de prétendre que Turbokill fait les deux ! Il serait sans doute illusoire de chercher encore de la nouveauté dans un genre si surchargé, et le groupe ne s’en encombre pas (y compris jusque dans le line-up classique : une guitare rythmique et des vocals indépendante du lead guitariste !). Et ce n’est pas plus mal : l’album se révèle aussi fun que sympa, ne dérogeant certes pas aux codes, mais les appliquant avec justesse, précision et talent. Le titre éponyme donne une patate monstre, tant par sa rapidité et un refrain honteusement entraînant. Le morceau suivant, « War Thunder » est encore plus véloce et décape par l’adrénaline pure proposée tout du long de ses quatre minutes. « Pulse of the Swarm » se veut plus lourd et cru, presque groovy dans les guitares… et clairement martial pour la batterie ! La grande force (et principal plaisir) de la musique de Turbokill c’est justement de puiser dans toutes les caractéristiques du genre pour nous livrer une sorte de « best-of » de tout ce qui s’est fait de mieux. En cette période d’amour inconditionnel pour les 80s, c’est de rigueur ! Et quand on entend « Turbokill » (le morceau !), semblant tout droit sortir du dernier album de Judas Priest, on se dit que c’est de toute façon un genre condamné à répéter son âge d’or… Pour le meilleur comme pour le pire ! En tout cas, pour un premier album, Turbokill s’en sort impeccablement. À voir s’ils vont poursuivre la route de l’hommage assumé ou creuser leur propre style. Quoiqu’il en soit, le produit fini demeure fort sympathique et atteste de tout l’amour du quintette pour ce genre, épique et mélodieux comme il se doit.
JX ARKET - "About Existence"
Un nom de groupe énigmatique sortant un album-concept au nom limpide. Un quatuor venu d’Italie qui nous délivre pour ce second opus un concentré de post-punk, de hardcore et une bonne dose de screamo… Tout un programme donc, et un bon melting pot comme on apprécierait en voir davantage. Focalisés sur « la futilité de l’existence » (selon les dires du groupe et comme le nom de l’EP le laisse présager), les titres sont au moins aussi équivoques : « Void and Pain », « Faded Colors » … Aucun doute : les thèmes abordés seront plutôt mélancoliques et sombres. Mais c’est parfaitement contrebalancé par la voix de Davide Giaccaria : à la fois juvénile et surprenamment puissante. Ce contraste est d’autant plus réussi que les instrus n’hésitent pas à balancer de la distorsion ou une batterie aussi soutenue que marquée. Notamment sur la fantastique intro de « Counterpoison » (qu’on aurait presque voulu plus longue… mais serait-ce bien raisonnable ?). Autre prouesse instrumentale sur le bridge de Mountains : précédé par un (trop court !) solo de batterie totalement fou de Marco Mei, il nous délivre ensuite une salve de gros riffs qui collent au corps, rapidement rejoint par les vocals hargneux de Davide. Si on a souvent du hardcore une image testostéronée et violente, la musique de JX Arket est plus fragile, plus sensible. Cela ne plaira pas forcément aux afficionados les plus brutasses, mais comme entrée en matière ou simple praline tragique, le jeune groupe fait très bien le taf. Hâte d’en découvrir davantage !
WRECK-DEFY - "Remnants of Pain"
Comment dire qu’avec un tel pedigree pour chacun des membres du groupe, sortir un tel album laisse forcément un petit goût amer dans les oreilles. Passons outre la pochette (qui on l’espère, est emprunte d’autodérision) et concentrons-nous sur le nœud du problème : l’album est creux, l’album est plat, l’album n’a rien de spécial. Que les thèmes abordés choisissent de cracher sur la religion et la guerre ne pose aucun souci : cela relève pratiquement du folklore thrash, au même titre que les riffs agressifs ou l’abus de la double grosse caisse. Non ce qui pose problème, c’est d’avoir un tel bagage et de proposer des morceaux si insipides. Jamais à jeter, mais jamais vraiment bon non plus, les morceaux défilent sans que l’on ait vraiment envie d’y retourner. On headbang mollement sur des compositions assez peu inspirées, parfois sauvées par des textes incisifs qui n’hésitent pas à donner des coups là où ça fait mal (notamment « Blackend Cloth », critique acerbe de la pédophilie dans l’Église). En revanche, certains morceaux nous plongent vraiment dans l’incompréhension. Pourquoi « Angels and Demons » se pose comme une balade à la limite du Glam par exemple ? « 18 oz of Chrome » en revanche, est franchement pas mal et propose quelques bonnes idées… Mais il est beaucoup trop long, et finit par devenir répétitif au fil de ses sept minutes. Les morceaux de plus de trois minutes réussissent rarement au Thrash pur, et Wreck-Defy en fait les frais. S’il s’agissait du premier album un peu bancal de jeunes zickos, le bilan serait plus clément. Mais avec Greg Christian à la basse et Alex Marquez à la batterie, le jugement mérite plus de sévérité. Même pas digne d’être une curiosité, on ne garde qu’un album fade.
SODOM - "Out of the Frontline Trench"
La production de Sodom de ces dix dernières années est aussi prolifique qu’inégale. Il s’agit en effet déjà de leur deuxième EP cette année. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils se montrent plutôt avares sur cette nouvelle galette, avec seulement cinq titres dont seulement trois inédits. S’il est toujours plaisant de réécouter Agent Orange et sa critique aussi fracassante que pertinente de la guerre du Viet Nam, cela reste un titre vieux de trente ans… De même, si la version live de « Bombenhagel » n’enlève rien à son refrain tonitruant, les fans du Big Four allemand connaissent le morceau par cœur. Les morceaux restants ne sont pas foncièrement mauvais, mais ils n’ont que très peu d’éclat en comparaison des deux autres. On ne peut pas souhaiter ravoir un « Ausgebombt » et en même temps cracher sur la nouveauté, mais force est de constater que le reste ne suit pas. Certes le titre éponyme propose une descente de riffs sympathique, mais trop vite expédiée. « On your Knees » propose un bridge maous, précédé par un passage en mid-tempo freinant totalement nos ardeurs. Pas évident d’enchaîner deux morceaux de plus de cinq minutes à un rythme effréné, mais on aurait apprécié qu’il soit mieux amené. Seul « Genesis 19 » sauve vraiment la mise, avec son intro qui commence merveilleusement, avec des sirènes, des riffs bien lourds s’enchaînant sur un combo percu/cordes sous adrénaline. Si lui aussi se voit pollué par un interlude mid-tempo dispensable, la première moitié du morceau résume tellement l’essence sauvage du quatuor (dont seuls Tom Angelripper et Frank Blackfire peuvent se targuer d’avoir connu leur âge d’or). Ni vraiment destiné aux fans, ni suffisamment riche que pour faire découvrir Sodom à la jeune génération, cet EP est malheureusement très dispensable.
MUNICIPAL WASTE - "The Last Rager"
Premier EP des thrasheux de Municipal Waste depuis la prolifique année 2012 (qui aura vu naître deux EP ainsi qu’un album), autant ne pas tergiverser : on reste clairement sur sa faim face aux dix petites minutes de la galette. D’autant plus que chaque morceau est… très bon ! Le magnum opus de l’album se trouvant certainement dans le titre éponyme : des lignes de basse hyper lourdes et répétitives, accompagnées de percussions simples et efficaces et on se tape un morceau tabassant tout sur son passage dans un océan de violence brute et sans finesse. « Wave of Death » sert de très bon apéritif également, avec ses riffs très mélodieux s’extirpant de cette basse (encore elle !), clairement bien décidée à clamer haut et fort son existence. Tandis que si « Rum for Your Life » ne vous décroche pas un sourire à la simple lecture de son titre, nul doute que sa frénésie sortie tout droit de l’esprit d’un ado colérique saura vous donner l’envie de sauter partout. Si vous espériez un peu d’accalmies sur « Car Nivore », comment vous dire qu’il s’agit peut-être du morceau le plus foutraque ? Avec une batterie, jusqu’ici « sage » qui se déchaîne d’un coup complètement ? Alors ce n’est pas très long… Mais que c’est bon !
NORMA JEAN - "All Hail"
Huitième opus du quatuor, sortant bien après la vague metalcore et screamo qui a traversé tout le début des années 2000, il permet de prouver aux quelques réfractaires qu’il y a toujours matière à travailler même à l’aube des années 2020. Mélodique et brutale, à l’image de la voix tortueuse et râpeuse de Cory Brandan, la musique de Norma Jean se veut aussi fluctuante que délicieusement agressive. Peut-être faut-il imputer ces changements multiples au line-up lui-même très mutagène du groupe… Qu’importe, si cela peut offrir à nos écoutilles une salve originale tous les trois ans en moyenne. Car c’est aussi un sacré atout du groupe : sa capacité à brasser les sous-genres avec une certaine maestria. Que ce soit le hardcore, le prog ou le noise, rien ne paraît greffé : tout s’imbrique très bien. Même les interludes valent le détour… Si ce n’est pour leur atmosphère lourde, pesante… pratiquement effrayante même ! Ou encore le morceau qui clôt l’album : « The Mirror and the Second Veil ». Une simple guitare acoustique, sans rien derrière, pour clore non sans amertume une galette très fournie. Clairement, il y aura à boire et à manger sur cet album. Les thèmes abordés sont tranchants, sombres et riches… à l’image de leur musique en vérité. Si on ne peut pas leur retenir un caractère unique les rendant un peu à part (on aimera ou pas), on regrettera presque cette surabondance… Qui ne manque que d’un soupçon de raffinement pour décrocher un score parfait. Mais on chipote…
COILGUNS - "Watchwinders"
Prétendre que la musique de Coilguns est un véritable chaos jubilatoire pourrait paraître péjoratif ou réducteur, mais il faut bien admettre que ça résume plutôt bien un style très difficile à résumer (justement…). Jouant sur les rythmes et les sonorités, au goût prononcé pour l’expérimentation, les Suisses nous livrent une suite foutraque au déjà bien distordu « Millenials », sorti dix-huit mois avant. C’est aussi cet aspect désorganisé, mais pourtant très calibré et très agressif qui confère toute son aura à cet album. Que ce soit les percussions endiablées, presque jazzy, du titre éponyme (fallait bien être Suisse ou s’appeler Coldplay pour parler d’horlogerie dans une chanson !). Ou encore la cacophonie punk à souhait de « Big Writer’s Block ». Et que dire du mécanique et presque prog « The Growing Block View » ? Et si on veut un peu de rab’ niveau versatilité, on a aussi le plus lent « Prioress » qui fait durer le plaisir jusqu’à l’explosion au milieu du morceau, venant caresser nos oreilles et agissant presque comme un épilogue… en plein milieu de l’album ! « A mirror bias » et ses cordes très douces agit de manière similaire, comme une pause bienvenue au milieu du fracas que contient l’album. Pour ce qui est des vocals, on oscille entre du scream bien hardcore appuyant à merveille les instrus comme sur « Broken Records », et un chant plus rap-metal. Watchwinders est donc un album assez singulier et pas facile d’accès, mais qui ravira les fans de sono moins lisse, propre et codifiée.
AERODYNE - "Damnation"
Que dire de cet album, si ce n’est qu’il est presque parfait ? Et pour un groupe qui en est qu’à son deuxième album (en deux ans !) et qui joue dans la cour d’un genre maintes fois essoré, ce n’est clairement pas rien ! Il serait par ailleurs difficile de nommer les meilleurs morceaux, tant chacun d’entre eux est d’une efficacité incroyable, proposant à la fois des vocals à la force juvénile impressionnante et des instrus d’une lourdeur beaucoup trop rare. Quand on y ajoute une rapidité affolante, comme sur « Kick it Down » (avec une disto clean et bien calibrée de surcroit), ça devient presque du Thrash ! Mais le côté groovy, lancinant et répétitif de « March Davai » nous transporte tout autant, dans un style bien différent. Car c’est aussi l’une des grandes forces du groupe : leur faculté à proposer des titres qui se renouvellent sans cesse, tout en affichant une qualité et une technicité toujours exemplaires. Même le titre éponyme, pris en sandwich entre les deux bêtes de vitesse que sont « Under the Black Veil » et « Kill or be Killed » , se révèle une sympathique praline plus posée, plus chill (mais toujours heavy et diaboliquement entraînante, faut pas pousser non plus). Et que dire du titre « The Nihilist », qui se raccroche parfaitement à la cover de l’album et qui fera beugler un bon gros « GOD IS DEAAAD » au plus pieux des métalleux… Slayer style ! Dernière marque de fabrique du groupe, et pas des moindres : ses bridges. Aussi long que généreux, chaque morceau fait la part belle aux moments purement instrumentaux… Comme si le groupe était pleinement conscient que malgré des vocals d’une grande qualité, il n’y a rien de mal à laisser s’exprimer pleinement l’entièreté des talents du groupe. Un album quasi sans faute, et un incontournable de cette fin d’année.
TOXIC HOLOCAUST - "Primal Future: 2019"
Avec un titre et une jaquette pareille, on aurait pu croire que le bon Joel Grind pousse à fond dans le délire 80s bien kitsch. Que ce soit en nous donnant une cuillérée de thrash à l’ancienne, ou en jouant la carte des synthés, lasers et autres joyeusetés. Mais le maître-architecte du groupe (qui fait presque tout tout seul, hormis les tournées) ne l’entend pas de cette oreille et nous assène un metal puissant, sans compromis et bien dans la veine de ce que propose Toxic Holocaust depuis désormais… vingt ans tout pile ! On retiendra tout juste une voix hyper caverneuse, comme s’il avait décidé d’augmenter la reverb’ à son maximum. Si cela donne moins de fièvre tapageuse à l’ensemble, pas de crainte à avoir : l’album ne nous prend jamais par la main et ce dès le tout premier morceau : « Chemical Warlords ». Et c’est à la fois sa plus grande force et sa faiblesse : chaque titre est vraiment très bon, vraiment très punchy mais aucun ne se distingue particulièrement. Si on saluera la pluie de riffs hyper bien rythmée de « Black Out the Code », ou encore le bridge très groove de « Iron Cage » : on ne pourra pas écarter l’une ou l’autre chanson. Ni en bien… et sûrement pas en mal !
IRON AGE - "The Sleeping Eye"
Une réédition en bonne et due forme pour célébrer le dixième anniversaire, il faut dire aussi que le quintette n’a plus sorti grand-chose depuis. Qu’importe, l’occasion est trop belle pour redécouvrir la musique d’Iron Age. C’est d’ailleurs sans aucune volonté péjorative que l’on pourrait synthétiser leur style comme du « thrash plus élaboré ». Non pas qu’il n’y ait aucune technique ou recherche dans un thrash plus agressif et rapide, mais le rythme plus mesuré semble rajouter de la force d’impact aux morceaux, et leur donne une atmosphère plus écrasante que sur un morceau de thrash brut. Ce n’est pas tant du terreau à pogo qu’une volonté d’expérimenter et de complexifier un peu l’ensemble, donnant un aspect presque post-apo à l’album. Le thème lovecraftien, si cher au doom, trouve ici pleinement sa place. Notamment sur des titres tels que « A Younger Earth », qui ne s’emballe qu’à la toute fin et surtout « Materia Prima », morceau dénué de paroles qui se révèle être une pause des plus angoissantes en plein milieu de l’album. Difficile aussi d’ignorer « Arcana pt.1 et 2 » tant ils s’emboîtent : le premier plus rageur et le deuxième plus lourd. Un peu de moins de colère, ça fait du bien !
MOTORJESUS - "Live Resurrection"
Enregistré lors des deux derniers concerts de la tournée « Race to Resurrection », on retrouve néanmoins un généreux et malin cocktail de titres issus de toute la discographie du groupe. À la fois des classiques intemporels et d’une efficacité sans équivoque (normal pour le genre !) et des nouveautés bien amenées et fracassantes. Avec un lexique forcément attrait au champ lexical du road trip et de la mécanique… Toujours en accord avec les thèmes chers à ce style purement américain. Ce serait cependant manquer de respect au quintet de les limiter à une simple contrefaçon de ce que produisent nos voisins outre-Atlantique, tant l’amour et la maitrise du genre se font ressentir tout au long des dix-neuf morceaux que compte l’album. Alors certes, on regrettera quelques constructions un peu convenues pour des morceaux toujours assez similaires. Mais parfois, la simplicité à AUSSI du bon. Surtout sur des titres tels que « Dirty Pounding Gasoline » (rien que ces trois mots font un refrain de malade !), « Fuel the Warmachine » ou encore « A new War ». C’est badass, c’est dansant et on y croit pleinement. L’énergie de Lars Lemke est communicative à fond et est parfaitement retranscrite dans cet album live. On s’y croirait presque… La bière renversée en moins ! Pas besoin de parler allemand pour jubiler dès que le chanteur beugle le nom du morceau. C’est aussi ça l’esprit rock. Et le tout forme une sympathique porte d’entrée pour tous ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce groupe, délicieusement rétro.
CRYSTAL VIPER - "Tales of Fire and Ice"
Le problème majeur de cette nouvelle mouture des Polonais de Crystal Viper n’est pas qu’il oscille entre le heavy et le power, mais plutôt qu’il manque de pas mal de patate sur une bonne moitié des morceaux. Peut-être est-ce dû au nouveau line-up ? Ce qui est sûr en tout cas, c’est que la technique est bien là et les nouveaux venus comme les vétérans savent toujours comment faire briller leurs titres : y’a des riffs plutôt sympas, le petit nouveau « Ced » est une vraie perle à la batterie (surtout sur « One Question », titre vraiment pétaradant pour le coup !) et les vocals de Marta Gabriel sont toujours agréables, notamment parce qu’elle n’abuse pas des aiguës comme certaines frontwomen du genre. On appréciera aussi des rythmiques plutôt stylées et mélodiques, comme sur « Neverending Fire ». Non vraiment, y’a de quoi se mettre sous la dent sur cet album ! Mais ça n’enlève pas une certaine platitude, un arrière-goût un peu fadasse sur « Still Alive » ou « Crystal Sphere ». Ils n’ont rien de foncièrement mauvais, mais il aurait peut-être fallu se lâcher un peu plus. Ironiquement, l’une des meilleures tracks de l’album c’est sans doute le morceau bonus « Dream Warriors », véritablement plus lent, mais offrant infiniment plus d’impact et laissant transparaître toute la palette d’émotions dans la voix de M.Gabriel. On en retiendra donc un album solide, pas le meilleur de la discographie des Vipers, mais qui fait oublier ces quelques petits soucis par des vocals de qualité, une batterie excellente et des mélodies parfois plus douces, mais des plus efficaces.
Autant le dire tout de suite, le premier jet du projet annexe des allemands de Blind Guardian se veut très singulier, tout à fait à part de leur discographie usuelle. Déjà reconnus pour leur style grandiose, leurs paroles conteuses de récits fantastiques et de batailles médiévales et surtout pour leur musicalité à faire saliver les rôlistes, le quatuor a voulu pousser le vice encore plus loin. Des compositions complexes et riches, un côté lyrique assumé à fond et des titres plus orchestraux que jamais forment le sel de cet album… au point d’aliéner peut-être certains métalleux moins sensibles à la musique classique (pauvre d’eux !). Mais si ces traits étaient déjà caractéristiques du groupe, ils prennent ici une essence quasi-cinématographique, devenant pratiquement un conte, un récit partagé au coin du feu. De nombreux interludes ponctuent d’ailleurs l’écoute, se résumant bien souvent à des dialogues servant à nous exposer davantage à l’histoire et aux personnages que le groupe a décidé de mettre en place. Si ce n’est pas rare d’avoir des éléments de fantasy et des guerriers dans le power, c’est ici poussé à son paroxysme. On croirait presque entendre le Naheulband ou la bande-son d’un jeu vidéo sur Tolkien ! Pour ces raisons, il est préférable d’écouter l’album d’une traite, et de ne pas sauter (au moins la première fois) les passages purement parlés. Le tout renfermant vraiment un univers indissociable, qui rend le CD assez difficile d’accès. Difficile d’isoler un morceau, de l’écouter d’une oreille distraite… Même si certaines chansons sont plus « metal » alors que d’autres sont plus « classiques ». Une chose est cependant certaine : Blind Guardian nous prouve que même 35 ans après sa création, on peut toujours se réinventer. Et que leur maitrise du registre « épique » n’est égalée que par très peu.
DIE GRÜNE WELLE - "Wirf Dein Leben weg"
C’est plutôt rare d’entendre de l’allemand ailleurs que le genre allemano-allemand de la Neue Deutsche Härte. Mais c’est un pari audacieux qu’assume pleinement Die Grüne Welle (La Vague Verte dans la langue de Gojira). Et le résultat se veut plutôt convainquant, changeant grandement de l’aspect martial et brutal souvent associé à cette langue au sein de la scène metal. Niveau du genre, c’est un beau cocktail de plusieurs styles que nous offre le groupe au sein des morceaux. Que ce soit des morceaux plus typés pop-punk des années 2000 comme « Für Die Massen » ou « Kein Problem », un punk rock plus hargneux et véloce comme sur « Hier Im Dreck » ou « Knopfdruck » … et même un peu de ska ! Et bien sûr, l’emploi du saxophone n’y est pas étranger. On regrettera cependant que cela passe davantage pour une excentricité qu’un véritable élément constitutif de leur musique. L’instrument brille dès qu’il apparait, comme sur le bridge de « Bier Gegen Wein » ou l’intro de « Teilzeitchrist » mais on aurait apprécié qu’il soit davantage mis en avant, tant le combo fonctionne surprenamment bien. Cela ne gâche pas les morceaux en soit, tant ils sont complets et maitrisés (on a une bonne basse sur « Knopfdruck » et « One Love », on a des grosses guitares bien lourdes sur « Für Die Massen » et « Hier im Dreck » …), mais si on devait retenir un léger manquement, ce serait certainement ce fichu saxo trop timide ! On retiendra tout de même un album de très bonne facture, pêchu et versatile, qui jongle avec les éléments du punk avec brio.
REXORIA - "Ice Breaker"
Les suédois aiment leur power…Et ils ont bien raison ! Si le genre est déjà une vraie usine à anthems diablement efficaces pour nous rester dans la tête, l’efficacité de Rexoria est presque insolente. Si l’on n’applaudira pas le talent d’écriture d’un morceau comme « Fight the Demons », impossible de ne pas beugler ces trois mots comme s’il s’agissait d’un des dix commandements. Pareil pour « Reach for the Heaven » qui se tape une intro digne d’un morceau de jeu de rôle ou d’un opening d’anime japonais. Mais sous cet aspect épique presque trop gentillet se cache de belles prouesses techniques malgré tout. On saluera le travail sur les riffs de « Endless Nights » (et des vocals à chialer, dédicace à Frida Ohlin !), idem pour le titre éponyme ou « The Raging Thunder ». L’interlude « Wind and Rain » et son piano sont également du plus bel effet. On a même droit à la référence aux vikings et à la mythologie nordique avec « Brothers of Asgaard ». Rien à redire, le groupe coche toutes les cases inhérentes au genre, tout en puisant dans un registre sensiblement plus axé sur les émotions. Le power inspirant à son paroxysme quoi ! Et cela représente une belle consécration pour ce tout jeune groupe.
RAISED FIST - "Anthems"
À la surprise d’absolument personne, le nouvel opus de Raised Fist est colérique, violent et agressif. Une dizaine de morceaux dans leur plus propre tradition, c’est-à-dire sans aucune pause, sans aucune once de douceur : rien qu’un pur concentré de titres aussi entraînants (« Anthem », « Oblivious ») que fracassants (« Murder », « Venomous »). Il est d’ailleurs incroyable que chaque membre du quintet s’illustre avec autant de panache. Le chant d’Hagman, éraillé comme jamais, semble tout droit sorti d’un groupe de rap-rock bien burné, les guitares de Tikkanen et Holmgren instillent ces rythmes qui donnent envie de se trémousser dans le mosh, la basse de Josse, bien que plus en retrait, brille sur « Unsinkable II » ou « Oblivious » … Et alors la batterie de Matte Modin est une folie. De l’aveu même du groupe, le souhait était de la mettre en avant au même titre que les vocals. Et ils ont clairement dépassés les ambitions ! De « Venomous » qui débute l’album avec une batterie pas forcément rapide, mais impossible à ignorer, à « We Are Here » qui est une véritable ôde au talent du musicien… Aucun titre n’enlève la superbe de Modin. Le reste est excellent, mais c’est SON album.