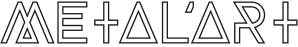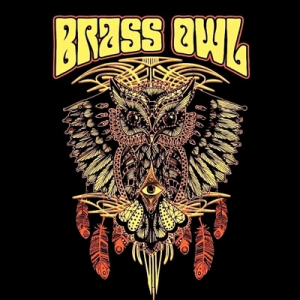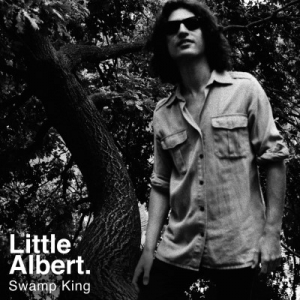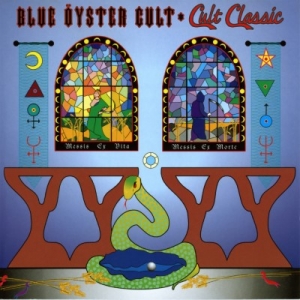Ale
SOLAR FLARE - "Solar Flare"
Old-school, tant dans son style de jeu que dans sa production (et promis ce n’est pas péjoratif !), c’est majoritairement pour ses relents Heavy que la musique de Solar Flare fleure bon les débuts du Power. Très mélodique, le combo de riffs et de vocals maitrisées forment un tout non seulement cohérent pour le genre, mais surtout des plus agréables aux moments opportuns. Que ce soit sur l’étonnamment moderne « Nous Sommes » (en français dans le texte, effectivement !), tant dans son bridge que dans le refrain, ou le très complet (et aptement nommé) « Medieval ». D’autres titres mettent plus en avant le côté heavy que power, tout en ne lorgnant jamais totalement d’un bord ou l’autre : on pense notamment à « Born to Burn » et ses vocals dont le caractère entraînant est diablement efficace. Mais le groupe sort véritablement la grosse artillerie sur des titres plus longs comme « Pharaoh » ou « World in my head », montrant avec une certaine maestria ce dont ils sont capables. Seul bémol pour ce jeune groupe très prometteur : la pochette qui laisse penser à un groupe parodique à la Nanowar… Alors que leur musique est on ne peut plus sérieuse…et on ne peut plus sérieusement efficace !
JUSTIFY REBELLION - "The Ends Justify The Means"
Voilà un nouvel exemple (s’il en fallait encore) qu’enfermer un groupe dans une case ne sert à rien ! Car si leur nom n’est pas déjà suffisamment équivoque, le fait de citer Slayer ou Metallica dans leurs influences ne laisse aucun doute sur le fait qu’on va retrouver du Thrash ou du Groove dans leur Heavy ! On n’a peut-être pas le rythme effréné, mais on a clairement la rage, la lourdeur dans les percus et une basse bien présente ! L’intro groovy et musclée de « Syretrip », la poigne de « Salvation », le bridge long et technique de « Prisoner in Time » … au début plus nerveux et continuant presque sur des teintes power ! Parlant de power, le titre « The Summoning » fait la part belle au chant clair et paraît presque s’être immiscé sur la galette par erreur… Mais ne vous méprenez pas, l’instrumentale puissante demeure pour affirmer pleinement la ténacité et la couleur du morceau, le replaçant pleinement parmi les neuf titres que compte l’album. Un deuxième album légèrement moins gourmand, mais plus qu’appréciable. Il prouve en tout cas avec les derniers Havok et Warbringer que si le Thrash est revenu lors de la décennie précédente, il est là pour rester. Et si c’est le cas avec le heavy aussi… On ne s’en plaindra clairement pas !
FOUR TRIPS AHEAD - "…And The Fire Within"
Four Trips Ahead possède un avantage certain que beaucoup de jeunes groupes n’ont pas forcément : ils sont très « radiophoniques » tout en n’étant pas édulcorés, mous ou fades. Que du contraire, ils n’ont pas volé leur « Power » Rock ! Car il y a une patate, un impact incroyable dans ce qu’ils proposent. On dirait presque un mélange de Lenny Kravitz et de Rage Against The Machine… Avec un peu moins de revendications et un rythme plus posé, mais certainement pas moins costaud ! L’instrumentale lourde de « Good Times Goodbye » et l’efficacité de son bridge… L’intro pétaradante de « December » contrastant totalement avec le chant d’une impeccable douceur qui suit le reste du morceau, ou encore la grosse disto qui débute « Sea Song », et la basse de malade qui l’accompagne… La musique de 4TA instille une nostalgie différente, plus « proche ». Ressemblant plus aux 90s et au début des années 2000 qu’aux 80s et ce qu’il y a eu avant. Voir leur musique sur un jeu Burnout n’aurait pas paru incongru ! Mais surtout, cet équilibre quasi-parfait entre leur côté mélodique et leur incroyable énergie fait plaisir à voir. Pour ne rien gâcher, les titres live autant que la pochette sont également très classes. Un album de très bonne facture, impressionnant par ses qualités et sa fraicheur.
HORRORWISH - "No Place To Hide"
De l’aveu de Gio Smet, maître-architecte de ce nouveau projet, la musique de Horrowish se veut effrayante, macabre et résolument dérangeante. Noble objectif, surtout à une époque où le satanisme est relégué au rang des gentils clichés dont on aime se moquer et où le metal indus préfère la provoc’ plutôt que l’épouvante. Et le pari est plutôt réussi, surtout pour un premier album ! Le premier titre (servant d’intro) nous plonge déjà dans le bain : une berceuse, un piano lugubre et une voix démoniaque… Il y a un travail sur l’ambiance, ça fait plaisir ! Le reste de l’album ne conserve pas cette atmosphère lourde et pesante, mais ça ne gâche nullement le plaisir. Il y a toujours un côté horrifique qui se mêle aux titres plus pêchus, de même que des thématiques toujours très « foire aux monstres » dans les paroles. On pourrait parler du morceau éponyme, « Demons from Below », « The Ghost of Lady V ». On a quelques belles prouesses instrumentalement parlant aussi, comme le bridge de « Whispering Truth » ! Est-ce qu’Horrorwish nous propose véritablement un tout nouveau genre ? Peut-être pas tant... Mais ce blend d’influences terrifiantes fonctionne très bien ! Et comme de juste, l’album compte 13 morceaux… Logique !
RASPBERRY BULBS - "Before the Age of Mirrors"
La mode semble être à la fusion de styles allant assez peu ensemble du moins sur papier. Disons que la colère du punk et ses rythmes effrénés ne paraissent pas tellement coller avec un black metal lourd et sombre, gratiné de textes lovecraftiens. Le produit fini est pour le moins… étonnant. Disons que les deux genres brilleront sur l’un ou l’autre titre en alternance, sans jamais totalement s’épouser. Bien sûr, on conserve des vocals caverneuses, hurlantes même sur les titres plus punks tout comme les morceaux plus black conserveront une attaque incisive et agressive. Rajoutons quelques interludes clairsemés au sein de l’album, et on a véritablement l’impression que le groupe nous balance un peu dans tous les sens sans jamais nous offrir l’opportunité de pleinement s’imprégner de l’univers inspiré de Lovecraft qu’ils retracent. Si on voit mal un autre genre que le black pour coller aux récits fous de l’écrivain américain (à part peut-être le doom ?), le punk est peut-être trop étranger pour pleinement s’incorporer de manière organique. Et pourtant… C’est pas mal du tout ! Ne serait-ce que pour équilibrer un peu l’album. Les interludes eux-mêmes étant bourrés de qualités : mystérieux, inquiétants et surtout bien fichus : ce sont des titres à part entière, pas des entractes poseurs d’ambiance… ou pas seulement ! Sans être un OVNI, cet opus des Américains est clairement un peu spécial. À écouter, ne serait-ce que pour l’expérience (et d’une seule traite !)
BRASS OWL - "State of Mind"
Il a une bonne bouille le trio au cœur de Brass Owl ! Et si on sera surpris de voir qu’ils ne font pas du tout d’electroswing et n’arborent pas une esthétique steampunk, il faut dire que ça ne rend pas leur musique moins atypique. Une douce invitation au voyage, toute en tranquillité avec une petite flûte ? « Hola Key » est là pour ça ! Des riffs distordus et une basse qui groove ? C’est sur « Jive Turkey » que ça se passe ! On veut toujours du groove mais à un rythme plus posé, qui tabasse plus par sa force ? On revient sur « Hook, Line and Sinker ». Et c’est aussi ça qui est top : on ne sait jamais vraiment où le groupe va nous emmener, mais ce n’est jamais incohérent… Et jamais ennuyeux, jamais mauvais ! Un tel niveau de maîtrise, de créativité et d’audace pour un premier album (le trio ayant sorti qu’un EP il y a deux ans au préalable), ça frise l’indécence et en même temps… On aimerait en avoir plus souvent ! On reprendra une rasade de « The Legend of FUJIMO », titre instrumental, aux relents volontiers psyché. Tandis que le titre de clôture, « Pale Horse » donne tout son sens au terme de « heavy » du genre dans lequel s’inscrit Brass Owl. Cela tape TRÈS fort, la cadence s’accélère à la fin et ça jongle avec les plaisirs tout au long de ses (presque) six minutes… Et c’est ce que fait le groupe tout du long en fin de compte. On regrettera presque qu’ils aient déjà placé la barre si haut…
DRUIDS OF THE GUÉ CHARRETTE - "Talking to the Moon"
Si Ozzy aboyait à la lune, les Druids préfèrent lui parler. C’est pourtant davantage Black Sabbath qu’ils revendiquent dans leurs influences. Mais à vrai dire, leur musique oscille entre tellement de styles différents qu’on ne saurait se montrer exhaustif dans leurs (possibles) hommages. À la place, concentrons-nous sur ce à quoi ce cocktail aboutit : un album évidemment très riche, mais surtout très coloré tant en termes de paroles que de sonorités. Le titre éponyme possède ainsi une énergie hypercommunicative, pratiquement punk et calibrée à 2:21 minutes, juste ce qu’il faut ! Le titre qui suit propose tout l’inverse : une atmosphère plus posée, mystérieuse, accompagnant des vocals moins riche en effets et plus énervées. Ambiance similaire, mais avec un retour à une voix plus caverneuse, plus lointaine pour le titre « It’s Alright To Fail », nous plongeant dans une véritable transe pendant ses 6 minutes 41 ! Et ce côté prog et psyché se retrouve aussi sur l’excellent « Gods & Dolls », lui-même précédant le titre « The Curse » offrant un retour à un titre punk…voire horror punk ! Il faut dire que lorsque le groupe qualifie lui-même sa musique de « garage, psychédélisme, post-punk, space-rock et proto-disco-gothico-exotica-krautrock », on peut s’attendre à de sacrées curiosités. Promesse tenue… et pari gagnant ! Tout le monde ne se raccrochera pas forcément aux mêmes titres, mais ils valent tous le détour.
SÜNDENKLANG - "Jahresringe"
On pourra, au choix, dire que la musique de Sündenklang est soit l’évolution logique de la NDH, soit un condensé de tout ce qui a fait le genre (déjà presque trentenaire mine de rien !). On ne sera pas étonné de retrouver le chanteur de Stahlmann aux commandes de ce projet, qui garde des relents de techno (comme aux débuts de ce qu’on surnomme parfois le « dance metal »), mais aussi certains accents plus martiaux et costauds comme sur les titres « Staub » et surtout « Antiheld » peut-être les seuls morceaux s’inscrivant vraiment dans l’aspect très dur de coutume avec ce genre. Mais ce n’est pas pour rien que l’artiste préfère qualifier sa musique de « dark pop », tant l’album s’inscrit dans une atmosphère plus douce, plus poétique. Comme quoi surprise : l’allemand quant on ne le crie pas, peut aussi être très joli ! Mais ne pas le comprendre n’aide pas forcément à pleinement apprécier les titres plus orientés rap de l’album (car il y en a !). Aucun argument probant sur les paroles, mais les instrus sont assez convenues sur ces titres heureusement limités à un ou deux seulement. Par contre, ceux interprétés au piano sont vraiment beaux, en atteste « Du bist mein Licht » ou « Wenn alles brennt ». Il semblerait que les artistes NDH ont ce besoin de se diversifier depuis quelques temps et en conséquence : mieux vaut ne pas s’imaginer retrouver du Stahlmann (et encore moins du Rammstein) sur cet album. Cette concession faites, on en reste avec un tout délicieux tendre et poétique… tout en gardant un côté à part !
MOSCOW DEATH BRIGADE - "Bad Accent Anthems"
Clichés aidant, on ne sera guère surpris de savoir que le groupe vient de Russie…Et promis, c’est loin d’être une critique ! Les artistes russes ayant souvent un côté brut et DIY très plaisant (pas étonnant d’y retrouver du punk), tout en offrant une identité propre. Détricotant les genres sans pour autant revendiquer les réinventer, on pourra rapprocher le chant rappé et l’énergie du trio masqué à des groupes comme Die Antwoord, Shaka Ponk ou encore quelques lointains relents de Limp Bizkit. Prolifiques et éclectiques, on dénote toujours un certain plaisir d’écouter la musique de ceux qui cassent les codes. Car même lorsque c’est moins bien, c’est toujours intéressant. Ainsi dans le cadre de cet album, le milieu semble être là où la qualité réside : « Break the Mold » parait aussi simple qu’efficace : avec un refrain se résumant à ces trois mots et quelques bons gros riffs pour lancer le circle pit ! Et cela se poursuit sur les trois titres suivants : « Sound of Sirens » est hyper dansant tout en gardant une lourdeur bienvenue quand « Whack-a-Mole » et « Dirty White Sneakers » forment peut-être le parfait hybride de leur rap-metal. Les éléments electro sont par contre beaucoup plus clivants : la drum’n’bass de « Feed the Crocodiles » passe plutôt bien, mais « Never Walk Alone » semble tout droit sorti d’une mauvaise rave party… Un album imparfait donc, mais valant clairement la peine de s’y pencher. Ne serait-ce pour se rendre compte que la musique russe actuelle va bien plus loin que les clichés véhiculés par la hardbass !
BLUE ÖYSTER CULT - "Heaven Forbid"
Déjà à l’époque, cet album proposait quelque chose d’assez différent dans la discographie de BÖC. Avec des chansons écrites en vaste majorité par l’auteur de science-fiction John Shirley, des titres tantôt plus axés Heavy Metal (« See You In Black », « Hammer Back » …), tantôt gravés dans la funk (« Damaged », « Real World » …) clairement on s’écarte de ce qui a fait le sel du groupe. Cela ne veut pas dire que les fans de la première heure ne pourront se satisfaire de titres comme « X-ray Eyes », « Still Burnin » ou « Power Under Despair », s’inscrivant davantage dans ce hard rock onirique et incisif dont ils sont coutumiers. On ne regrettera que deux choses majeures, dont l’une récente : l’absence de nouveautés. Les dernières sorties du label Frontiers forment un beau mélange de titres culte et de pépites oubliées mais se contentent de ça, sans bonus ou exclusivités. Le deuxième regret concerne, justement, le manque de titres vraiment marquants sur cet album… Déjà arrivés après la guerre en 1998 (le heavy metal étant déjà en grande perte de vitesse à l’époque), les différents titres de l’album paraissent manquer de peps, de créativité, d’inspiration. Se renouveler ou continuer à faire ce qui plait aux fans à toujours été un dilemme pour tout artiste, mais force est de constater que cet album n’a pas forcément bien vieilli. Pas mauvais, mais plutôt oubliable donc.
La sortie sur album du concert donné en petit comité afin de célébrer l’un des albums les plus cultes de BÖC (et donc, du hard rock tout court) était assez inespérée. Fort heureusement, nous ne sommes nullement déçus malgré son caractère très épuré. Ce dernier est aussi une grande force : si ce n’est les applaudissements de la foule qui lient chacun des titres, on aurait du mal à croire que le tout provient d’un live tant le son est pur. Cela paraîtra sans doute un peu étrange d’entendre « Don’t Fear The Reaper » avec un chant si clair (d’autant plus quand « The Revenge of Vera Gemini » propose cette reverb onirique si caractéristique). À l’inverse, nous avons sans doute là la meilleure version de « E.T.I. », difficile à croire que le groupe ait pu l’interpréter avec autant d’énergie quarante ans après ! Mais le vrai cadeau lié à cet album, ce sont les redécouvertes de titres peut-être oubliés. Le tragico-romantique « Sinful Love », aussi entraînant que déprimant. L’avant-gardiste « Tattoo Vampire », d’une puissance rarement vue à l’époque. Et l’étrangement pro-carniste « Tenderloin ». Non, toujours pas de quoi se réjouir pour les fans absolus du groupe… Mais sans doute la meilleure version d’un excellent album pour les autres. Non pas que l’original vieillissait… Mais une nouvelle couche de peinture fait toujours du bien.
ELAY ARSON - "Dusk Incarnate"
Elay Arson représente beaucoup de choses. Un projet de vie mené par deux comparses, aussi prolifique qu’extrêmement personnel (4 albums et 2 EP depuis 2016 quand même, toujours garnis d’un riche background !), mais surtout la meilleure jonction entre la synthwave et le metal. Même le ténébreux et agressif Perturbator aux racines black metal ne peut se targuer de mettre la guitare au centre de ses productions comme le fait Elay Arson. Et cela donne beaucoup de couleur à sa musique, beaucoup de particularités très sympathique… Et dans un genre qui semble peiner à se renouveler depuis son boom dans le début des 2010s, c’est véritablement salvateur. Cela se traduit véritablement sur Dusk Incarnate, qui développe une belle palette de sonorités assez différentes de ce que l’on entend habituellement dans la darksynth. Si les vocals ne sont plus si rares (en atteste la présence de Megan McDuffee, très régulièrement invitée par les artistes oeuvrant dans le style), que dire d’un presque Thrash « Code Name Dusk Incarnate » ? D’un « Classified Debriefing » qui fait pleuvoir les gros riffs sans jamais les étouffer sous un synthé typique de la synth. Ou même d’un « Cocaine Nightmare », nettement plus doux, presque innocent. Dans la veine de ce que propose FM-84 ou le titre « Sunday Lunch » de Carpenter Brut. Parlant de ce dernier, le très groovy « Laser Castle » met en avant une basse peut-être moins folle que « Disco Zombi Italia », mais tellement agréable qu’elle suffit à prouver que c’est un instrument trop peu mis en avant dans le genre… ou dans la musique en général ! Quoiqu’il en soit, malgré leurs nombreuses sorties, le duo ne lasse fort heureusement pas encore. La présence d’invités reconnus y étant peut-être pour quelque chose. Que ce soit en tant que passerelle d’un genre à l’autre ou comme curiosité mixant les styles, la musique d’Elay Arson vaut le détour.
SPANISH LOVE SONGS - "Brave Faces Everyone"
Encore un groupe « punk » finalement plus axé sur la pop que la rapidité chaotique et hargneuse du punk originel… Ceci étant dit, cela ne doit pas empêcher d’analyser l’album pour ce qu’il est. Et si les thématiques sont plus mielleuses et les sonorités plus douces, il y a également de la beauté dans la simplicité et le « easy-listening ». Ce qui est plus dommageable, ce sont les constructions très convenues du groupe. Après le raz-de-marée incarné par la seconde vague punk des années 90/début 2000, qui a vu pléthore de groupes naître et succomber presque aussitôt, difficile de ne pas être un peu déçu par le côté hyper-prévisible d’un album sorti bien quinze ans après la tempête. On ne peut pourtant pas dire que le groupe n’ait rien à raconter : les émotions telles que l’amour ou la mélancolie pouvant bien remplacer les revendications politiques tout en restant résolument punk. Mais ici, tout paraît fade. Ce n’est pas mauvais mais rien ne se démarque. ET pour un genre qui nous a abreuvé de refrains aussi débiles que diaboliquement entraînants, c’est une vraie déception. De plus, si le groupe paraît très sympathique en plus d’avoir de belles intentions, ils n’en sont pas à leur coup d’essai…Aussi, si l’indulgence est de rigueur lors d’un premier projet, on est en droit de se demander si ce n’est tout simplement pas le style du groupe qui perdure. Consistant sans doute. Mais trop lisse aussi.
LITTLE ALBERT - "Swamp King"
Passer du doom au hard blues, on a connu d’autres reconversions plus étonnantes encore. Tandis que le sobriquet du groupe se réfère uniquement au prénom de son frontman plutôt qu’à une sordide expérience oubliée. On ne pourrait d’ailleurs pas en être plus éloigné, puisque son rythme s’illustre davantage dans le registre blues que hard (rock ?). Preuve en est sur l’instrumental et très sympathique « Blues Asteroid », ou le mélancolique « Swamp King » donnant envie de siroter un whisky haut-de-gamme ou un cocktail élaboré en nous caressant l’échine de ses riffs langoureux. Le blues arbore une incroyable classe, ce n’est pas nouveau. Ce que l’on aurait aimé (et encore ?) c’est peut-être de s’axer plus dans ce côté hard. Pas nécessairement en vélocité, qui aurait sans doute dénaturé ce côté élégant et maitrisé, mais peut-être en grossissant le trait, en s’octroyant éventuellement des sonorités plus stridentes, plus tranchantes par moment. Au risque de perdre ce côté sobre et sombre ? Peut-être… En vérité, il n’y a pas grand-chose à redire sur cette écart blues-y. Il ne réinvente pas la roue, mais Alberto le fait tellement bien qu’on ne peut que se poser dans son canapé, casque sur les oreilles en profitant du moment.
HÄLLAS - "Conundrum"
Dans la famille des styles improbables, optons cette fois pour l’adventure rock. De quoi découvrir des terres inexplorées du monde de la musique ? Nous n’irons pas jusque-là, mais il faut avouer que les vocals d’Alexanderson ont un petit côté troubadour, presque médiéval, qui rajoute un cachet particulier à la musique rétro et colorée du groupe. On se croirait presque sur du Rainbow croisé à du Blue Light Orchestra ! « Tear of a Traitor » en est sûrement l’exemple le plus parlant. Peut-être plus classique, mais tout aussi agréable : la douceur d’un « Carry On », véritable invitation à un road trip nocturne. Et les trois derniers titres aux noms poétiques, « Labyrinth of Distant Echoes », « Blinded by the Emerald Mist » et « Fading Hero » prennent des airs d’épopée tant par leur durée que leurs sonorités : la première est plus tranquille, on est loin d’une montée progressive en intensité et force. Ici, tout est calme sans jamais être mou ou ennuyeux. La seconde plus péchue, s’emballant au milieu pour se calmer selon une trajectoire « en cloche ». Finalement, ils ne l’ont peut-être pas volé leur classification dans le genre du rock aventureux… On a l’impression d’avoir vécu un sacré trip avec le groupe en clôturant l’album. Nul doute qu’un soupçon de « space rock » n’y soit pas étranger non plus, surtout sur le titre qui clôt l’album ( « Fading Hero » donc). Dans le domaine du rock et ses dérivés, la nostalgie est omniprésente. Mais certains genres sont moins exploités que d’autres. De quoi savourer encore un peu plus ce nouvel album des suédois !
BLUE ÖYSTER CULT - "Hard Rock Live Cleveland 2014"
Si la setlist de ce concert n'est pas la plus originale, on ne prétendra pas non plus en être surpris. Tant parce que cela fait bien longtemps que BÖC n'a plus sorti de nouveaux titres que parce qu’ils sont toujours aussi diablement efficaces plusieurs décennies après leur sortie. On appréciera ainsi cette version ultra-longue de "Godzilla" de plus de douze minutes ! Mais aussi d’autres aussi bons que puissants : « Buck's Boogie », « Burnin' For You » ou encore « Harvester Of Eyes » font partie de ces titres que l'on n'a de cesse de redécouvrir. Que dire aussi de "Black Blade", morceau tout aussi geek que Godzilla mais bénéficiant d'une aura bien moindre alors qu'il a tout du "crowd pleaser" ? Les morceaux du groupe ont toujours brillé davantage par leurs instrus que par leurs vocals souvent plus minimalistes, mais ces dernières rajoutent toujours un cachet particulier c'est clairement le cas sur cette chanson. La joie de n'avoir pratiquement QUE de la musique, donc avec très peu d'intervention du groupe entre chaque morceau, est vraiment plaisant. Tant pis pour ceux qui voulaient entendre quelques anecdotes... Le groupe donne tout ce qu'il a sans fioritures, et c'est bien pour ça qu'on est là ! Si on pourra reprocher au groupe de ne sortir que des productions sans réelles surprises ces dernières années, on se réconfortera en disant que presque aucun titre n'a pris de coup de vieux. C'est toujours aussi jouissif d'entendre Cities On Flame With Rock And Roll ou Me262. Même si on trouvera toujours LE titre qui manque... Pour nous, ce sera "Astronomy" cette fois-ci.
BLUE ÖYSTER CULT - "Cult Classic"
Et une énième ressortie pour ce désormais bien culte "classic" ! En ce sens, difficile de feindre la surprise : la tracklist est le même concentré de gourmandise que l'on attend d'un groupe mythique comme BÖC. On a « Don't Fear The Reaper » (évidemment), « Godzilla » (peut-être dans la meilleure version jamais sortie), « Burning for You » (qu'on a du mal à écouter sans penser à un certain groupe suédois...), et quelques morceaux tout aussi excellents peut-être un brin moins connu : « Harvester Of Eyes », « Astronomy » ou « M.E. 262 ». Non finalement, outre le manque de nouveautés, ce qui est préjudiciable à l'album c'est peut-être d'avoir gardé en l'état les deux curieux "TV mix" en queue de peloton. S'ils permettent de pleinement apprécier l'instrumental des deux titres, on se rend bien compte de l'importance capitale des vocals dans la genèse des titres Godzilla et Don't Fear The Reaper. Ce n'est tout simplement pas pareil sans. Que dire de plus ? Il s'agit des meilleurs titres d'un des meilleurs groupes de hard rock, vieux de plus de cinquante ans. Les fans absolus n'y verront aucun intérêt. Les non-initiés y trouveront l'essentiel d'un groupe n'ayant plus rien à prouver. GO-GO-GODZILLA !
HELLYEAH - "Welcome Home"
“Hellyeah” ! Voilà ce qu’on a envie de lâcher en découvrant le nouvel album du supergroupe. Alors qu’arriver au sixième album pour ce genre de formation est déjà plutôt surprenant, voir cet album sortir malgré l’immense et tragique perte que représente le décès de Vinnie Paul force le respect. Et avec une telle qualité, ça paraitrait presque insolent... Si cela n’en faisait pas l’hommage ultime. C’est que Hellyeah s’est grandement bonifié avec les années, et que les cloisonner au seul genre du Heavy serait infiniment réducteur. Injectant une bonne dose de groove, avec quelques pincées de thrash ou de nu par-ci, par-là, il y a une richesse bienvenue dans les quelque dix morceaux proposés : c’est sage, mais intense. L’album démarre en furie, avec le single “333” : il illustre parfaitement ce mix heavy et groovy... avec une bonne grosse patate bien agressive. “At Wick’s End” illustre mieux ce côté nu-metal tout droit sorti de la charnière 90s-2000s... Lourd, impactant avec une voix tantôt éraillée, tantôt plus mélodique (lors du refrain). Idem pour “Boy”, en plus enragé encore. On dirait presque du rap-rock ! Que dire de “Perfect”, pour le coup hyper dansant, donnant envie de sauter partout tant par son bridge aux riffs des plus délicieux que par son chorus simple et efficace. Même le morceau de clôture, à défaut d’être original (une balade acoustique), est plutôt joli et apporte une accalmie sympathique à un album qui nous hurle au visage pendant la demi-heure qui précède. Malgré un début de carrière plutôt décevant qui aura sans doute refroidi les fans les plus assidus, ce nouvel opus (et le précédent) démontre que Hellyeah mérite à être réhabilité. À voir si l’aventure continuera sans Vinnie, et s’ils pourront reproduire ce coup de maître sans ses talents...
En voilà un nom d’album pas du tout à rallonge ! Blague à part, la Suède nous prouve une fois encore qu’elle dispose de nombreux atouts pour séduire le mélomane, et ce dans tous les genres. On a ici droit à du bon rock à l’ancienne, dans le registre pêchu et hyper-catchy qui fait de chaque morceau une dose de puissance absolument jouissive. Pour un premier album, c’est déjà très peaufiné, très efficace. Le genre de morceaux qui accompagnent un road trip, ou qu’on apprécie en savourant un burger en chemise à carreaux… Même la voix d’Erik Linder semble tout droit sortie d’un jukebox ! Tandis que la gratte de ce dernier, adjointe à celle de Kristian Rigo groove sévère et propose de jolies prouesses tant mélodiques que simplement classes et énergiques. Parce que c’est surtout ça : leur musique est COOL. Même leur logo l’est, même leur dégaine… Et leurs prestations lives semblent l’être tout autant. Et ça se ressent parfaitement sur des titres comme « Rock’n’Roll Degenerate », « The Tourist » ou encore « Dog on a Leash » (dont l’intro vous rappellera peut-être quelque chose…). On regrettera peut-être, et c’est le plus dommage que les morceaux restent somme toute assez similaires, fonctionnant sur un même schéma. Ils sont tous très sympathiques, mais pas vraiment uniques… Rendant difficile la sélection d’un ou deux morceaux vraiment excellents. Mais on ne boudera pas son plaisir : certes, il s’agit là d’un énième groupe voulant faire du neuf avec du vieux, mais leur fougue est tellement communicative qu’on est tout simplement happé pendant tout l’album et sa patate. L’album se clôt d’ailleurs par « Frenetic Magnetic », l’un des premiers singles du groupe, au bridge délicieux qui clôt en beauté un album qui ne s’arrête jamais. Et avec un nouvel LP déjà prévu pour février 2020, on attend le quatuor au tournant !
KINGS NEVER DIE - "Raise A Glass"
S’il serait très tentant de gonfler la note du groupe pour la simple audace de faire du punk rock à l’ancienne à une époque où le côté pop, plus commercial, est venu se greffer dans la musique des anciens porteurs d’iroquoises, on ne sera guère étonné de retrouver des vétérans de Mucky Pup ou Murphy’s Law derrière ce premier EP. Pourtant, il est difficile de ne pas s’avouer quelque peu déçu par cette première offrande affublée du nom « Kings Never Die ». Si les quatre morceaux se suivent et ne se ressemblent pas, on pourrait même être désarçonné par ce manque de liant entre les titres qui composent la galette. « Before my Time » s’inscrit dans un style plutôt Thrash, manquant un peu de peps, mais clairement pas d’impact et de force. « Never Know What You Might Find » est certainement leur meilleur titre, puisque rajoutant cette hargne, cette adrénaline manquant au morceau précédent. « Raise A Glass », donnant son titre à l’EP, est un curieux patchwork entre un titre punk rock et une chanson à boire, qui s’intensifie progressivement. Dommage cependant que le refrain fasse totalement retomber le soufflé… Gageons que les mêmes vocals, chantées plus vite auraient donné un résultat nettement plus appréciable. Enfin, « The Juice » combine les qualités et les défauts des deux titres précédents : à la fois costaud et explosif, il devient par moment mollasson et sans reliefs. Il suffit de voir ces deux derniers tiers, pratiquement dénués de paroles : c’est long…très long. Difficile donc, de pleinement recommander cette première prod des Kings qui est tout juste sympathique, mais très rapidement oubliée.