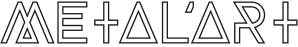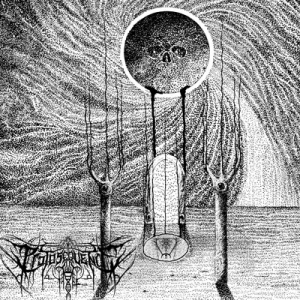GuiGui
HATE FOREST - "Hour Of The Centaur"
Hate Forest a connu un début de carrière faste et plus que prolifique puisque les sorties se sont tout de même bien enchaînées entre 1999 et 2005. Mais depuis lors, c’est un peu comme si le bébé de Roman Saenko (Drudkh, ex-Dark Ages, ex-Blood Of Kingu….) avait disparu de la scène après un « Sorrow » particulièrement acclamé, voire culte. Certes, quelques splits ou compilations ont pu voir le jour par la suite, mais il était plutôt question de faire du neuf avec du vieux puisque généralement il s’agissait de titres issus des précédents albums ou démos. Revoilà donc, après quinze ans, le projet ukrainien black metal avec « Hour Of The Centaur », un album en forme d’évènement. Pour la recette, le changement n’était vraisemblablement pas à l’ordre du jour tant on retrouve la manière de faire de Saenko. C’est ainsi que les choses reprennent là où elles avaient été laissées. La recette prend puisqu’elle est maîtrisée : de la haine profonde, une boîte à rythmes offrant à la majorité des morceaux un blast ininterrompu, un son plus que crasseux, une voix d’outre-tombe et surtout une collection de riffs d’une inspiration parfois rare pour ce genre de projet. L’homme a le sens de la composition et cela se vérifie d’ailleurs au travers de « No Stronghold Can Withstand This Malice » ou encore du plus mélancolique « Anxiously They Sleep In Tumuli » dotés de parties de guitare qui sonnent parfois/souvent comme une leçon de raw black metal. Seulement voilà, même si votre serviteur respecte énormément l’intégrité artistique d’une production aussi crue, il restera toujours un peu sur sa faim en matière de son. Si celui-ci était travaillé pour lui donner sa pleine puissance tout en conservant sa saleté originelle, le message de Hate Forest serait-il différent ? La question mérite d’être posée surtout dans un cas comme celui-ci où la différence entre l’intro de l’album et le morceau qui la suit est si flagrante. En effet, dès les dernières notes de « Occidental, Beware the Steppe », on s’attend à ce que l’enchaînement vers « Those who worship the Sun bring the Night » nous prenne à la gorge alors que le soufflet retombe, ce qui ne manque pas de surprendre. Quoiqu’il en soit, le retour de Hate Forest après un long silence est désormais acté via ce « Hour Of The Centaur » ainsi qu’avec deux titres au format digital sur Bandcamp sortis le même jour.
DIRA MORTIS - "Ancient Breath Of Forgotten Misanthropy"
Ne prenons pas de chemin détourné pour caractériser ce dont nous allons parler ici. Il sera question de death metal, du vrai, du lourd, du cru, du qui vient d’Europe de l’Est et plus précisément de Pologne. Dira Mortis a déjà quelques années au compteur puisque le groupe s’est formé en 1998. Les premières années et les premières timides sorties du groupe le feront quelque peu passer sous les radars, ce qui explique leur arrêt d’activité en 2004. Un retour en 2011 sera synonyme de nouveau départ pour la bande (composée entre autres par d’anciens membres de Christ Agony ou encore Graveland) puisqu’à partir de cette époque les choses sérieuses commenceront avec notamment la sortie de leur premier véritable album en 2012, « Euphoric Convulsions », suivi en 2015 de « Psalms Of Morbid Existence » ayant reçu, en son temps, un accueil critique tout à fait louable. « Ancient Breath Of Forgotten Misanthropy », qui nous occupe ici, est donc leur troisième disque et le premier sur le très recommandable label polonais Selfmadegod Records. Attention, que ceux qui s’attendent à un renouveau du genre passent leur chemin. Ici, il n’est nullement question de réinvention ou de subtilité. Dira Mortis s’inscrit dans un death metal issu des écoles créées par les groupes tels qu’Incantation, Autopsy ou encore Immolation. Ça tabasse dans les règles, ça suinte, ça enchaîne les riffs, ça joue bougrement bien et ça respecte les traditions. Entre death brutal direct et parties plus techniques, tout bon client s’y retrouvera et pourra profiter de la production granuleuse qu’il chérit tant. Qu’on se le dise, le produit est de qualité même s’il ne surprend pas. Mais allons-nous perdre notre temps ici à entrer dans un débat stérile sur l’originalité ? Bien sûr que non étant donné que « Ancient Breath Of Forgotten Misanthropy » est typiquement le genre d’opus qui donne le sourire et nous fait dire que ces mecs ont tout compris malgré des morceaux qui, il faut bien le dire, tirent un poil en longueur.
AGE OF WOE - "Envenom"
Pour son troisième album, et accessoirement celui qui marque les débuts de la collaboration avec Lifeforce Records, Age of Woe accouche d’un album pour le moins bien équilibré. Officiant toujours dans un mélange de death, de crust-punk, de doom et de sludge, le quintette nous sert ici un album qui se veut direct tout en étant subtil. Si les gravats sont toujours au rendez-vous aussi bien dans le son de guitare que dans la voix éraillée de Sonny Stark (ndlr : seul membre originel restant), le sens de la mélodie n’est pas en reste comme en témoignent, par exemple, les interludes « Avgrunden » et « Förbittringen » ou encore le titre « Storm ». Un album à l’écoute duquel il semble difficile de s’ennuyer tant le groupe agence ses morceaux avec le relief nécessaire pour ne pas perdre l’auditeur en cours de route. Ce n’est pas parce qu’un titre saucé au punk démarre tambour battant qu’il ne peut pas s’octroyer un certain souffle au tempo modéré pour repartir de plus belle. « Envenom » développe un savoir-faire musical qui s’aventure dans des eaux peu habituelles. L’arrivée au poste de guitariste en 2019 de Keijo Niinimaa (chanteur de Rotten Sound) y est sans doute pour beaucoup puisqu’en plus de jouer, le bougre s’est chargé de la majorité de la production de l’album. Excepté l’enregistrement du chant, les prises de son et le mixage ont en effet été effectués par ses soins dans ses Chaotic Doom Cave Studios de Turku en Finlande. Au vu du résultat, on ne peut que saluer ce recrutement et vous conseiller vivement de vous plonger dans ce qui représente déjà l’une des toutes bonnes sorties de ce début d’année.
Ça a l’air grave - Jérémie
Souvent incompris, parfois même moqués, voire injustement critiqués, ils assurent pourtant un travail de l’ombre essentiel. Eux, ce sont les bassistes, les gardiens des fréquences graves. Ils sont la hantise des roadies et de leurs lombaires tant leurs amplis « frigos » pèsent leur poids et sont peu maniables, mais sont aussi et surtout des musiciens généreux au service de leur groupe ou de l’artiste qu’ils accompagnent. Rarement en recherche de gloire, ils ou elles se trouvent souvent en arrière-plan pour incarner, avec la batterie, la paire d’épaules sur lesquelles le reste du groupe pourra aisément s’appuyer. Une race à part au service du groove.
Pour inaugurer cette rubrique, Jérémie (Emptiness, Meat Heart, ex-Enthroned, ex-Unlocked, ex-Hybrid Viscery – producteur, ingénieur du son et fondateur du Blackout Studio à Schaerbeek) a gentiment accepté de se prêter au jeu dans la foulée de l’interview que nous avions faite de lui à l’occasion de la sortie de l’album « Vide » d’Emptiness (Interview à retrouver dans le Metal’Art 7).
Comment en es-tu arrivé à jouer de la basse ? C’est mon grand frère qui m’a fait découvrir la musique. Il écoutait du metal et jouait de la guitare. Il m’a fait connaître ce genre de musique assez tôt et me poussait à « jammer » avec lui. C’est lui qui m’a proposé de jouer de la basse. Je devais avoir 10 ou 12 ans.
As-tu un rapport particulier avec cet instrument ? Oui. Je sens que c’est vraiment mon instrument. Mais par contre, je ne me considère pas comme un bon musicien. Je ne suis pas du genre à prendre une guitare ou une basse chez moi et jouer comme ça. Je prends l’instrument par nécessité pour composer. Par contre, la basse est l’instrument que je comprends le mieux, mais c’est aussi celui que je mets le plus de temps à enregistrer puisque je prends le temps justement de trouver la bonne ligne de basse toute simple et « catchy » qui soutient tout le morceau. C’est assez dur finalement. De plus, je trouve que c’est un instrument très dynamique, contrairement à ce qu’on lui demande d’être en règle générale, à savoir quelque chose de solide. Le son vient au final de plein de petits éléments, pas entièrement de l’instrument ni de l’ampli. C’est tellement sensible que parfois pour avoir la puissance que tu veux, tu te dois d’être doux avec ta basse puisque l’intention que tu veux traduire ne sera pas forcément ce que tes doigts vont apporter.
Quel est pour toi le rôle prépondérant de la basse ? Qu’est-ce qu’un bon bassiste pour toi ? Le réflexe serait de dire que la basse est le lien entre la rythmique et la mélodie. Et c’est vrai qu’un bon morceau est un morceau qui a une bonne ligne de basse et où tout tourne autour d’elle.
C’est un travail de l’ombre ? Oui, mais ça va avec le caractère des musiciens. Les bassistes ne sont généralement pas des « m’as-tu-vu ? ». Par contre, il y a cette sensation quand tu joues en groupe et que tu sens que ta basse a bien sa place. Ça fait quelque chose de sentir cette connexion avec la grosse caisse. Il y a aussi cette sensation quand tu joues sur ta basse et qu’elle n’est pas branchée. Tu ne l’entends pas, mais tu ressens les vibrations et donc tu l’entends autrement.
Qu’est-ce que tu penses des délires humoristiques qui entourent les bassistes et qui font passer la basse pour un instrument simple, voire simpliste, ou encore qui ne sert pas à grand-chose puisqu’il ne se distingue pas toujours ? On entend ça surtout chez les personnes qui écoutent du metal ou du rock tout simplement parce que la basse n’y a pas un impact aussi direct que dans le funk ou dans le jazz. J’imagine que dans le monde du funk, ces blagues se font moins (rires). Maintenant comme je ne me sens pas spécialement uniquement bassiste, ça ne me fait pas spécialement marrer, mais ça ne me dérange pas non plus. Ça me laisse un peu indifférent au final. (Rires)
Tu joues davantage à l’onglet ou aux doigts ? Sur le dernier album, je joue aux doigts, mais j’étais plus un joueur à l’onglet avant parce qu’on jouait plus rapidement et on avait envie de ce genre d’attaque. Mais maintenant, je trouve ça plus chouette de jouer aux doigts. C’est pareil pour la guitare, parce que j’en joue pas mal sur le dernier album. C’est une manière de sentir l’instrument. Maintenant, notre album est très doux d’une certaine manière. Il n’y a aucune distorsion donc ça va avec, parce que tu ne peux pas toujours te permettre de jouer aux doigts évidemment.
Tu voudrais bien nous présenter brièvement ton matériel et nous parler un peu de tes techniques ou de tes petits « secrets » de jeu si tu en as? Je joue sur une Ernie Ball Stingray quatre cordes. Mon ampli est un vieux Marshall full tube Superbass, pas spécialement puissant, mais il sonne très bien. Je n’ai pas vraiment de secrets si ce n’est qu’on a toujours tendance à dire que la basse doit être compressée, alors que pour moi, le compresseur devrait être toi en jouant. C’est comme ça qu’elle sonne ta basse. On croit toujours qu’il faut constamment mettre le compresseur sur la basse parce qu’on se dit que ça doit être quelque chose de constant qu’on ne doit pas chercher à l’oreille et donc on lui enlève sa dynamique. Alors que ta basse sera énorme si tu apprends à la jouer en tenant toi-même le rôle du compresseur.
C’est assez intéressant, mais c’est une vision spéciale pour un ingénieur du son de se dire que le tout sonnera mieux s’il y a moins d’intervention de sa part après, non ? Non parce que pour un ingé son, c’est toujours une perte d’ajouter quelque chose pour compenser ce qui n’aurait pas été fait en amont.
Tu utilises de la distorsion ? Tout dépend du projet sur lequel je suis. Pour le dernier album d’Emptiness, comme on voulait être le plus naturel possible, c’était la basse directement branchée dans la carte son, même pas dans un ampli. Mais il y a tout de même eu un peu de « disto » sur l’un ou l’autre morceau, mais je serais incapable de te dire ce que j’ai utilisé.
Il y a des bassistes que tu apprécies particulièrement, qui t’influencent ou t’ont influencé ? Je n’ai jamais vraiment vénéré quelqu’un. J’aime les bonnes lignes de basse, mais je ne vais pas chercher plus loin. Je ne saurais pas vraiment te dire qui est mon bassiste préféré. J’ai aussi un rapport assez bizarre avec la musique de ce côté-là. J’aime les groupes, j’adore la musique, mais je me fous un peu du nom des personnes, de qui est derrière quel instrument. Ça se limite à la musique et à la pochette.
Un grand merci Jérémie. Merci à toi, c’était cool.

TERMINAL BLISS - "Brute Err/ata"
Sorte de super-groupe formé de membres de Pg. 99, Mammoth Grinder ou encore Iron Reagan, les Américains de Terminal Bliss s’inscrivent dans la pure tradition punk. Mis sur pied au tout début de l’année 2020, le quatuor propose ici un premier album (ou plutôt EP puisque la durée totale est de moins de onze minutes pour dix titres) qui fleure l’urgence propre au style. Riffs basiques, mais justes et production un tantinet crade, mais pas trop non plus. Terminal Bliss maîtrise son sujet et sonne comme il doit sonner dans l’optique de perpétuer un style qui, de temps à autre, se rappelle à notre bon souvenir et qu’on réécoute sans déplaisir. C’est sûr, c’est vite empaqueté et ça ne transcende rien, mais comme, il faut bien le dire, ce n’est pas trop mal foutu. On offrira volontiers une dizaine de minutes d’attention à « Brute Err/ata » en attendant que Terminal Bliss propose un petit quelque chose en plus la prochaine fois.
SUPRUGA - "Хаос / Никто не в безопасности"
Formé en 2016, ce quatuor russe pourrait bien sortir de l’anonymat et obtenir l’exposition qu’il mérite. Voilà qui ne devrait pas déplaire aux oreilles averties en quête de sonorités différentes puisque Supruga officie dans un registre black sludge auquel une couleur hardcore se greffe de temps à autre. Le tout exécuté et produit avec une certaine maestria. Nous voici donc face à un album où furie et lourdeur font bon ménage. Une richesse musicale loin d’être en reste et à côté duquel il aurait été dommage de passer. Pourtant, si l’on en croit les différentes informations glanées sur le groupe, c’est ce qui aurait pu vraisemblablement arriver si le « nouveau » label Petrichor (rejeton de Hammerheart - ndr) n’avait pas flairé le filon. En effet, si la sortie qui nous occupe ici date de fin 2020, il s’agit en fait d’une part, du premier album du groupe, « Xaoc », sorti en 2019, et d’autre part du dernier EP « Никто не в безопасности » (« Nul n’est à l’abri », d’une traduction libre – ndr). Tous deux édités en cassette et limités respectivement à 40 et 30 copies via le label russe NIOS. Autant dire que les formats CD, LP et digitaux prévus par la maison de disques néerlandaise permettront une diffusion un poil plus large d’un album et d’une formation particulièrement dignes d’intérêt.
NOTHING - "The Great Dismal"
Les Américains de Nothing et leur leader Domenic Palermo ont fait pas mal parler d’eux en dix années d’existence puisque beaucoup parlent du groupe comme d’un renouveau du shoegaze, rien que ça. Mais pourrait-on leur donner tort à l’écoute de ce quatrième album qui fait montre d’un sens inné de la mélodie et de l’ambiance ? Atmosphérique, ténébreux, lourd et cinématographique sont des qualificatifs qui semblent coller à merveille à « The Great Dismal ». Le tout pourrait d’ailleurs être synthétisé dans les deux premiers titres de l’album tant ils contiennent la plupart des séduisants ingrédients avec lesquels Nothing aime travailler. Le morceau d’introduction « A Fabricated Life » et la sensibilité qui s’en dégage ainsi que « Say Less » et ses basses saturées pour encore mieux relever les nappes de guitares mériteraient tous deux leur place dans des bandes originales de films ou de séries. Le travail de composition, de mise en place et de productions est à saluer tant l’agencement de l’ensemble offre à l’auditeur un véritable petit voyage sonore dans les méandres d’un style qui regorge encore de surprises à coup sûr.
Une superbe découverte pour votre serviteur.
GRID - "Livsleda"
Formé en 2014, les Suédois de Grid officient dans un Grindcore teinté de crust D-Beat et dans lequel un certain sens de la mélodie a sa place. C’est avec ce style affirmé et indubitablement maîtrisé que le groupe est entré il y a peu dans l’écurie polonaise Selfmadegod, et ce afin de sortir ce que le label présente comme son premier véritable album. Et si au départ, les 9 titres et 17 minutes à peine de « Livsleda » font penser à un EP de plus, reconnaissons que l’ensemble est si dense et complet qu’il n’est pas du tout difficile de considérer cette pièce au même titre qu’un album à part entière. La production compacte et puissante offre à l’auditeur le confort requis pour apprécier ce Grindcore de haute voltige qui n’hésite pas à s’aérer avec des morceaux davantage mélancoliques (osons les mots) comme « Livsleda » ou « Doomed » et leur lot de riffs qui « transportent ». À découvrir d’urgence.
COLLISION - "The Final Kill" (EP)
Pour le coup, on pourra dire qu’on aura suivi l’adage qui dit « Mieux vaut tard que jamais » puisque c’est avec un retard quelque peu significatif que nous traitons ce nouvel EP des Bataves de Collision sorti sous la houlette du label allemand Hammerheart le 17 avril dernier. Déjà vingt ans que le groupe existe et écume la scène avec son mélange de grindcore et de thrash qui n’a pas pris une ride au fil des sorties. La furie est toujours au rendez-vous et surtout, le groupe parvient à insérer du relief dans sa musique pour éviter la monotonie. On ressent alors toute la maîtrise d’un groupe qui fonctionne désormais depuis de nombreuses années avec les mêmes musiciens. En effet, seul le bassiste n’est pas un membre d’origine et n’est là « que » depuis 2005. Paramètre pour le moins intéressant si les gaillards recherchaient une certaine osmose. On en prend donc pour notre grade encore une fois tout au long de ce petit quart d’heure et de ces sept titres seulement, mais qu’on ne manquera pas s’enfiler deux fois de suite. « The Final Kill » est donc un petit concentré de puissance qui fait un bien fou.
Formé en 2018, année durant laquelle il a sorti son EP « Universal Hate Speech » déjà chez Shadow Records, le duo polonais Terrestrial Hospice revient cette fois avec son premier véritable album sous le bras. Bien sûr, l’épreuve n’est qu’une formalité au vu du CV des 2 bougres puisque le batteur n’est autre qu’Inferno, cogneur chez Behemoth, et celui qui se charge du reste est Skyggen, apparu dans bon nombre de formations et notamment pour assurer des lives pour Gorgoroth, Aeternus ou encore Dead To This World. Autant dire que les camarades savent de quoi est fait un album de black metal et qu’ils appliquent la recette avec maîtrise. Seulement voilà, ils ne font que cela et n’apportent pas grand-chose de plus à un style déjà surchargé en albums de ce type. Musicalement, les 7 titres s’écoutent sans déplaisir et représentent un hommage de fort bonne facture à la seconde vague du black metal du milieu des années 90 mais il semble clair que cet opus serait peut-être passé bien en dessous des radars s’il n’avait pas pu capitaliser autant sur les noms des musiciens qui lui ont donné vie.
PROTOSEQUENCE - "A Blunt Description Of Something Obscene"
S’il fallait décerner un prix qui récompensait la vélocité, la technicité ou le nombre de riffs joués à la minute, les Canadiens de Protosequence tiendraient très probablement le haut du panier pour cette année tant le quatuor exécute son death ultra technique avec une facilité déconcertante, voire écoeurante, pour plus d’un musicien. Formé en 2014, le groupe propose ici son 3e EP via Lacerated Enemy Records. Il y a évidemment bien des choses à dire sur cette nouvelle pièce tant le savoir-faire transpire de chaque note exécutée avec une précision presque plus que chirurgicale et servie par une production presque trop propre pour être vraie. Tout d’abord, les 4 compères, s’ils se complaisent dans un style virtuose, ne semblent pas avoir oublié d’intégrer de la musicalité dans ce « A Blunt Description of Something Obscene » grâce à quelques parties plus aérées. Ensuite, bien que cela soit étrange, on a l’impression de palper l’amusement d’une bande de musiciens hors pair qui prennent un véritable pied à jouer leurs parties hyper chiadées. Enfin, le côté « plus carré que ça, tu meurs » absolument nécessaire dans le style est forcément bien présent et joue un rôle prépondérant dans la claque que se prend l’auditeur. Mais si l’œuvre en elle-même impressionne par la maîtrise dont font preuve les musiciens, il faut bien avouer qu’un tel déluge technique incessant donne très rapidement l’impression que l’album est interminable… Et qu’il se répète. Car non, malgré ses 8 titres et sa durée qui avoisine les 45 minutes, « A Blunt…. » n’est pas un album, mais bien un EP 4 titres (comme leurs 2 précédents sortis en 2016 et 2017) à la différence qu’ici, figurent les morceaux ainsi que leurs versions instrumentales. Avouons que la démarche est peu banale et que la question de son utilité se pose inévitablement, car ce n’est pas non plus comme si Protosequence offrait un style musical propice au karaoké. Le genre d’opus à ranger probablement dans la case des sorties réservées uniquement aux musiciens les plus aguerris.
NORD - "The Only Way To Reach The Surface"
En règle générale, une sortie estampillée Klonosphere annonce qu’on se promènera hors des sentiers battus. Ce postulat se vérifie encore ici avec le second album des Parisiens de Nord. « The Only Way To Reach The Surface » se joue des codes pour amener l’auditeur dans un univers musical d’une bluffante richesse. Voyageant avec une aisance incroyable parmi une vraie collection de styles, le groupe semble mettre ses influences en avant, mais en n’oubliant pas de montrer qu’il les a très bien digérées tant l’ensemble paraît superbement cohérent. C’est ainsi que tout au long des 9 titres, on passe comme si de rien n’était d’une électro vintage au mathcore via des parties black, pop ou encore jazz expérimental. Mais toujours avec cette ambiance lourdement propre (ou proprement lourde, c’est selon) servie par l’excellent travail de production de Clément Decrock du Boss Hog Studio (Morpain, General Lee…). Bien sûr, tout cela ne serait rien sans un travail musical titanesque en amont. Et le quatuor en est conscient. Sa maîtrise instrumentale en témoigne notamment avec une section rythmique délivrant un groove impeccable rendant parfaitement justice aux compos. Une solide découverte donc.
CONSTELLATIA - "The Language Of Limbs"
Sorti initialement en novembre 2019 (selon les sources Bandcamp), Constellatia voit son premier album réédité via Season Of Mist. Et en voilà une idée qu’elle est bonne, car non seulement ce que proposent les Sud-Africains colle admirablement avec la politique du label, mais il faut avouer qu’il serait bête de se priver de ce « Language Of Limbs » qui recèle une certaine richesse. Fruit de la collaboration entre Gideon Lamprecht de Crow Black Sky et Keenan Oakes de Wildernessking, Constellatia officie dans la même catégorie que les projets initiaux de ses géniteurs, à savoir un post black atmosphérique et progressif d’une beauté certaine. Au fil des 4 plages de cet album, toutes liées entre elles, le groupe nous plonge dans un univers fait de mélancolie, d’obscurité et de mélodies, mais sans oublier la puissance. Cet album est, semble-t-il, l’illustration sonore de lourdes années endurées par les principaux membres du groupe et représente donc une solide catharsis qu’ils ont bien fait de partager. Dans un registre comparable à Wolves In The Throne Room ou encore Shining, Constellatia est une découverte particulièrement intéressante.
THE ALLIGATOR WINE - "Demons Of The Mind"
Cher lecteur, je me dois de te conter une histoire, celle de la découverte de l’album dont je m’apprête à te parler et de la bêtise que j’ai failli faire après seulement 2 titres en ayant l’intention de lui octroyer une note en dessous de la moyenne. Mais les découvertes musicales étant ce qu’elles sont, toi comme moi savons que la surprise peut surgir de partout pour autant qu’on soit ouvert et qu’on ait la faculté de reconsidérer ses avis primaires qui manquent souvent du recul nécessaire. Et c’est justement ce qui est arrivé ici avec ce premier opus des Allemands de The Alligator Wine. Ce jeune groupe, créé en 2016, a la particularité d’être un duo formé d’un batteur et d’un claviériste qui se partagent également les voix. Oui, tu as bien lu, batterie et clavier uniquement. Ce qui veut dire pas de guitare ni de basse (un clavier Moog Bass se charge des fréquences graves si tu veux tout savoir) donc des manquements béants pour un groupe présenté comme rock psychédélique. Et c’est peut-être là qu’a résidé ma première erreur, m’attendre à un énième ersatz de tout ce qui a pu être proposé ces dernières années en matière de groupes se disant grandement influencés par les 70’s. C’est ainsi que durant les premières minutes d’écoute, la sauce ne prend pas et un faux sentiment de lassitude me gagne, sentiment agrémenté d’une impression de prétention de la part des musiciens, seconde erreur de ma part puisque The Alligator Wine ne fait que jouer avec les ingrédients du passé, mais aussi du présent (pop rock, voire electro, pour l’accroche) histoire de proposer sa propre recette. Me voilà donc petit à petit en train d’apprivoiser ce « Demons Of The Mind » qui m’apparait finalement comme une découverte tout à fait surprenante tant l’originalité et le talent transpirent des neuf morceaux qui le composent. Le groupe se dit influencé autant par le rock que par les musiques de film et cela se traduit par un sens de la mélodie et de l’atmosphère assez bluffante sur l’ensemble de l’album qui compte aussi bien des morceaux groovy (« Shotgun », « The Flying Carousel »…) que mélancoliques (le très beau « Lorane » et ses nappes à la Zack Hemsey). Repéré rapidement par la grosse écurie Century Media après seulement un EP 2018, le duo frappe un grand coup avec ce premier album à côté duquel, cher lecteur, j’ai failli passer. Il fallait donc que je t’en parle.
REVENGE - "Strike.Smother.Dehumanize"
Amateurs de mélopées, vous pouvez allègrement passer votre chemin puisqu’il n’en sera aucunement question dans ces lignes. En effet les chefs de file canadiens du war black metal sont de retour et les concessions ne semblent toujours pas figurer dans leur agenda. L’auditeur se trouve toujours pris en tenaille dans une mixture alliant black et death outrageusement chaotiques et quelque peu désaccordés relevée d’une bonne rasade grind en matière de voix tantôt hurlées tantôt pitchées. Revenge reste le groupe qui saura accompagner vos moissons de champs de crânes en char d’assaut et n’a pas encore décidé de changer son lance-roquettes d’épaule si ce n’est au niveau de la production qui permet maintenant de distinguer davantage les riffs qui, auparavant, n’avaient tendance à rester qu’au stade de bouillie inintelligible. Tout ça ne veut bien sûr pas dire que le groupe a répondu aux sirènes de l’exécution musicale policée. La seule chose qui lui reste propre est sa démarche hautement respectable et l’intégrité dont il témoigne depuis maintenant 20 ans. Cette nouvelle offrande est sale et méchante, point à la ligne.
ANTIMOZDEBEAST - "The Red River"
C’est dans un univers dérangé et dérangeant que nous convie Gabriel Palacio, cerveau du projet floridien Antimozdebeast. Et une chose est sûre à propos de lui lorsqu’on effectue quelques recherches, c’est que le bougre ne chôme pas puisque « The Red River » représente ni plus ni moins que sa troisième sortie sur Bandcamp rien qu’en 2020 et sa quatrième depuis mai 2019. Mais il ne s’arrête pas là puisqu’à l’heure où nous rédigeons ces lignes, un autre EP a déjà vu le jour sur la célèbre plateforme de streaming. Alors bien sûr, certaines mauvaises langues pourront se dire que sortir de l’électro noise sur le net à un rythme effréné n’est probablement pas compliqué quand on se débrouille un tant soit peu avec ses machines, mais Antimozdebeast fait davantage en instaurant une réelle ambiance par ses « riffs », ses fonds et ses hurlements souvent sursaturés. Nous sommes donc ici au-delà de la simple ponte de morceaux sans intérêt ayant pour simple objectif de remplir un profil sur le net. Il y a de l’idée chez cet artiste bercé aux Nine Inch Nails, Skinny Puppy et fan de The Body ou encore Author & Punisher. Rien que cela mérite qu’on y jette une oreille, et ce, même si la production ou la finition ne sont pas encore totalement au rendez-vous.
PYRRHON - "Abscess Time"
Depuis ses débuts, Pyrrhon a bien fait comprendre qu’il n’était pas le genre de groupe à entrer dans le moule et ce n’est certainement pas ce quatrième opus qui changera la donne tant ce dernier n’est pas à mettre entre toutes les oreilles. Bien loin d’une démarche musicale élitiste, le quatuor de Brooklyn continue son bonhomme de chemin à travers ses expérimentations (improvisations ?) dédiées à un death metal noisy hyper technique et lourd à souhait l’amenant même parfois vers des mesures à la limite de la cacophonie. Amateurs de prouesses techniques, « Abscess Time » saura sans doute vous ravir pour autant que vous vous y prépariez, car ne croyez pas être ici face à un brutal death à la Obscura ou Abysmal Dawn où chaque note pourrait être décortiquée tant la production est propre. Non, Pyrrhon choisit clairement son camp et officie dans un registre bien plus cru et old school au niveau du son, bien plus proche d’un Immolation des débuts. Un album pour musiciens diront sans doute certains. Nous pencherons plus ici pour une œuvre à la démarche artistique honnête. Un véritable ovni confectionné avec les tripes. Toutefois, même si la prise de risque fait l’objet d’une certaine admiration de la part de votre serviteur, celui-ci ne saura pas nier la difficulté d’entrer véritablement dans le délire et ce à cause du manque d’accroche dont « Abscess Time » lui a semblé faire preuve.
LIVING GATE - "Deathlust" (EP)
Fruit de la collaboration entre Wim Coppers (Oathbreaker, Wiegedood), Levy Seynaeve (Wiegedood, Amenra), Lennart Bossu (Amenra, Oathbreaker) et Aaron Rieseberg (YOB), Living Gate est, sur le papier du moins, un groupe formé par des musiciens plus qu’aguerris. Et ce qu’il y a de bien dans l’histoire, c’est que le papier ne ment pas. Réunis autour de leur amour du death metal aussi bien classique que plus contemporain, les 4 camarades proposent, en guise de premier jet, ce « Deathlust » de fort bonne facture. Le plaisir ne se boude pas dans ce cas-là puisque le quatuor offre à l’auditeur un subtil (le mot est peut-être mal choisi) mélange d’old school et de moderne en ce sens que ces 5 titres sont inspirés et techniques sans jamais tomber dans le démonstratif à outrance, mais également bourrés de passages accrocheurs qui tabassent les esgourdes dans les règles. Le tout enrobé dans un bien bel emballage sonore où la part belle est faite à une section rythmique qui prend son pied et des guitares à la saleté si séduisante sans tomber dans le crade complet et inaudible. Vous l’aurez compris, tout est mis en œuvre pour que ce « Deathlust » fleure le cuir et la sueur et entretienne les bonnes traditions.