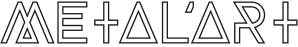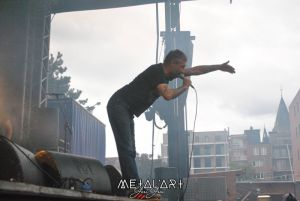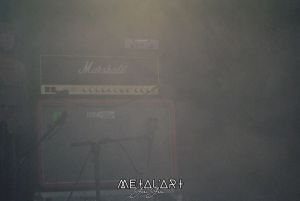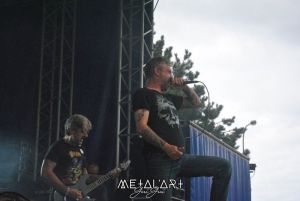GuiGui
LOVGUN - "Bon Shit Bon Genre"
C’est un melting pot assez intéressant que nous proposent ici les Français de Lovgun pour leur petit dernier. Ce groupe actif depuis 2011 et comptant dans ses rangs des membres entre autres de Warfuck ou Hordure développe une espèce de mélange entre powerviolence, fastcore et punk, le tout aux bons relents « do it yourself ». En effet, pas de surenchère ici en matière de production. « Bon Shit Bon Genre » se veut brut avec des passages donnant même une impression d’improvisation. Une authenticité qui va de pair avec un savoir-faire rythmique d’un niveau assez élevé. C’est d’ailleurs peut-être là que votre serviteur aura été quelque peu perdu par moment malgré sa passion pour le genre. En effet, si la rage se fait ressentir tout au long de ce mini-album (20 titres dont le plus long affiche 00’54’’ au compteur), certains morceaux ou enchaînements pâtissent d’un manque d’accroche. À peine le temps d’assimiler un riff qu’on passe au suivant, ce qui peut engendrer une certaine frustration. Bien sûr, il y a fort à parier que ces sentiments ressentis découlent d’une volonté de base du groupe de ne pas s’attarder en chemin tant ils ont des choses à dire. En cela, la démarche est réussie. Une découverte à faire pour des oreilles déjà rompues à l’exercice.
WHORESNATION - "Dearth"
Depuis ses débuts en 2009, Whoresnation a laissé bien plus qu’une simple marque dans le paysage grindcore français puisque les Bisontins ont rapidement mis tout le monde d’accord et continuent à le faire d’ailleurs. Véritable machine toute aussi efficace sur disque que sur scène, le groupe brille par la richesse de ses sorties renfermant toutes de véritables perles de compositions grind matinées de death metal et au son délicieusement old school. Après les albums salués « Whoresnation » (2012), « Mephitism » (2018) et un bon paquet de splits et EP’s, Whoresnation revient avec un « Dearth » d’une qualité indéniable et faisant passer l’examen du 3e album avec mention. Avec un virage Death metal assumé mais qui ne met jamais à mal la base grindcore de la bande, ce dernier opus est encore une fois une collection de riffs du plus bel effet posés sur le lit d’une section rythmique aux reins diablement solides. Ajoutez à cela la production issue du Disvlar Studio (Blockheads, Eastwood…), connu pour mettre le grain qu’il faut là où il le faut, et vous obtiendrez un album savoureux, riche et subtil à sa manière. À écouter mais aussi à voir en live si l’occasion vous est donnée.
HIV - "The Bright Side Of Everything"
Nous étions quelque peu passé à côté de ce second album des Polonais de HIV qui sortait en début d’année. Que voulez-vous ? On ne peut pas être partout. Mais si les lignes que vous lisez en ce moment sonne bien comme une séance de rattrapage (pratique assez courante pour votre serviteur, soit dit en passant), c’est que le jeu en vaut peut-être la chandelle si vous aimez le grindcore qui fait la part belle à ses racines punks tout en y insufflant des variations de (très) gros death metal. Le programme est assez simple : 18 morceaux brefs et directs qui respectent les traditions et alternent joyeusement blasts et passages crust mid-tempo, le tout sur fond de lourdeur abyssale servie par une production rocailleuse à la Nails. Avouez que rien que sur le papier, ce trio a de quoi séduire l’auditeur averti. Ça tabasse sévère et ce juste le temps d’un café, ce qui laisse l’occasion de s’enfiler le disque 2 voire 3 fois d’affilée. Aucune subtilité et c’est tant mieux. Si vous aimez la sensation délicate du bloc de béton envoyé à bonne allure dans le coin du faciès, alors « The Bright Side Of Everything » est peut-être fait pour vous.
Ça a l’air grave - Jason
Souvent incompris, parfois même moqués voire injustement critiqués, ils assurent pourtant un travail de l’ombre essentiel. Eux, ce sont les bassistes, les gardiens des fréquences graves. Ils sont la hantise des roadies et de leurs lombaires tant leurs amplis « frigos » pèsent leur poids et sont peu maniables, mais sont aussi et surtout des musiciens généreux au service de leur groupe ou de l’artiste qu’ils accompagnent. Rarement en recherche de gloire, ils ou elles se trouvent souvent en arrière-plan pour incarner, avec la batterie, la paire d’épaules sur laquelle le reste du groupe pourra aisément s’appuyer. Une race à part au service du groove.
Dans la foulée de l’interview qu’il nous avait accordée pour le MA15 (téléchargeable gratuitement via ce site, faut-il vous le rappeler ?), le chanteur et bassiste de Misery Index, Jason Netherton, a bien voulu répondre à quelques questions concernant son instrument de prédilection. Entretien à l’image d’un bon jeu d’instrument à grosses cordes : simple et efficace.
Comment en es-tu arrivé à jouer de la basse ? C’était à la fin des années 80. Jeune, j’ai grandi dans le Maryland et beaucoup de metalheads s’essayaient aux instruments. C’était souvent la guitare et la batterie mais pour ma part, j’ai voulu essayer la basse et je pense que c’était peut-être à cause de Steve Harris d’Iron Maiden. Ce mec rendait la basse cool. Il était tellement en avant que ce soit sur scène ou dans le mix que ça donnait l’impression que c’était une sorte d’arme secrète du groupe. Je me suis finalement rendu compte que cet instrument collait davantage à ma personnalité. Donc j’ai commencé à prendre des cours et j’ai joué dans un groupe de metal local.
Pour toi c’est quoi un bon bassiste et/ou une bonne ligne de basse ? C’est un peu un exercice d’équilibriste. Si je prends mon cas, ce que je fais est relativement « rigide ». Il n’y a pas beaucoup d’espace pour ce qu’on pourrait appeler de l’expérimentation si tu veux. C’est juste notre style. On joue une sorte de hardcore infusé au death metal californien. Pour moi le mieux est avant tout de voir comment tu peux servir le morceau pour qu’il sonne du mieux possible. Tu dois faire attention à la puissance mais tu dois aussi surtout être attentif et à l’écoute du jeu de tous les autres instruments tout en sachant que la basse joue principalement avec la batterie. Tu dois absolument coller à l’espace qui t’est dédié. Le principal n’est pas de te montrer mais d’être au service de la chanson et d’insérer dans cet espace ce qui est nécessaire. C’est tout ce que je peux te dire (rires).
Par rapport à la batterie justement, comment décrirais-tu la relation musicale qu’Adam et toi avez dans Misery Index ? Disons que dans ce qu’on fait on a des genres de « templates ». La plupart du temps on suit la guitare mais dans certains passages il y a justement plus d’espace pour que les choses s’ouvrent un peu. Adam et moi pouvons créer certaines fondations rythmiques qu’on peut tenir ensemble. Adam a toujours été un batteur qui occupait le terrain mais ces dernières années, il s’est un peu retenu et ça me laisse un peu plus de place. En tout cas, on bosse bien ensemble.
Depuis 2021 tu as un deal avec la marque Warwick. Tu peux nous parler du modèle Streamer que tu utilises ? J’ai une Streamer classique et un modèle custom allemand. J’utilisais des ESP auparavant. Mais lors de la dernière tournée que nous avons faite avant le COVID avec Napalm Death, Shane (Embury) m’a fait accrocher à Warwick (le bassiste de Napalm Death est endorsé par la marque depuis de nombreuses années – ndr). J’ai commencé à m’y intéresser et j’ai beaucoup aimé ce que la marque proposait. Shane m’a introduit auprès d’eux et ça s’est fait comme ça.
05.03.22 - In Theatrum Denonium
C’est dans le très classieux théâtre de Denain que nous avions rendez-vous le 05 mars dernier pour le festival d’un jour In Theatrum Denonium organisé par l’association Nord Forge. Un cadre chic pour une musique qui ne l’est pas toujours et ce pour notre plus grand plaisir. Mais le décalage entre l’endroit et ce qui y était proposé a clairement eu l’effet escompté pour ce 6e acte qui arrivait à point nommé après une édition 2021 reportée pour des raisons sanitaires qu’il n’est plus nécessaire de détailler. Compte-rendu.
Ce sont les Grenoblois d’Aluk Todolo qui entamaient les hostilités. Une excellente idée pour débuter puisque le trio instrumental français emmène son public dans son univers où se mélangent en permanence noirceur, lourdeur mais aussi douceur. Fort de passages qu’on devine en totale improvisation, le rock occulte du groupe se montre maîtrisé de bout en bout. L’ambiance qu’il parvient à distiller sur scène est énigmatique. Avec un effet aussi simple qu’une ampoule trônant au milieu de la scène pendant le set, et avec laquelle le guitariste s’amusera en fin de concert, les 3 musiciens ouvrent le festival par une sorte de rituel auquel le spectateur peut s’inviter s’il le souhaite.
L’une des bonnes idées de la soirée aura été de faire jouer The Path Of Memory juste après, dans la petite salle située à l’étage et réservée au merchandising. Projet d’un vétéran de la scène black suisse, leader du groupe Borgne, The Path Of Memory nous donne rendez-vous pour une prestation intimiste orientée neo dark folk à la Death In June avec quelques bougies pour seul éclairage. Un moment suspendu et envoûtant qui ne manque pas de charmer un public amassé en nombre dans mais aussi hors de cette pièce pour grappiller quelques notes depuis le couloir.
Retour à la réalité. Les Suisses de Bölzer ayant dû annuler leur venue, ce sont les Nordistes de Hats Barn qui auront eu la lourde tâche de les remplacer au pied levé et de fouler les planches du théâtre pour distiller leur black metal crasseux. Si les décors et la mise en scène un peu kitchs ne laissent aucun doute sur la teneur musicale, celle-ci est on ne peut plus classique et malheureusement pas toujours parfaitement exécutée. Ajoutez à cela de multiples problèmes de son (pauvre batteur) et vous obtenez un côté bancal qui se fait ressentir tout au long du set. Le côté « true » voulu par le groupe (notamment par un chanteur dégoulinant de faux sang ou de corpse paints et portant fièrement chaînes et ossements sur lui ou sur son pied de micro) ne sauvera pas la prestation d’un certain ennui. Pas génial donc.
On attendait beaucoup mais pas autant de la formation suivante, Seth. Si les qualités des Bordelais sont connues et reconnues aussi bien en studio depuis leur premier album « Les Blessures de l’Âme » (1998) que sur scène, le groupe nous a encore une fois prouvé qu’il était un des piliers du black français. Fort d’une setlist faisant essentiellement honneur à leur dernier album en date, « La Morsure du Christ », Seth a ravi son public en offrant un concert majestueux, d’une précision quasiment chirurgicale sans être une simple reproduction de ce qu’il propose sur album. Les titres se voyaient dotés d’une réelle plus-value. Et même si une partie de la mise en scène finale voyant une muse à moitié nue se délecter d’un calice de sang aurait pu être passable, force aura été de constater que la forme générale et les différents jeux de lumières amenaient une réelle ambiance soufflant le chaud et le froid. Une réussite presque totale.
Pour la mise en place et le soundcheck, la tête d’affiche du soir, Taake, a fait évacuer la salle. Avec le retard pris dû à leur vol, cela aura malheureusement eu pour effet pour eux d’écrémer dès le départ une partie du public ayant préféré regagner ses pénates ou simplement écluser quelques verres au bar. Quoiqu’il en soit, l’assistance qui s’est présentée avait pris rendez-vous pour un concert de pur black metal des familles assaisonné de punk comme savent si bien le faire les Norvégiens. Ce côté punk qui sera d’ailleurs un peu plus présent qu’à l’accoutumée cette fois-ci de par l’état du chanteur qui aura, dans une certaine mesure, assuré le show à lui tout seul. En effet, dans un état second voire carrément troisième, peut-être dû aux longues heures d’attente à l’aéroport, le leader Hoest assure certes ses parties vocales d’une manière plus que correcte mais semble se demander à plusieurs reprises où il est, s’écroule parfois sur les moniteurs de retour ou encore manque de flageller aussi bien les spectateurs du premier rang que ses musiciens en jouant allègrement avec le câble de son micro. Musiciens qui d’ailleurs ne trouvent pas toujours ça drôle comme en témoigne de temps à autre l’attitude de l’un des guitaristes. Quoiqu’il en soit, le concert se passe et on se console en se disant que le côté parfois foutraque de la chose fait partie du style et du côté « je m’en foutiste » d’un musicien à la carrière longue comme le bras, ayant collaboré avec la moitié de la scène culte norvégienne et n’ayant plus rien à prouver à qui que ce soit. À la sortie de la salle, certains des fans de Taake sont absolument conquis, d’autres, comme nous, se disent que même si ça tenait la route, un peu moins d’alcool dans le sang aurait probablement délivré un surplus d’énergie qui n’aurait pas été déplaisant.
Malgré tout cela, notre bilan du 6e acte du In Theatrum Denonium (le premier pour nous) se veut positif. Un cadre décalé mais efficace, une organisation des plus sympathiques et sérieuses et de très belles surprises musicales nous font dire que nous y reviendrons sans déplaisir.
Texte : GuiGui et Greg
MASSIVE CHARGE - "For Those We Hate"
Honnêtement, l’idée de réentendre un jour un album de Massive Charge s’était quelque peu fait oublier. En effet, si 2011 avait vu la sortie de la véritable claque que représentait « Charge This World », et qu’on vous le conseille toujours ardemment, le groupe a été forcé de faire face à bon nombre de déconvenues (voir interview sur le site). Mais quand on a du caractère, laisser tomber n’est pas envisageable. Avec un line-up remanié, Massive Charge semble donc de retour avec sous le bras un « For Those We Hate » (sorti fin 2021, ne me jugez pas) qui reprend les choses là où « Charge This World » les avait laissées. Le quatuor délivre un grindcore sans aucune concession au travers de 17 titres à la furie aisément comparable à celle d’un Blockheads. Tout ce que l’auditeur est en droit d’attendre d’un album de ce style s’y trouve. Les riffs de Gino (guitare) se montrent inspirés malgré une dimension urgente, se voient gonflés par la basse ronflante et percutante d’Emy, et relevé par la batterie encore plus carrée qu’avant d’un Matthieu qui semble avoir mis à profit ces 10 dernières années pour travailler différents aspects de son instrument. Et que dire des voix ? Jérémy se montre toujours aussi vindicatif, mais est appuyé ici par des passages parfois hallucinants en backing (assurés par Emy) donnant un relief bienvenu. Sans habillage inutile, « For Those We Hate » annonce la couleur d’entrée de jeu avec « Listen Or Get The Fuck Out » avant d’enchaîner sur un « Swallow The People » aux accents de punk lourd qu’on retrouvera également sur « Teeth Breaking ». L’entièreté de « For Those We Hate » joue sur ces alternances grind-death-punk old school aux relents des anciens Misery Index ou Terrorizer pour se terminer sur un « This is not The End » au titre porteur de signification. Encore une fois, une claque et un album aux accents de nouveau départ, du moins c’est ce qu’on est en droit d’espérer.
Massive Charge
Incorrigibles comme nous sommes, mais néanmoins soucieux d’un éventuel effet promo à retardement, c’est seulement maintenant que nous vous proposons cet entretien avec Matthieu, fondateur, batteur et dernier membre originel de Massive Charge, à l’occasion du 3e album du groupe « For Those We Hate » sorti le 19 novembre dernier. Mais comme ils ont mis 10 ans à sortir ce nouvel opus et qu’en plus, ils sont bien éduqués, ils ne nous en voudront certainement pas de publier ce papier avec quelques mois de retard… enfin, on l’espère.
« Charge This World » est sorti en 2011 et votre nouvel album, « For Those We Hate » est seulement sorti fin 2021. Que s’est-il passé durant cette période de 10 ans ? Il s’est passé beaucoup de choses en fait. Déjà après « Charge This World », on a pas mal joué. En parallèle, Vinc (ex-guitariste) continuait à composer des trucs de son côté. Mais en 2015 il est parti. Il avait monté un projet thrash, commençait à apprécier davantage jouer ce style que du grindcore et avait aussi surtout le syndrome de la page blanche, il n’arrivait plus à composer. Donc on s’est séparés d’un commun accord. On voulait intégrer un peu de chair fraîche et c’est Jérôme Point, l’actuel guitariste de Loudblast, qui l’a remplacé. Mais Jérôme jouait à cette époque-là dans No Return, qui tournait pas mal, et donc ça avançait assez lentement. Ça a duré plusieurs années et quand il a intégré Loudblast, là on ne le voyait plus. Il se consacrait pleinement à ça et n’avait plus vraiment de place dans son planning pour Massive Charge. Donc il est parti et Vinc est revenu parce que ça lui manquait. Il est revenu une petite année, a composé quelques trucs et on avait aussi gardé des anciens stocks parce que Jérôme est parti avec tout ce qu’il avait écrit. On est donc repartis de zéro. Ensuite, même chose qu’en 2015, Vinc a dit qu’il n’y arrivait plus. Et il est reparti. On a auditionné quelques guitaristes par la suite, mais ça ne collait pas. J’en ai eu un peu marre de ne pas jouer parce que même si auparavant j’ai joué avec Kaliyuga, quand on a décidé de remettre Massive Charge sur les rails, j’ai quitté Kaliyuga, mais donc comme ça n’a finalement pas repris avec MC, je me suis retrouvé sans groupe. J’ai posté quelques annonces comme quoi j’étais un batteur qui cherchait un groupe de grind ou de death. J’ai été sollicité plusieurs fois dont une fois par Gino, donc l’actuel gratteux de MC. Dans un premier temps il m’a proposé un projet qui ne me tentait pas du tout. Et en parlant avec lui, il me dit qu’il n’a pas que ça et il me fait écouter un projet grind qu’il a sur le côté. Et il s’est avéré que ça sonnait exactement comme MC. Je lui ai donc proposé de mon côté en lui disant que plutôt que de partir sur un nouveau truc, moi j’avais quelque chose qui existait et que je voulais remettre sur pied. Il ne connaissait pas, mais quand je lui ai fait écouter, il m’a dit « banco ». On l’a auditionné et validé tout de suite et dès qu’il est entré dans le groupe, il a commencé à composer des tonnes de trucs. De ce fait-là, avec les anciens morceaux de Vinc et ce que Gino avait fait de son côté, on a rapidement eu de quoi faire un album. Il faut dire aussi qu’on lui avait envoyé des riffs en vrac que Vinc avait écrit et lui avait brodé autour pour achever les morceaux. En quelques mois l’album était donc composé. Concernant Ptiot à la basse, on a dû se séparer de lui pour des raisons internes et on a assez vite recruté Emy qui était la chanteuse de Kaliyuga parce qu’elle jouait aussi de cet instrument à côté et en plus il nous fallait quelqu’un capable de faire des backings, et elle a accepté.
Si je comprends bien, vous avez pas mal galéré, mais vous vous en êtes bien sortis quand même ? Oui parce qu’on a quasiment dû repartir de zéro, donc au final, on s’en sort.
Avant d’attaquer le sujet de votre nouvel album, j’aurais voulu revenir un peu avec toi sur les retours que vous aviez pu avoir à l’époque sur « Charge This World ». Tu peux nous en parler ? Ils ont été excellents. Ça nous a emmenés un peu partout. On a fait des tas de dates grâce à cet album notamment à l’Obscene Extreme (le festival grindcore le plus important en Europe – ndr), mais aussi un peu partout en Europe. On a aussi eu des chroniques un peu partout aussi notamment grâce à Charlélie Arnaud qui parlait de nous dans Rock Hard ou toi dans (feu) Hard Rock Magazine.
Je trouve intéressant qu’on ait abordé le changement de line-up plus haut, notamment au niveau de la guitare, parce qu’on retrouve dans ce nouvel album « For Those We Hate » l’identité et la singularité des compos qu’on pouvait déceler sur « Charge This World ». Et je me demandais comment vous étiez parvenu à conserver cela en changeant de compositeur. Quelle est la méthode ? Ben en fait c’est comme je te disais, quand il m’a fait écouter la première fois ce qu’il faisait dans son projet grind, ça sonnait à fond Massive Charge. Donc dès le départ je me suis dit qu’il avait la patte pour composer des trucs qui pouvaient nous correspondre. Maintenant c’est clair que comme je suis dans le groupe depuis le début, je connais les codes des compositions de MC donc je lui indiquais quels types de riffs devaient être joués et avec quels tempos. Je suis plus solfège que guitare et donc je lui donnais les types d’accords à jouer. Je lui ai précisé qu’il fallait justement garder cette identité, car on y tenait, mais après, je lui disais qu’il avait carte blanche pour y mettre sa patte. Il a très vite compris dès le départ et maintenant quand il nous envoie quelque chose qu’il a composé, généralement dès le départ c’est déjà validé à 80%. Il suffit juste de retoucher quelques petits trucs dans la structure, mais dans l’ensemble il a assimilé la manière de faire et se l’est même appropriée. Ça devient automatique.
Quand tu parles que vous vous envoyez des morceaux, ça veut dire que vous travaillez beaucoup à distance ou vous êtes assez proches géographiquement les uns des autres pour pouvoir vous voir régulièrement ? On est relativement proches. Disons que la plus grande distance qu’il peut y avoir entre 2 des membres, ça doit être une centaine de kilomètres donc ce n’est pas la fin du monde. Ce qui fait qu’on peut répéter. On est un peu éparpillés dans le Grand Est de la France, mais on n’est pas très loin non plus. Et on répète dans un endroit central par rapport à tout le monde. Mais pour ce qui est de la compo, Gino écrit des trucs dans sa tête (rires), il reproduit ça à la guitare et enregistre de son côté. Une fois qu’il a de quoi faire un morceau entier avec des riffs qui s’enchaînent bien, il nous l’envoie. On donne chacun notre avis. Généralement comme je le disais, on ne change pas grand-chose à part peut-être un peu la structure ou certains riffs. Et quand tout le monde a validé, on bosse chacun de notre côté et ensuite on se retrouve en répétition pour voir ce que ça donne en live. On essaie de se voir environ 2 fois par mois.
« For Those We Hate » comporte pas moins de 17 morceaux. Entre le moment où vous avez écrit les morceaux et celui où vous êtes entrés en studio, le travail a été rapide ou vous avez plutôt fait ça de manière posée ? C’est allé assez vite en fait…
… Gino est arrivé en 2020 ? Oui c’est ça, et Emy est arrivée 2 ou 3 mois après. Donc c’est allé assez vite parce qu’en mai 2020, j’étais en studio pour la batterie. Il y a eu le gros confinement du début de la pandémie et dès qu’on a pu ressortir un peu, je suis vite allé enregistrer mes parties. Ensuite on a été reconfinés.
On parlait avant des codes de compositions de Massive Charge. À ce propos, comment tu décrirais ce que vous voulez transmettre musicalement ? Au niveau du style, si c’est de ça dont tu parles, ce serait un savant mélange de Napalm Death et de Misery Index pour certains riffs avec aussi tous les papas du grind, Terrorizer, Brutal Truth… On essaie juste de ne pas tomber dans la copie ou la redite parce que ce ne serait pas marrant et n’aurait surtout aucun intérêt. Finalement, ce qu’on essaie de faire c’est du Napalm Death en un peu plus brutal.
Et au niveau des textes, c’est toujours le chanteur qui s’en charge ? Oui c’est lui qui écrit quasiment tout. Ici j’ai écrit des paroles pour un morceau, mais pour le reste c’est Jérémy qui s’occupe de tout. Maintenant pour être franc, on n’attache pas énormément d’importance aux textes parce qu’au final on enfonce presque des portes ouvertes. On parle des dérives de la société, de ce qui va mal, des abus de pouvoir … mais ça ce sont des trucs dont parlent presque tous les groupes de grindcore. D’autres groupes ont un côté engagé que nous on n’a pas parce qu’on ne veut pas faire de politique avec notre musique. En même temps, ce sont des textes qui collent bien avec la musique qui va derrière et puis ce sont des trucs que pense Jérémy. Mais en gros, on n’essaie pas de faire quelque chose d’ultra chiadé, il faut que ce soit direct.
Le titre de l’album « For Those We Hate » est adressé à quelqu’un en particulier ? Non pas spécialement. Je ne sais plus vraiment comment est venu ce titre, mais c’est une trouvaille de Jérémy. Il faut juste savoir que ce qu’on fait pour chaque album, c’est de lui donner un nom qui n’est pas le titre d’un des morceaux. Le titre est plutôt cool et correspond finalement bien aux paroles de Jérémy puisqu’il parle de tous ceux qui font de la merde et donc ceux qu’il n’aime pas. Mais ça s’arrête là.
Vous êtes sur M.U.S.I.C. Records. En quoi consiste le deal avec ce label ? Jusqu’à présent on était uniquement autoproduits. Maintenant on ne l’est plus qu’à moitié puisque le deal est de leur donner un produit fini, mixé, masterisé et avec l’artwork, et eux s’occupent du pressage et de la distribution (comme pour la plupart des groupes undergrounds actuellement – ndr).
Pour l’enregistrement de ce nouvel album, vous êtes allés dans le même studio que pour le précédent ? On a fait un copier-coller de « Charge This World ». C’est-à-dire que la batterie a été enregistrée au Fucking Hostile Studio dans le coin de Nancy, la guitare et la basse ont été enregistrées directement chez les musiciens. Ils ont fait ça tranquillement chez eux. Ensuite tout a été envoyé à Vinc, notre premier guitariste, pour le mixage, car on a gardé de bons contacts avec lui. Et c’est aussi lui qui s’est chargé de l’enregistrement des voix. Et quand le tout était mixé et dans la boîte, on a envoyé ça au Walnut Groove Studio (tenu par Axel, ex-Carnival In Coal, ex-Wormfood… - ndr) pour le mastering, comme pour les précédents albums aussi. Une fois que tout était fait, on a envoyé au label et c’était parti. Comme on est un peu reparti de zéro, on a dû payer l’enregistrement, le mixage et le mastering. Du coup ça devenait un peu compliqué de devoir remettre de notre poche pour payer le pressage en plus. C’est donc pour ça qu’on a commencé à chercher un label. J’ai dû envoyer des demandes à une cinquantaine de labels estampillés grind ou metal et finalement M.U.S.I.C. Records est le seul à avoir répondu positivement.
C’est la première fois que j’entends parler de ce label. Tu le connaissais toi ? Pas du tout. On est tombé sur eux parce qu’ils ont signé Depraved, et le batteur de ce groupe est le frère de notre chanteur.
Vous avez quand même pas mal rebondi en 10 ans. Je suppose que l’envie d’abandonner s’est fait ressentir plus d’une fois. Complètement. Tu sais, quand tu auditionnes des gens qui ne savent pas reproduire les riffs tels que Vinc les jouait, tu te dis qu’il était trop fort et que tu ne trouveras pas quelqu’un de son niveau. Gino est parvenu à ce que ça sonne. Mais Vinc avait une main droite hallucinante, il maîtrisait les allers-retours comme personne.
Tu disais avoir mis des annonces pendant cette période de 10 ans pour trouver un groupe dans lequel jouer. Tu as eu d’autres expériences musicales ? Les annonces que j’ai publiées l’ont été seulement quelques mois avant qu’on ne décide de reformer Massive Charge. C’était sur la fin, quand je croyais que MC serait mort que je me suis dit que j’allais essayer de me trouver un autre groupe. Maintenant c’est vrai qu’entre-temps j’ai joué dans Human Scum. On appelait ça du grind-prog (rires). C’était le projet de Mahdi, un pote tunisien, qui avait déjà eu des groupes un peu connus comme Vomit The Hate. Et là il voulait monter ce projet-là de grind avec des touches de death-prog. Le mélange était super sympa. À la basse, il y avait un autre Tunisien qui s’appelait Nidal. Ça n’avait pas trop mal pris, mais il y a eu des prises de tête entre les 2 et Mahdi a fini par se barrer en Allemagne. Et Nidal dans son coin a créé un autre truc qui s’appelait Kaliyuga avec Emy et il a voulu que j’en sois le batteur. Mais par la suite, pour des raisons personnelles je suis parti. Finalement après tout le monde est parti de Kaliyuga.
Et Kaliyuga officiait dans quel style ? Je dirais un mélange de grind, de powerviolence, de black et de crust. Et Emy était au chant uniquement. Franchement c’est un groupe qui démoule pas mal.
Vous avez sorti quelque chose ? On a sorti « Once Upon A Time » en 2016. On peut l’écouter sur Youtube.
Actuellement, dans Massive Charge, vous avez d’autres projets parallèles ? Moi, non. Jérémy, notre chanteur, est batteur dans Growls. C’est un groupe de Rennes dans lequel il y a le tout premier chanteur de Massive Charge à la basse. À la guitare, il y a Alex, qui ne joue que dans ce groupe-là et au chant c’est Zorro qui chantait dans Untamed. Emy, de ce que je sais, actuellement elle ne joue pas dans un autre groupe, mais bon, elle en a eu 50000. Et Gino a toujours des tas de trucs à droite à gauche, mais surtout des projets solo. Il a notamment un projet black qui s’appelle Epine. Mais je ne saurais pas en dire plus parce que lui aussi a déjà eu énormément de trucs. En tout cas, il est très actif.
Pour revenir un peu sur l’album, quels sont les premiers retours que vous avez pu en avoir ? Ils sont excellents, ça rappelle d’ailleurs un peu la période à laquelle « Charge This World » est sorti. C’est un peu le même engouement et ça fait super plaisir. Je voudrais qu’on ait toujours plus de visibilité, mais là on commence quand même à en avoir pas mal y compris au Québec. Il y a un média québécois qui s’appelle Metal Minded qui nous épaule vachement. C’est un podcast. Ils font des reviews, des interviews et organisent aussi des évènements. Il y a encore des trucs à venir avec eux. On a eu pas mal d’interviews et de chroniques avec à chaque fois de bonnes notes donc ça fait plaisir. Ça commence aussi à rebouger niveau live parce qu’on a des dates prévues et d’autres qui n’attendent qu’à être confirmées.
À ce propos, quelles sont les dates ou les éventuelles tournées prévues ? On fait notre release party prévue le 16 avril avec Inhumate, Gummo et Deathwhore. Le 21 mai, on joue avec Blockheads, LMDA et Exorbitant Prices Must Diminish qui est un groupe suisse avec le batteur de Nostromo. Ensuite on a quelques dates ou éventuellement une voir plusieurs tournées, mais ce ne sont encore que des discussions.
Vous faites tout vous-mêmes ou vous bénéficiez des services d’un booker éventuellement ? Tout est fait maison.
Le label n’intervient pas pour vous trouver des plans ? Non, mais par contre en fin d’année, le label va sortir un split 5 groupes dont nous. Donc on a enregistré 2 nouveaux titres. Par contre, comme je ne suis pas sûr des autres groupes, je ne préfère pas donner de mauvais nom.
Vous faites partie de cette scène française qui regorge de talents ces dernières années. Comment toi tu vois cette scène grindcore ? Il y a de bons groupes en France quand même avec par exemple ceux qu’on a cités déjà comme Inhumate, Blockheads, Gummo ou LMDA, qui sont à moitié français. Eastwood est dans ce cas-là aussi. Après il y a les Chiens, Whoresnation et compagnie. J’ai l’impression qu’il y a une très bonne qualité de groupes générale en France. Par contre, je trouve que le public ne bouge pas encore assez. Des mecs se décarcassent pour organiser parfois des dates de fous et il n’y a quasi personne au final. En septembre dernier, pour fêter le déconfinement, des gars s’étaient bougés pour organiser un petit festival en extérieur à la campagne sur 2 jours. Il y a avait du grind, du death, des groupes locaux et ils étaient limités au nombre d’entrées parce que pour des raisons d’assurance, il ne pouvait pas y avoir plus de 60 personnes sur le site, tout en sachant que les membres de groupes et l’orga comptaient aussi, ce qui laissait une quarantaine de places à vendre. Mais ils n’ont même pas rempli ça. Nous on a passé un super bon moment, mais à côté de ça, c’était triste de voir que des gens se bougent pour organiser, mais que le public ne se bouge pas pour venir alors que ce sont sans doute les mêmes personnes qui avaient gueulé pendant 2 ans en disant qu’ils voulaient revenir voir des concerts. Il faut voir la suite, mais moi ça me fait un peu flipper.
C’est assez peu proportionnel au final la différence entre le nombre de groupes de qualité qui existe en France et le public qu’ils parviennent à attirer en live. Oui, mais j’ai aussi l’impression que c’est parce que, ces 2 dernières années, les gens ont pris l’habitude de consommer la musique en digital à la maison et ils ne se bougent plus. S’ils trouvent un bon groupe, ils vont l’écouter dans la bagnole ou chez eux au casque, ils vont se prendre des superbes vinyles qu’ils écouteront tranquillement, mais tu ne vois pas ou plus ces gens-là aux concerts.
C’est peut-être le revers de la médaille effectivement. Et toi, les 2 dernières années, tu les as vécues comment d’ailleurs ? Outre le fait que tu aies été occupé avec le fait de remonter Massive Charge et d’enregistrer ce dernier album, est-ce que musicalement, tu es quelqu’un qui travaille beaucoup l’instrument et qui a senti une différence ? Non, je ne travaille que quand on répète. Mais c’est vrai que j’ai fait quelque chose qui m’a beaucoup servi tout de même. Un soir où je n’avais rien à faire, j’ai réservé notre local et pendant 4 heures, j’ai bossé la technique du « heel toe » à la double pédale. C’est la technique qui te permet de taper 2 fois sur une pédale en alternant le talon et la pointe du pied. Ça permet d’atteindre des tempos très rapides. D’ailleurs sur l’album il y a des parties à 260 bpm et grâce à cette technique, j’ai pu les faire sans trop me fatiguer. C’est chiant à bosser, mais quand tu l’as, ça va tout seul et tu as même l’impression de tricher tellement ça te parait facile. C’est pour ça que sur « For Those We Hate », il y a pas mal de parties de doubles parce que je sais les reproduire maintenant, chose qui était plus compliquée sur « Charge This World ».
Quelle(s) évolution(s) pourrais-tu tirer entre les 2 derniers albums que ce soit du point de vue des line-ups ou des enregistrements ? Comme j’ai dit, les enregistrements de « Charge This World » et de « For Those We Hate » ont été quasiment des copiés-collés donc à ce niveau-là il n’y a pas eu vraiment de changement. J’ai déjà vu une évolution me concernant en tout cas parce que sur ce dernier album, il y a énormément de D-Beat, chose qu’il n’y avait pas du tout sur le précédent, et ça c’est quelque chose que j’ai développé dans Kaliyuga. Il y a aussi le fait que les compos sont plus rapides. Sur « CTW » on était à du 240 (bpm), alors qu’ici on varie entre 240 et 260 en sachant que généralement c’est du 250. On a essayé de faire un truc un peu plus bourrin. Des évolutions il y en a forcément puisqu’il s’est quand même passé 10 ans, et quand tu pratiques ton instrument, il y a des choses que tu laisses, d’autres que tu gardes… Il y a d’office une évolution naturelle due au fait qu’on ait continué à jouer entretemps. Je ne vais pas relever de points positifs ou négatifs entre les 2 albums. Je dirais juste que sur le dernier, il y a plus de techniques, ce qui peut peut-être faire perdre un peu du charme parce que ça donne un côté un peu plus clinique alors que le précédent était plus « roots » et notre premier « Silence » l’était lui complètement. Donc on a perdu un peu de ce côté-là, mais au profit d’une plus grande technicité et d’un côté plus mature que j’ai quand même tendance à préférer.
Et quand tu regardes par rapport aux débuts de Massive Charge, est-ce que l’amour du grindcore est toujours intact ou il a évolué d’une manière ou d’une autre avec l’âge ? Je dirais que l’amour de la musique en général a évolué pas mal. Tu découvres des tonnes de groupes, tes goûts changent, tu t’ouvres, tu te mets à écouter des trucs que tu n’aurais pas écouté avant. C’est un peu comme quand tu es gamin et que tu n’aimes pas les haricots verts. À 20 ans tu te dis que tu vas y regoûter et au final tu te rends compte que ce n’est pas si dégueu. En plus, le fait d’écouter d’autres choses te fait aussi évoluer dans ta manière de composer et rend ton jeu plus riche.
Quels sont justement les autres styles ou groupes qui te parlent particulièrement ? Je me suis vachement ouvert à un style qui me parle beaucoup c’est le death metal progressif un peu mélodique, des trucs genre The Faceless. Quelque chose de bien bourrin, mais avec des passages en chants clairs avec de la mélodie et des parties bien composées. C’est quelque chose que je n’aurais peut-être pas écouté avant. C’est pareil pour le black metal. Quand j’étais jeune je mettais carrément un veto sur le style, je ne voulais même pas en entendre parler. Alors que maintenant il y a pas mal de groupes que j’aime comme Borknagar, Enslaved ou encore Dimmu Borgir. En tout cas je me surprends à écouter des trucs que j’aurais eu honte de dire que j’écoutais auparavant.
On s’enrichit en ouverture d’esprit en vieillissant finalement. C’est ça. Et ce sans renier ta colonne vertébrale.
Ça m’a fait plaisir en tout cas de décortiquer un peu ce dernier album et l’histoire du groupe avec toi, mais peut-être qu’il y a des choses dont on n’a pas parlé et que tu voudrais mettre en avant. Si c’est le cas, je t’en prie. Je voudrais juste retaper sur le clou en disant que les 2 loulous qu’on a trouvés, Emy et Gino, sont vraiment au top et collent parfaitement dans le line-up aujourd’hui. On a vraiment trouvé 2 bons éléments pour relancer un truc cool.
WIEGEDOOD - "There’s Always Blood At The End Of The Road"
Depuis 2015, nos compatriotes de Wiegedood ont réussi à s’imposer comme l’une des formations blacks qui compte aussi bien sur la scène de notre plat pays qu’à l’international. Le trio flamand avait déjà rebattu certaines cartes avec sa trilogie « De Doden Hebben Het Goed » et distord encore cette fois les frontières du style avec ce « There’s Always Blood At The End Of The Road ». Ce 4e album se présente d’entrée de jeu comme le plus violent du groupe. La voix éraillée de Levy Seynaeve (Living Gate, ex-Amenra), légèrement en arrière-plan dans le mixage, sert des morceaux alliant un côté brut de décoffrage dans la production et des compositions aux accents parfois dissonants voire dérangeants. En découle une espèce de bande-son du dégoût, un black metal vicieux traversé par une atmosphère poisseuse appuyée par la marque de fabrique de Wiegedood : les riffs entêtants. Que ce soit sur « FN Scar 16 », « Noblesse Oblige, Richesse Oblige », « Now Will Always Be » ou encore « Carousel », le groupe répète les séquences à l’envi comme il le faisait déjà sur sa première trilogie. L’imprégnation est donc totale pour l’auditeur qui en perdrait même une certaine notion du temps. L’interlude « Wade » à la guitare sèche rugueuse et presque désaccordée qui bascule sur le puissant « Nuages » se présente également comme une remarquable illustration du malaise distillé. Si la personnalité musicale reste, « There’s Always Blood… » prend ses distances par rapport à « De Doden… » à plusieurs égards. Si le triptyque initial se caractérisait à chaque fois par la présence de 4 morceaux d’une durée oscillant entre 6 et 13 minutes parmi lesquels le titre éponyme se plaçait toujours en 3e position, ce nouvel album se montrait d’emblée différent avec 9 morceaux d’une durée généralement moindre. L’accent est mis sur l’atmosphère mais Wiegedood n’en oublie pas pour autant l’efficacité en proposant des riffs plus directs comme sur « Until It Is Not » ou « Theft And Begging ». « There’s Always… » se présente donc comme une véritable réussite et une excellente alternative pour ceux qui désirent explorer les chemins de traverse d’un black metal à la sauce du collectif Church Of Ra.
CONVERGE - "Bloodmoon : I"
Et si les collaborations entre artistes d’univers diamétralement opposés sur le papier représentaient une partie de l’avenir pour la musique ? Certains groupes semblent en tout cas avoir bien compris qu’il n’est parfois pas inutile d’aller chercher chez l’autre ce que leur propre style ne peut logiquement pas apporter et ainsi élever leur proposition musicale à un niveau supérieur, le mélange des genres représentant souvent plus que la simple somme de ses parties. La distinction est bien entendu à faire entre ce dont nous parlons ici et les nombreux groupes (ou simples featurings), composés de musiciens issus de formations différentes, mis sur pieds le temps d’un album ou plus mais qui s’apparentent plus à des réunions de potes désireux de simplement jammer et prendre du bon temps ensemble. Le but n’étant pas de dénigrer cette démarche tant l’histoire de la musique nous a prouvé que, parmi eux, plusieurs avaient ou ont encore réellement des choses à dire, mais bien de différencier les démarches artistiques. Après la sortie fin 2020 de « May Our Chambers Be Full », album de rencontre hybride entre le groupe de doom drone sludge américain Thou et Emma Ruth Rundle, ce fut au tour de Converge de se prêter à l’exercice en 2021 avec la chanteuse Chelsea Wolfe pour ce « Bloodmoon : I ». Petit retour en arrière. En 2016, un an avant la sortie de « The Dusk In Us », le groupe donnait une série de concerts intitulés « Bloodmoon » pour lesquels il avait fait appel à Chelsea Wolfe, Ben Chisholm, collaborateur/producteur historique de celle-ci, Stephen Brodsky (Cave In) et encore Steve Von Till (Neurosis…) dans le but de réinterpréter certains des titres plus calmes, plus lents ou moins connus de sa discographie. La mini-tournée passera par le Roadburn (festival qui aura aussi été témoin de la coopération entre Emma Ruth Rundle et Thou en 2019) et fera naître une sorte de fantasme auprès des fans : un témoignage live ou un album verra-t-il le jour ? C’est ce qui arrive plus de 5 ans après, le temps sans doute de coordonner les plannings. Sur cet album collaboratif, Converge lève un peu le pied pour mieux permettre aux différents styles de s’entremêler avec une maestria peu commune. Quand la puissance du post hardcore rencontre la mélancolie folk gothique, ça donne ce « Bloodmoon : I », un bijou de compositions, de mélodies et d’arrangements aussi beau que surprenant. « Blood Moon » qui ouvre l’album se charge des présentations et débouche sur un disque qui nous emmène dans des paysages sonores riches et variés. « Coil » voit une intro à la guitare sèche sur laquelle la voix de Wolfe vient délicatement se poser. « Flower Moon » ou « Failure Forever » aux accents de post grunge nous renvoient aux guitares et lignes de basse plus graveleuses alors que l’éthéré « Scorpion’s Sting » à la Melissa Auf Der Maur et sa douce patte de chanson de bar aurait pu avoir sa place comme morceau de fin d’un des épisodes de la saison 3 de Twin Peaks (les fans comprendront). « Crimson Stone » voit la beauté côtoyer le bestial et débouche sur le très beau « Blood Dawn » en guise de final. Ce 10e album de Converge marque un virage certain dans la carrière du groupe mais a le mérite de prouver que sortir de ses propres cadres peut encore surprendre à condition de savoir y faire.
BLOCKHEADS - "Trip To The Void"
On dit souvent que la patience est la reine des vertus, et cet adage se confirme dans ce cas-ci puisqu’il aura fallu attendre pas moins de 8 ans pour enfin découvrir le nouvel album de Blockheads. Mais à la question de savoir si le jeu en valait la chandelle, la réponse est sans nul doute la suivante : oui. « Trip To The Void » n’est ni plus ni moins qu’une véritable bombe dont les fans de grindcore se délecteront tant l’album représente tout ce qu’ils attendent d’un disque comme celui-là. Si ces chefs de file de la scène grind française ont pris leur temps, c’est pour accoucher d’un album certes furieux et compact (25 titres pour moins de 29 minutes) mais qui met surtout un point d’honneur à remplir parfaitement le cahier des charges voulu par le style, comme ils le font d’ailleurs depuis leurs débuts. Avec équilibre, Blockheads propose ici des alternances de blasts furieux et de passages plus ancrés dans leurs racines crust punk, le tout avec un sens du groove mis en forme par la production volontairement old school de Steph Tanker (Disvlar Studio). Après un passage par Relapse pour leur précédent opus « This World Is Dead », la bande bénéficie ici d’une double sortie puisque « Trip To The Void » se voit affublé des services des labels français Lixiviat Records, pour le format vinyl, et Bones Brigade pour le CD. Une sortie en parallèle sur 2 labels qui, on l’espère, lui permettra de toucher un public aussi large que possible. Le côté visuel n’est pas en reste puisque l’artwork de ce nouvel album s’apparente tout simplement à une véritable œuvre-d’art. Réalisée par le photographe mexicain Roberto Campos, la photo habillant la pochette prend véritablement l’auditeur à contre-pied en proposant, dans des tons froids, un style d’image a priori davantage réservé au post rock qu’au grindcore. Preuve en est que ce dernier parvient, après des années de cloisonnement, encore à se réinventer, du moins en partie via certaines formations. « Trip To The Void » est donc à découvrir d’urgence si ce n’est déjà fait et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l’univers du groupe et la réalisation de ce dernier album, on ne saurait trop leur conseiller de se rendre dans la rubrique « Interviews » de ce site. Voilà, c’est dit.
Blockheads
Sans vouloir exagérer en parlant directement de légende, il est un fait certain que Blockheads s’est positionné, en 3 décennies de carrière, comme l’un des pionniers incontestables d’une scène grindcore française qui, depuis une bonne dizaine d’années maintenant, se place comme une référence au vu de ses qualités et de sa diversité. Alors quand l’occasion est donnée de s’entretenir avec l’un de ses membres, on la saisit. À l’occasion de la sortie de « Trip To The Void », petit chef-d’œuvre qui aura indéniablement marqué la fin d’année 2021, c’est Raph (guitare ou basse selon les occasions) qui nous a accordé l’entretien qui suit et ce sans compter ses heures. Une interview fleuve mais aussi et surtout une rencontre humaine riche entre 2 passionnés.
Qu'est-ce que vous avez foutu ces 8 dernières années ? This World is Dead est sorti en 2013. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour proposer un nouvel album ? Cette question revient régulièrement. Et c’est normal. On est pas mal répartis, avec Xavier à Annecy et nous autres en Lorraine. Ça nous donne un rythme de répétition quand même restreint. Parfois, on doit consacrer des répétitions entières au live. Ceci dit, on est aussi, on va bien l’avouer, assez lents. On jette pas mal de riffs. On peut être assez exigeants avec les apports des uns et des autres. Et puis l’album a été enregistré il y a plus d’un an, aussi. Le mix et Le master ont pris pas mal de temps.
Pour quelles raisons ? Ça vient de problèmes que vous avez rencontrés ou de ce côté exigeant dont tu parles ? Le mix, au départ, était confié à William de Gadget. Il a fait du bon boulot, honnêtement. Le problème est que ça sonnait très « moderne », très metal. Et on savait dès le départ qu’on ne voulait pas du tout sonner comme ça. Il a vraiment travaillé, nous a envoyé pas mal de versions différentes, toutes très bonnes, mais à côté de ce qu’on cherchait. Steph Tanker du Disvlar Studio, qui avait enregistré le disque, a finalement accepté de reprendre le mix et le master. Ça a été plus simple. Il y avait moins de distance et il nous connaît bien. Tout ça a pris des mois mais ça valait le coup.
Et avec lui, l'enregistrement en tant que tel a mis combien de temps? Quand on entend parfois le côté "urgent" de certains morceaux, j'imagine que ça n'a pas dû traîner. Au total, je dirais 7 jours, batterie comprise. Même si les prises de batteries ont été faites un peu avant le reste. Ça nous a permis de justement prendre un peu de temps, refaire, refaire et refaire. Steph est quelqu’un de super exigeant avec lui-même. Il a une oreille très sûre et c’est un bien meilleur guitariste qu’aucun d’entre nous ne le sera jamais. C’est ce qui nous a servi. Il est très exigeant en retour aussi. Mais dans le bon sens. Il nous a vraiment poussés techniquement plus loin que ce qu’on aurait pu faire sans lui. En plus, c’était un peu comme être à la maison. On a vraiment passé ces jours-là ensemble du lever au coucher. Ça reste une très belle expérience
Vous aviez déjà travaillé avec lui auparavant ? Jamais! Et c’est assez étonnant, une entente aussi immédiate. Mais Steph est vraiment adorable.
Parfois le feeling ne s'explique pas et c'est tant mieux. Ça contribue à la magie et là vraisemblablement ça vous a permis de sortir quelque chose de très abouti. Je vous ai découvert il y a 15 ans avec l'excellent "Shapes Of Misery" (2006) et j'ai toujours trouvé le groove dans votre grindcore hyper intéressant. Mais ici j'ai vraiment l'impression que vous êtes montés encore d'un cran en termes de balance entre ce groove et votre côté très brutal. Quand on entend "Cages", "Trip to the Void" ou "Flesh Furnace", les combinaisons fonctionnent à merveille. Ah et bien merci, déjà! J’aime bien quand on parle aussi de ce groove un peu latin que Nico arrive à caser par moment. Je te mentirais en te disant que ça sort tout seul, même si Nico est super surprenant dans certains choix de patterns de batterie. Mais on a essayé d’équilibrer les titres, individuellement, même ceux de 25 secondes. Ça explique aussi la lenteur du processus, étant donné qu’on compose essentiellement en répétition. Mais on a toujours aimé aussi les groupes et les titres très lourds, le sludge, le doom, la noise 90s, et Godflesh. Ça se retrouve par bribes, même dans un disque un peu « compact » comme celui-ci.
Je voulais justement te demander quels étaient les autres styles musicaux dont vous étiez friands dans le groupe et si certains de ces autres styles (ou groupes) avaient une influence sur votre manière d'écrire vos morceaux. Ce qui est assez intéressant pour les uns et les autres, c’est qu’on écoute tous pas mal de choses différentes, mais pas forcément les mêmes. Ça permet de brasser pas mal d’influences, de la powerviolence au sludge justement, mais aussi en ayant parfois certains réflexes de jeu piqués chez Helmet ou Unsane et ce côté un peu sec sur certains riffs. Évidemment ça ne saute pas aux oreilles, mais c’est bien là.
Toujours pour rester dans la composition et la production, pourrais-tu me dire si un groupe comme Blockheads, qui comptabilise déjà presque 30 ans de carrière, avait adopté d'autres méthodes en fonction des évolutions techniques qu'on a pu connaître ces dernières années en matière de home studio, de matériel... En gros, est-ce que Blockheads reste dans une optique "traditionnelle" de composition ou vous vous aidez d'autres outils pour travailler mais sans dénaturer ce côté brut de décoffrage que vous avez ? En partie. Maintenant on garde des traces de tout. Fred (guitare) se charge de monter ça chez lui, ce qui permet de ne pas perdre de riffs, ce qui pouvait arriver, et d’avoir une idée plus précise du morceau, à froid. Il y a évidemment le piège qui consiste à vouloir retravailler sans cesse un titre, mais globalement ça nous aide. Pour la composition en elle-même, Fred apporte la grande majorité du matériel, j’en apporte aussi, et on retravaille tout ça ensemble au local avec Nico (batterie) et Erik (basse), qui a un rôle énorme pour la structure des titres. En général, on retravaille les riffs ensemble, avec un jeu de Ping-pong entre nous trois ou quatre, et on garde la meilleure version. Encore une fois, c’est long mais dynamique. Et pour revenir à ta question, on ne compose que très rarement un titre à la maison. Ça reste démocratique comme démarche.
"Trip to the Void" est une véritable invitation à l'asphyxie et au ramassage de baffes. 25 titres, moins d'1/2 heure et la messe est dite. Quel est le secret de cette énergie pour un groupe de presque 30 ans? Vous ne laissez que les blancs entre les morceaux pour que l'auditeur reprenne son souffle. Je pense que c’est aussi notre album le moins « optimiste ». La période n’incite pas vraiment à l’être, il faut dire. Ça se reflète dans la musique. Ce serait un peu cliché, mais c’est en partie vrai, il y a une colère et un pessimisme latents derrière tout ça. C’est sans doute ce qui explique la densité du disque, même si ça n’est pas forcément conscient. Mais je comprends le côté asphyxie dont tu parles. Ça peut aussi rebuter mais c’est le résultat de ces années qui viennent de s’écouler.
L'album m'a parfois aussi fait penser au "Behold The Failure" (2009) des Suisses de Mumakil qui m'avait fait un peu le même effet à l'époque. En plus c'est un groupe avec lequel vous vous entendiez plutôt bien vu le fait que vous aviez sorti 2 splits avec eux. Des amis, on peut même dire ça.
Vous vous complétiez en quelques sortes même si chacun à son tour en remettait une couche par rapport à ce que l'autre proposait et inversement. C’était un peu la rencontre de l’horlogerie suisse et de la massue gauloise oui (rires).
L'intro de l'album est empruntée au 1984 de George Orwell. Il s'agit de la même phrase d'ailleurs que sur l'intro du morceau « Do Not Speak » de Anaal Nathrakh (sur « Domine Non Es Dignus » - 2004). Tu peux nous expliquer ce choix et en même temps les thématiques développées dans l'album? Ce choix est lié à notre amour commun pour ce livre. On savait qu’on allait s’en servir d’une manière ou d’une autre (je parle du livre). Fred a trouvé cet extrait et on a décidé d’ouvrir et de fermer le disque avec. J’avoue que je n’écoute jamais Anaal Nathrakh donc tu m’apprends qu’ils l’ont utilisé aussi. Mais la phrase est forte, et explicite, ça ne m’étonne pas forcément. Pour l’album en lui-même, nous traitons de thèmes d’actualité, comme la montée de l’extrême droite, du racisme, l’individu dans une société segmentée qui a perdu le sens du collectif, les inégalités sociales, l’aliénation par le travail... L’angle est peut-être parfois plus abstrait ou personnel, mais on écrit sur ces choses depuis très longtemps. Je ne sais pas ou plus si ça a une utilité, mais je ne me vois pas parler d’autre chose dans le groupe. C’est en nous et ça ne partira plus.
Y a-t-il des morceaux qui te tiennent plus à cœur que d'autres? Oui, on a tous nos « chouchous ». Pour ce qui me concerne, ce sont « The Devourer » qui évoque les morts en Méditerranée, un sujet qui me tient à cœur, et « Flesh Furnace », parce que c’est le morceau à part sur l’album. On a pu expérimenter un peu, et tenter une bribe de mélodie dedans. C’est aussi le titre avec le texte le plus abstrait, mais j’aime beaucoup les images qu’on a mises dedans. J’ai un amour particulier pour « Conscience Cleaner » aussi, pour le break, pour le côté jusqu’au-boutiste du morceau.
Le visuel de l'album est une véritable œuvre-d’art. Qui est derrière sa réalisation et quelle symbolique peut-on y voir ? La photo est une œuvre de Roberto Campos, un photographe mexicain qui l’a créée en lien avec son modèle. Visiblement, cette photo a une signification particulière pour le modèle, mais il n’a pas été plus loin dans ses explications quand j’en ai parlé avec lui, après la sortie de l’album d’ailleurs. C’est la seule proposition qui ait emporté l’adhésion de tout le monde dans le groupe. Et c’est vrai que c’est une photo très forte, très graphique, et très chargée émotionnellement. D’ailleurs l’intérieur du livret est tiré de la même session, mais sans modèle. C’est sans doute l’artwork dont nous sommes le plus fiers, je pense. La signification est justement assez ouverte. J’ai tendance à y lire les derniers moments de ce qui nous reste d’humanité avant le grand vide, mais c’est très personnel. On peut aussi y lire la crise de l’individu isolé des autres, peut-être, ou encore une prise de position en soutien au féminisme, ce qui serait cohérent avec ce en quoi nous croyons. Pas de réponse définitive donc, mais c’est l’intérêt des œuvres d’art aussi.
« Trip To The Void » est sorti via 2 labels différents en fonction des formats, Lixiviat Records et Bones Brigade. Un seul ne pouvait pas tout sortir ? En fait quand on a réfléchi à quel label pouvait sortir l’album, on a assez vite pensé à Lixiviat parce qu’on savait qu’ils faisaient du bon boulot. Mais eux travaillent essentiellement du vinyle. Et en discutant, la solution de le sortir avec eux et Bones Brigade, qui sort principalement du CD, a émergé puisque les 2 labels ont l’habitude de bosser ensemble. Ce sont des passionnés et ça a été super simple finalement. On est très contents. Et puis il faut dire qu’avec Bones Brigade, c’est une longue histoire.
C’est vrai que vous avez déjà sorti quelques trucs chez lui. Oui, on a déjà collaboré plusieurs fois avec lui. Ça fait toujours plaisir de croiser Nico. C’était la bonne solution par rapport à un label plus gros comme Relapse parce que déjà tu peux communiquer en français, tu n’es pas dans un roster de 150 groupes et tu ne te retrouves pas à être la 19e roue du carrosse (rires).
Relapse avait sorti votre précédent album « This World Is Dead » et comme vous n’en aviez sorti qu’un seul avec eux, je voulais justement te demander si c’était parce que vous aviez été déçus par la collaboration. Je pense que c’est plutôt l’inverse en fait (rires). Mais c’est plutôt normal. On n’a absolument aucune amertume là-dessus parce que déjà, ils ont travaillé l’album. Çà, il n’y a pas de problème…
… C’est vrai que généralement, il n’y a pas vraiment de sortie sur Relapse qui passe à la trappe. Ils bossent leurs sorties, ça c’est une évidence. Après je pense que Relapse est plus adapté à des groupes qui vendent et tournent plus que nous. Parce qu’arrivé à la cinquantaine, c’est compliqué de se débloquer 3 semaines pour aller tourner aux États-Unis. Alors que quand tu sors un album chez Relapse, c’est ce que tu devrais faire finalement. On leur a proposé cet album mais ils ont été très clairs avec nous et ne l’ont pas pris. Je pense qu’ils ont écoulé le pressage du précédent mais ils ne l’ont pas repressé. Ce qui est logique. Quand tu fais du grind old school tu ne vas pas en vendre des palettes. Personne ne se fait d’illusions là-dessus. On n’est pas comme Full Of Hell qui a un côté beaucoup plus moderne dans son grindcore. Il faut quand même apprécier le style pour ce qu’il est. Mais ça me parait logique encore une fois. Les mecs de Relapse, ils vivent de ça, ils paient leur loyer et bouffent avec le salaire que leur fournit le label. Tu as des contingences qui ne sont pas les mêmes. Donc ça ne m’a pas choqué.
Vous prenez ça avec une certaine sagesse dans un sens. Vous gardez les pieds sur terre. Oui il faut. En plus, on ne veut pas se prendre pour des gens qu’on n’est pas non plus. On n’a jamais été autre chose qu’un groupe de grind et s’il y a bien une musique de niche, c’est bien celle-là.
Mais tu ne peux quand même pas nier que Blockheads, d’un point de vue grindcore français et européen, est un groupe qui compte ? C’est super difficile d’avoir du recul par rapport à ton propre groupe et de voir comment tu es perçu. On est là depuis 30 ans, on a beaucoup tourné, je crois qu’on a un capital sympathie parce que les concerts sont ce qu’ils sont (rires) mais après il y a d’autres groupes comme ça. Si tu prends Agathocles, çà aussi c’est un groupe qui compte. Ils vendent des paquets d’albums…
… Oui mais ils ont 15 sorties par an… C’est vrai qu’ils sortent beaucoup de splits et nous on n’en sort pas tellement. J’ai énormément de respect pour Agathocles. Mais ça restera toujours comme les Québécois de Archagathus, qui est fortement inspiré d’Agathocles d’ailleurs, qui vont à fond dans leur truc. Ça restera toujours confidentiel. Pour moi ce n’est ni bien ni pas bien, c’est un état de fait. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que tout doit rester underground pour l’underground puisque quand on fait de la musique c’est quand même pour que les gens écoutent ce qu’on fait. Après il y a le facteur réalisme qui fait que ça reste une musique qui n’est pas facile d’accès. Pour plein de gens, ça restera toujours du bruit. Et le corollaire de ça c’est que tu n’en vendras jamais beaucoup. En soi ce n’est pas grave, nous on le fait.
Et quand tu le fais, tu le sais finalement. Bien sûr, et encore une fois on n’a zéro problème avec ça. C’est juste comme ça. Nous on est contents de tourner et de sortir des disques et c’est le plus important je pense.
Est-ce que le fait d’avoir 2 labels qui sortent « Trip To The Void » sous différents formats vous fait bénéficier de canaux de distribution plus larges ? Je pense que les 2 travaillent avec les mêmes distributeurs pour tout ce qui est commerces, magasins de disques… mais ont peut-être effectivement des canaux différents pour envoyer aux distros (personnes ou structures qui vendent albums et merchandising de différents groupes via internet ou directement lors de concerts – ndr). Ce qui est sûr c’est que les 2 ont communiqué sur l’album. Maintenant la coopération de labels pour sortir un disque fait partie du côté culturel de la scène crust ou punk hardcore. C’est rigolo que tu me poses la question parce que je ne me l’étais jamais posée comme ça effectivement. Mais il fallait ça de toute manière. Comme je te disais, Lixiviat travaille essentiellement le vinyl et c’est intéressant parce qu’ils travaillent toujours avec le même presseur, Vinyl Record Makers dans l’ouest de la France, qui a un comportement intéressant parce qu’en ce moment le marché du pressage vinyl est assez tendu. Il y a un manque de matière première et les majors font presser des trucs en grosse quantité. Mais eux n’ont jamais laissé tomber les indépendants. Moi ça me fait plaisir de travailler avec quelqu’un qui ne laisse pas de côté les labels DIY pour faire du repress de Sheila.
C’est du circuit court. Il y a un peu de ça. Et puis c’est aussi à chacun son domaine d’expertise. Lixiviat pour le vinyl et Bones Brigade pour le CD.
L’album est aussi disponible en streaming ? Oui, il est écoutable sur les plateformes. Quant à notre Bandcamp, il faut qu’on remette le tout un peu d’équerre mais a priori début 2022 tout devrait être rentré dans l’ordre à ce niveau-là. Pour ma part j’écoute assez peu de musique via ces canaux-là et donc on était assez contents que les labels s’en occupent parce que sinon je pense qu’on n’aurait pas su comment faire.
Qu’est-ce que ça représente d’ailleurs à l’heure actuelle un label de grind pour un groupe comme le vôtre en termes d’investissements, que ce soit financier ou autre ? Est-ce qu’ils ont participé, par exemple, à l’enregistrement ? Non, l’enregistrement on l’avait fait avant d’avoir un label. Donc eux se sont occupés du pressage, de la distribution, de la promo… Et c’est bien comme ça. Les labels qui paient les enregistrements maintenant, ça devient de plus en plus rare.
Pour en revenir au format vinyl, je serais assez curieux de voir le rendu de votre pochette dessus. Elle doit être superbe. Ouais elle claque. J’en suis super content. En plus le papier n’est pas tout à fait mat mais est un peu velouté je dirais. Il est très légèrement brillant mais à peine. Et comme les couleurs sont assez froides, ça rend super bien. Et c’est un gatefold, donc l’intérieur c’est juste une photo en plan large du marécage mais que le photographe a prise avant d’y installer le modèle. Donc c’est juste le marécage vide mais sans rien d’autre, pas une lettre, rien du tout. Comme je le disais, je pense que c’est le premier artwork pour lequel personne n’a rien eu à redire. On a eu beaucoup de questions là-dessus parce que c’est un artwork qui ne fait pas grind.
C’est justement ça qui est intéressant. Ben ouais. Tu vois quand Xav (chant) nous a montré la première fois la photo au local à l’arrache sur son téléphone, l’un d’entre nous a dit « waw, elle est chouette la pochette du nouveau Emma Ruth Rundle ». Et ce n’est pas faux. Ça pourrait être une pochette de post-rock. C’est pour ça qu’on a choisi de ne pas mettre de logo dessus.
La photo parle d’elle-même et c’est vrai que ça dénote avec les visuels précédents. Si on prend celui de « This World Is Dead » avec ce paysage de désolation, la photo était très belle mais elle collait complètement au sujet. Ici, c’est un peu comme si vous preniez l’auditeur à contrepied. Est-ce que selon toi ce ne serait pas un peu une manière de vous réinventer dans un style qui a trop souvent été cloisonné ? Oui, c’était un peu l’idée qu’il y avait derrière tout ça. Tu sais là on approche de la cinquantaine. Tu as vu la vitesse à laquelle on sort des disques (rires). En fait on ne sait pas mais celui-ci pourrait bien être le dernier. Après on fera des splits, et on en fera plus qu’avant, c’est sûr. Mais donc on voulait vraiment sortir l’album qu’on voulait et ne pas tourner en rond notamment au niveau de la pochette. On avait envie de se faire plaisir. Celle-là a été un peu trouvée par hasard mais c’est un bon hasard. On a eu d’autres propositions avant mais à chaque fois, l’un d’entre nous avait quelque chose à redire, alors que là tout le monde a fermé sa gueule. C’était ça qu’il nous fallait. On a seulement envoyé un mail au photographe Roberto Campos, qui était content apparemment parce qu’il écoutait du métal mais il n’avait jamais travaillé avec un groupe je crois.
Ce que je trouve intéressant c’est cette espèce de dichotomie avec « Trip To The Void » qui est peut-être votre album le plus frontal et le plus violent dans tout ce qu’il représente et paradoxalement, c’est celui qui possède la pochette la plus belle. Je pense que c’est en tout cas l’album où Nico (batterie) s’est le plus lâché. Mais on n’a pas fait exprès. On ne s’est pas dit au début qu’on ne voulait que des morceaux courts. Ils sont juste sortis comme ça. C’est un album compact, on est en-dessous de la demi-heure.
Tu es à nouveau dans le groupe depuis 2017. Oui. J’étais arrivé en 2002 pour remplacer Payot à la basse et je suis parti en 2008. Mais j’étais toujours resté en contact avec le groupe et les mecs m’ont rappelé pour me dire qu’Erik (basse, chant) avait un boulot qui lui prenait pas mal de temps et ils m’ont proposé de revenir mais à la guitare cette fois. Et pour les concerts où Erik ne savait pas être là, l’idée était de faire ça à une guitare et moi je prenais la basse plutôt que d’annuler la date. Je trouve que c’est une bonne solution, ça permet d’être souple.
On parlait avant des labels et des tournées et on se rend compte que Blockheads ne tourne pas vraiment beaucoup. C’est plutôt un choix de votre part dû à l’âge et aux occupations de chacun comme tu le disais avant ou un manque d’opportunités ? Comme on a tous des tafs et des gosses, c’est assez difficile de mobiliser 2 semaines. Et aussi, par rapport aux enfants, on refuse catégoriquement de partir et de demander à nos femmes qu’elles s’occupent d’eux pendant 2 semaines. Personne ne voudrait le faire et il y aurait aussi une incohérence par rapport à ce qu’on défend concernant l’égalité homme – femme. Je ne critique absolument pas les groupes qui tournent en disant ça mais pour nous c’est important d’être là. Et puis il y a aussi un autre truc qui fait que le groupe dure, c’est qu’on s’est toujours dit que le jour où Blockheads deviendrait une contrainte, on perdrait ce côté familial. On essaie de faire au mieux, on va essayer de tourner un peu en octobre-novembre prochain. On a une date à Strasbourg en février, une autre à Dijon et si tout se passe bien, il devrait y avoir une date à Londres en septembre.
Pour tout ça, vous avez un booker ? On n’a pas vraiment de tourneur pour l’instant. Peut-être qu’on sera obligés d’y passer pour la tournée d’octobre par rapport à certaines salles mais on ne sait pas encore.
Je voulais faire le rapprochement entre Inhumate et vous. À quelques années près vous êtes de la même génération et à l’occasion d’un petit festival grindcore organisé en Belgique par « Stooph », le batteur d’Insane Order (le We’re Not Worthy Fest les 22 et 23.10.21 au Canal 10 à Hautrage – ndr), j’ai eu l’occasion de revoir Inhumate. Et on s’est dit avec quelques copains après ça que les mecs d’Inhumate, au même titre que Blockheads, avaient beau avoir l’âge qu’ils avaient, ils montaient sur scène et donnaient encore une leçon de grindcore à tout le monde. En tant que « chefs de file » d’une scène grindcore française qui regorge de qualités, j’aurais voulu avoir ton opinion sur l’évolution de cette scène et connaître un peu les groupes que tu mettrais en avant pour l’illustrer. La question est compliquée pour moi parce que pas mal de personnes sont des potes…
… Je sais, je suis désolé mais démerde-toi (rires). Je vais essayer d’être le plus objectif. La scène grind française est pour moi ultra vivante. Et qualitativement, elle est vraiment chouette. Il y a des groupes dont je suis ultra fan, comme Whoresnation. S’il y a bien un mec qui a compris comment balancer des riffs grind et les jouer c’est Lopin. C’est du grind comme moi je l’entends. Leur dernier « Mephitism » (2018) est une baffe. Il y a Chiens évidemment et leur dernier qui est monumental (« Trendy Junky » - 2019). Leur batteur Sacha est pour moi un des meilleurs du genre avec un jeu plus rock. Il y a Warfuck évidemment mais aussi Gummo, Tina Turner Fraiseur, Vomi Noir… Je ne sais plus s’ils existent encore mais j’avais pris une tarte monumentale au Moshfest de Montpellier il y a quelques années avec Riposte, un groupe de powerviolence de Paris. Il y en a vraiment plein. Et c’est super que la scène soit comme elle est maintenant parce qu’à un moment j’allais dans les concerts grind et je ne voyais pas tant de jeunes que ça. Alors que maintenant le public se rajeunit un peu. On n’est pas dans la transmission de savoir ou quoique ce soit mais ça ferait chier que la scène grindcore s’éteigne d’elle-même faute de nouveaux combattants (rires). Je ne veux pas passer pour le mec chauvin mais moi j’y trouve plus mon compte au niveau qualité et diversité avec les groupes français, ou francophones en général parce qu’il ne faut pas oublier le Canada. Il y a Grist aussi ou encore Bain De Sang, avec notre ancien guitariste Raph, Doomsisters, dans un style plus grind sludge. Il y a Gros Sel aussi qu’on oublie souvent.
Pour terminer je voulais te demander un peu ce qui se profilait à l’horizon pour Blockheads. Tu as parlé de quelques dates et de faire un peu plus de splits qu’avant… Oui on a recommencé à composer et je pense qu’on va essayer de faire des splits avec des copains, mais je ne sais pas encore avec qui ni qui va les sortir. Mais là ce qui est vraiment cool, c’est qu’on a trouvé un bon endroit pour enregistrer pas loin de chez nous, dans des conditions idéales et chez un mec qui nous connait. Enregistrer chez Steph Tanker, au Disvlar Studio, c’est un peu comme enregistrer chez soi.


SUFFOCATION - "Live In North America"
Toutes les bonnes choses ont une fin. On ne parle bien sûr pas ici du death metal de haute qualité qu’a toujours délivré Suffocation mais bien de l’ère Frank Mullen, vocaliste historique du groupe, qui a tiré sa révérence il y a 3 ans après 30 ans de très bons et loyaux services. Enregistré en octobre 2018 à Cambridge dans le Massachusetts lors du Death Chopping American Tour, « Live In North America » est donc la dernière performance scénique de l’un des chanteurs les plus influents de la scène death metal. Un véritable best of reprenant les titres phares du groupe, de « Thrones of Blood » qui ouvre les hostilités (après une déclaration d’amour du chanteur à son public indiquant qu’il s’agira là de sa dernière apparition) à « Infecting the Crypts » qui les referme, en passant par les cultissimes « Effigy of the Forgotten », « Pierced from Within », « Funeral Inception », « Souls to Deny » et on en passe. 13 titres intenses où les musiciens s’en donnent à cœur joie et servent sur un plateau un Mullen qui ne manque pas de donner une dernière leçon à qui veut l’entendre. « Live In North America » surpasse encore d’un cran le pourtant très bon live de 2005 à Québec, « The Close of a Chapter » (sorti initialement dans un relatif anonymat mais réédité par Relapse en 2009) qui faisait déjà office de pièce de choix dans la discographie du groupe. Connu comme une véritable machine en live grâce notamment à un frontman qui n’a jamais ménagé ses efforts, Suffocation fait à nouveau honneur à sa réputation. Et même si la question de savoir pourquoi Nuclear Blast aura attendu autant de temps avant de sortir ce « Live In North America » peut se poser, on se contentera d’apprécier l’objet pour ce qu’il est, à savoir un au revoir admirable de la part d’un Frank Mullen qui a toujours maîtrisé son sujet et a tant apporté à la musique qu’on affectionne. Salut m’sieur !
11.09.21 - Miracle Metal Meeting
Après des mois de disette point de vue concerts et festivals pour les raisons que tout le monde connaît, une reprise de ces activités chères à notre cœur mais surtout à nos oreilles a pu se faire ressentir durant l’été. Parmi ces évènements se tenait le modeste mais néanmoins sympathique Miracle Metal Meeting le 11 septembre dernier dans le centre de la ville flamande de Deinze. À taille humaine, le festival nous aura permis de retrouver nos marques et sensations dans une ambiance plutôt tranquille. L’occasion aussi de (re)découvrir certains groupes parfois avec surprise.
Bien entendu, l’entrée en matière fut quelque peu malheureuse puisque les embarras de circulation nous ont fait rater d’entrée de jeu les Zultois de Turpentine Valley. Une première déception puisque sur le papier ce trio post-metal instrumental n’aurait probablement pas été pour nous déplaire. Ce n’est que partie remise et le nom du groupe est d’ores et déjà inscrit sur notre « to do list ».
Cette seconde édition du Miracle Metal Meeting a donc commencé, pour notre part, avec Carneia, autre formation post-metal issue du nord du pays. Mais si les recherches effectuées en amont sur le groupe faisaient état de performances live à absolument découvrir, et d’un véritable mur de son délivré par ce quatuor s’inspirant de Tool ou de Faith No More, nos impressions ne sont malheureusement pas allées dans ce sens. S’il n’y avait pas grand-chose à dire sur l’exécution musicale en tant que telle, Carneia nous a semblé manquer de la pêche qu’il aurait fallu.
Dyscordia a assuré la suite du programme avec un heavy metal moderne qui semblait ravir le public. On ne comptait d’ailleurs plus les fans arborant les t-shirts et autres patchs de toutes les tailles aux couleurs de la « Dyscordia army ». Si le sextet (oui, 3 guitaristes quand même) n’était pas la tête d’affiche du MMM, il en était à coup sûr l’une des vedettes et peut-être l’un des groupes les plus attendus par une frange de spectateurs amateurs de heavy prog mélodique. Les Courtraisiens, menés par leur chanteur assurant son rôle de frontman, s’en sont donné à cœur joie. Si le style ne nous parlait pas de prime abord, reconnaissons tout de même à Dyscordia un sens du riff qui fait mouche et de la mélodie qui accroche.
La suite du MMM nous replongeait plusieurs années en arrière avec le groupe hardcore Liar. Quel plaisir de revoir ce groupe qui, fort de ses années d’expériences, garde l’intensité qui l’a toujours caractérisé. Si ces dignes représentants de la scène H8000 (scène hardcore de Flandre Occidentale des années 90 ayant eu un retentissement même à l’international) n’ont plus sorti d’album depuis 2005, ils n’ont jamais vraiment disparus. Les réactions du public du festival ont bien démontré qu’il fallait encore compter sur eux et que l’âge n’avait pas d’importance. En effet, même si on peut détecter une attitude un peu plus « sage » que dans le passé, la virulence et l’implication des musiciens restent au rendez-vous. C’est ainsi qu’on a pu voir un Hans Verbeke en communion avec son audience, qui n’hésite pas à fédérer et à aller à la rencontre d’un public qui a commencé à s’amasser dans les premiers rangs pour pouvoir pousser la gueulante. Liar a assuré de bout en bout et a encore une fois démontré un savoir-faire hardcore old school authentique.
Venait ensuite Spoil Engine. Et autant dire tout de suite que la surprise aura été de taille. Mené par sa chanteuse Iris, dont le charisme en ferait pâlir plus d’un, les Flandriens nous ont un peu laissé sur le cul si vous me passez l’expression. Avec une recette alliant metalcore et death mélodique, le quatuor a enchaîné les titres d’une efficacité désarmante avec une bonne humeur incroyablement communicative. Nous connaissions déjà la bande de réputation et à travers l’un ou l’autre titre glané ça et là sur les plateformes mais il s’agissait ici de la première fois en live. La sauce a pris, c’est le moins que l’on puisse dire. Un véritable régal et une excellente découverte scénique.
Alors que la nuit pointait doucement le bout de son nez, La Muerte a investi la scène et a posé l’ambiance tout de suite comme à son habitude. Aidé d’un éclairage minimaliste en arrière-scène, les Bruxellois ont balancé leur death rock heavy blues et presque hypnotisé un public certes plus dispersé mais complètement acquis à la cause. La tête couverte de sa toile de jute, comme à son habitude, Marc Du Marais et sa bande n’ont encore une fois fait aucun compromis et étaient venus pour faire du bruit, leur bruit fait de guitares crasseuses au service d’un rock’n’roll enivrant, véritable bande-son d’un film angoissant dont on a du mal à décrocher.
Seul groupe étranger du festival, les Italiens de Cowboys From Hell ont fait office de tête d’affiche. Avec un nom comme celui-là, vous aurez bien compris qu’il s’agissait d’un tribute band de Pantera engagé pour faire headbanger l’ensemble du public sur une setlist best of du regretté groupe américain. Et si, de base, l’idée d’un groupe de reprises du genre nous laissait perplexe, il a bien fallu admettre que CFH maîtrisait son sujet quasi à la perfection en termes de son et de technique. Tant et si bien que par moment, si nous fermions les yeux, on aurait pu croire en la résurrection de Dimebag Darrell. Quoiqu’il en soit, la tâche fut accomplie et le public conquis par les titres les plus emblématiques de Pantera. Une bien belle manière de terminer ce festival.
NUNSLAUGHTER - "Red Is The Color Of Ripping Death"
Nunslaughter fait partie de ces groupes qu’il n’est plus utile de présenter tant il a roulé sa bosse depuis 1987 (enfin 1985 si on prend en compte les années où il s’appelait Death Sentence). Il s’inscrit dans la lignée des groupes culte qui ne répondent à aucune norme et font ce qu’ils veulent quand ils le veulent. Leur discographie est là pour en témoigner puisque celle-ci pourrait clairement être comparée à celle d’un Agathocles, avec qui ils ont d’ailleurs sorti un split en 2011, tant elle regorge de sorties. Pourtant ce « Red Is The Color Of Ripping Death » n’est que leur 5e album puisque leur « devil metal » est beaucoup plus familier des formats comme le split, l’EP ou encore le live. L’objet que nous avons dans les oreilles fait donc en quelques sortes office d’évènement mais ne change pas la donne puisqu’il s’inscrit clairement dans la droite lignée de ce que les natifs de l’Ohio savent faire : un death punk teinté de thrash sur fond d’imagerie black metal servi par une production on ne peut plus catchy mais loin d’être lisse pour autant. Si la mort de leur batteur Jon Sadist en 2015 a marqué les esprits et forcé le groupe à une mini-pause (jusqu’en 2016), ce dernier a rapidement décidé de remettre le pied à l’étrier, et c’est tant mieux. En effet Nunslaughter est le genre de groupe plus que nécessaire qu’il est bon de ressortir à intervalles réguliers histoire de rappeler à une certaine frange de la scène le sens du mot « authenticité ».
GOAT TORMENT - "Forked Tongues"
On se demandait un petit peu ce qu’étaient devenus les Gantois de Goat Torment puisque déjà 6 ans se sont écoulés depuis leur seconde et dernière offrande « Sermons To Death » qui leur avait permis d’asseoir une certaine réputation sur la scène black. La réponse vient donc ici avec ce « Forked Tongues ». Par contre la question est de savoir s’il réussit l’examen du 3e album souvent charnière dans la carrière d’une formation. Et ne faisons pas languir le lecteur plus longtemps, on aurait tendance à répondre par l’affirmative à cette interrogation. En effet, dans l’ensemble, l’auditeur se confronte à un opus de black furieux et inspiré. Dans un registre parfois mardukien, Goat Torment joue la carte d’une lourdeur empruntée au death dans une tracklist où les parties basses jouent un rôle prépondérant en termes d’enrobage écorché de l’ensemble. Un grain bienvenu auquel Jérémie Bézier (Emptiness…) n’est sans doute pas étranger puisque le mixage et le mastering de «Forked Tongues» sont l’œuvre de l’intéressé au sein du Blackout Studio. Notons qu’à ce niveau, si le groupe n’est pas retourné dans le studio bruxellois pour tout le processus d’enregistrement comme ce fut le cas pour ses 2 premiers albums, il ne s’en est pas non plus tout à fait écarté puisque les voix y ont tout de même été enregistrées. Le travail paie, c’est indéniable, et « Forked Tongues » en est une belle preuve puisque nos compatriotes se voient maintenant affublés du sceau Season Of Mist via sa structure plus extrême Underground Activists qui, on l’espère, amènera Goat Torment sur les sentiers qu’il mérite.
Ça a l’air grave - Aaron
Souvent incompris, parfois même moqués voire injustement critiqués, ils assurent pourtant un travail de l’ombre essentiel. Eux, ce sont les bassistes, les gardiens des fréquences graves. Ils sont la hantise des roadies et de leurs lombaires tant leurs amplis « frigos » pèsent leur poids et sont peu maniables, mais sont aussi et surtout des musiciens généreux au service de leur groupe ou de l’artiste qu’ils accompagnent. Rarement en recherche de gloire, ils ou elles se trouvent souvent en arrière-plan pour incarner, avec la batterie, la paire d’épaules sur laquelle le reste du groupe pourra aisément s’appuyer. Une race à part au service du groove.
C’est le très sympathique et disponible Aaron, bassiste et chanteur de Red Fang, qui nous a accordé quelques instants de plus dans la foulée de l’interview qu’il nous a accordée pour le MA9 (que vous pouvez retrouver en pdf sur ce site, faut-il encore vous le rappeler ?) à l’occasion de la sortie du dernier album des Américains, « Arrows ». Certes brefs, ces quelques mots ne sont toutefois pas dénués d’intérêt en ce qui concerne la vision du bonhomme.
Comment as-tu commencé la basse ? C’était par nécessité. En secondaire, avec un ami, on avait monté un groupe dans lequel on jouait tous les deux de la guitare. J’ai déménagé avec cet ami à Portland et on a cherché d’autres musiciens. On a trouvé un batteur et j’ai switché moi-même vers la basse, ça me paraissait plus simple comme ça. Donc j’ai commencé la musique en tant que guitariste.
Selon toi, quel est le rôle de la basse et du bassiste dans un groupe ? Disons que la plupart du temps je vois le rôle de la basse comme étant une troisième guitare plus lourde et plus grave tout simplement. Je joue donc avec pas mal de distorsion et, en règle générale, je suis la structure mélodique de la guitare. Pour moi, la basse doit être capable de donner le ton du morceau. Mais avant toute chose, le bassiste doit être parfaitement calé rythmiquement avec le batteur, c’est le plus important. Par exemple, dans Red Fang, John (Sherman – batterie) et moi passons beaucoup de temps à définir ensemble une ossature rythmique qui définit le feeling du morceau en fonction des riffs de guitare.
Donc le batteur et le bassiste sont les meilleurs amis du monde ? (rires) Oui tout à fait….ou en tout cas ils doivent être connectés télépathiquement.
Pourrais-tu nous présenter en quelques mots le matériel que tu utilises ? Ma basse est une G&L SB-1, c’est une basse de type « Precision » (un des modèles Fender les plus populaires). Je la joue sur un ampli Sunn Beta Bass. Ce sont des amplis à transistor originaires d’ici en Oregon. Et c’est de lui que vient la distorsion. Et la tête est simplement reliée à un box 4x12. J’ai aussi des micros assez lourds et je suis assez dur avec mes cordes.
Tu joues toujours au médiator ? Presque toujours. Sur certains morceaux, il m’arrive de jouer aux doigts et de switcher sur le mediator pour les parties plus lourdes.
Quels sont tes influences en matière de basse ? Y a-t-il un ou plusieurs bassistes que tu apprécies particulièrement ? Pour ce qui est du bassiste qui a influencé ma manière de jouer, je dirais Rob Wright de NoMeansNo (groupe punk canadien fondé en 1979). Je lui dois beaucoup en termes de son mais il faut dire qu’à ce niveau-là il était lui-même influencé par Lemmy (Motörhead – ndr). Sinon il y a certains bassistes que j’adore comme, par exemple, David Wm. Sims de The Jesus Lizard.
Parmi les morceaux de Red Fang, y a-t-il un titre que tu apprécies particulièrement pour sa ligne de basse ? Un des morceaux les plus funs à jouer est « Throw Up » (sur « Murder The Mountains » sorti en 2011) mais si je dois me pencher sur une ligne de basse, je dirais celle de « Black Hole » qui est un titre qu’on a écrit il y a bien longtemps, en 2007 ou 2008 (bonus track du même « Murder The Mountains »). Il y a aussi une autre partie basse que j’apprécie bien, c’est sur « The Smell of the Sound » (sur le précédent album « Only Ghosts ») parce qu’il s’agit d’accord à la basse. Enfin je ne sais pas si mes parties de basse sont vraiment cools non plus (rires).

HORNCROWNED - "Rex Exterminii (The Hand of the Opposer)"
Fondé en 2001 à Bogota sur les cendres du groupe Inoculation, le groupe colombien Horncrowned n’a jamais changé son lance-roquettes d’épaule si l’on peut dire. Dès ses débuts, la formation s’est inscrite dans un black metal brutal, guerrier et sataniste qui mitraille sévère, ne laisse que peu de répit à l’auditeur et collectionne les visuels explicites qui annoncent la couleur d’entrée de jeu. On peut difficilement faire plus cliché et il ne faudra pas compter sur Horncrowned pour apporter du sang neuf au style si ce n’est celui de l’ennemi dégommé au char d’assaut. Vous l’aurez compris, « Rex Exterminii… » est le genre d’album qui trouvera son public chez les fans d’un black sans concession qui fleure bon le soufre et probablement chez personne d’autre. Plus classique, tu meurs : des blasts incessants, des répétitions de boucles de riffs jusqu’à parfois l’indigestion et une haine viscérale quasi palpable dans le chant. Un black par des passionnés pour des passionnés, c’est le moins que l’on puisse dire. Et si le quatuor sud-américain offre ici un album pour le moins consistant avec ses 44 minutes, il faut bien reconnaître qu’à ce tempo et sans véritable relief, « Rex Exterminii… » donne l’impression de méchamment tirer en longueur alors que l’album recèle de la matière pour deux voire trois EP’s.
ILSA - "Preyer"
On rattrape un peu son retard dans un genre qu’on aime assez avec les Ricains de Ilsa et leur sixième album « Preyer » sorti fin 2020. Ce qu’il y a de pratique avec ce genre d’opus c’est qu’aussi bien grâce à la pochette qu’aux premiers riffs de guitare, on voit directement à quoi on a affaire et on ne s’étonne pas non plus que ce soit un produit estampillé Relapse tant les bons ingrédients s’y retrouvent. Ilsa base sa musique sur le mélange ma foi classique de death et de doom à la Incantation mais où les growls gutturaux auxquels on pourrait s’attendre sont ici remplacés par une voix plus éraillée empruntée au crust. Cette dernière influence qui se ressent aussi dans certains morceaux aux passages plus soutenus rythmiquement comme « Widdershins ». Donc dans l’ensemble c’est bon… mais c’est un peu long. Si les influences des musiciens sont ici bien digérées et les compositions assez inspirées bien que ne criant pas au génie de l’originalité, une dizaine de minutes en moins aurait sans doute pu bénéficier à l’efficacité de l’ensemble.
LA NAUSÉE - "Battering Ram"
One man project mené par le Gantois Jelle de Bock, La Nausée nous arrive avec un premier EP quatre titres en guise d’échantillon de ce que propose le bonhomme. Si l’ensemble des descriptifs qu’on peut trouver par rapport au style musical proposé annonce un projet sludge, nous nous permettrons ici d’être un peu plus nuancés. En effet, si de gros relents de riffs un peu boueux se font entendre, les rythmiques cliniques et l’utilisation d’une certaine dose d’électronique font que La Nausée tâte d’autres terrains comme ceux de l’indus, du rock metal voire du metalcore, le tout avec un chant assez étrangement en arrière-plan du reste dans le mixage. Si le mélange n’est pas inintéressant sur le papier, il gagnerait peut-être dans les faits à être plus cadré si l’on peut dire puisqu’on sent que les idées y sont, mais celles-ci peinent malheureusement à convaincre. Par contre, pour ceux qui seraient désireux de découvrir ce projet en format physique, sachez que cet EP sort en formats CD et cassette des plus présentables.
VALDAUDR - "Drapsdalen"
Si « Drapsdalen » est le premier album du groupe, c’est bien une formation de plus de vingt ans qui se cache derrière puisque Valdaudr est le nouveau nom de Cobolt 60. Monté par le très prolifique Dod (Daniel Olaisen de son vrai nom, guitariste de Blood Red Throne, ex-Satyricon en live, Zerozonic… - ndr) tout au début des années 2000, C60 comptait dans ses rangs Mr Hustler, alors chanteur de BRT de l’époque. Le duo fait son petit bonhomme de chemin en sortant deux albums à dix ans d’écart (2002 et 2012) et pour la petite histoire, le vocaliste quitte son camarade en 2018 alors que celui-ci a déjà plusieurs morceaux en stock pour un nouvel album. Qu’à cela ne tienne, il sera décidé d’utiliser le matos mais sous un autre nom. Accompagné désormais de Vald, chanteur ayant également officié dans BRT (2005 - 2011), Dod peut reprendre les affaires là où Cobolt 60 les avait laissées. Valdaudr (synthèse des pseudonymes de ses deux membres et agrémenté d’une subtilité de la langue norvégienne - ndr) poursuit sur le terrain déjà bien moissonné du black old school norvégien à la Darkthrone avec cependant quelques passages thrashy ou encore folks du plus agréable effet. Les sonorités métalliques et froides de la guitare, de surcroit reconnaissable pour les familiers du travail de Olaisen, alliées à la production roots offrent une autre perspective à différents moments de l’album qui, dans l’ensemble, remplit amplement sa mission.