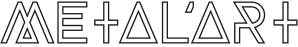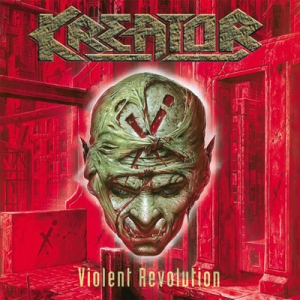Ale
BOX - "Cherry Blossoms At Night"
Est-ce que le nom du projet s’intitule ainsi en référence à l’expression « to think outside the box » ? Aucune idée, mais l’esprit fou du touche-à-tout Andrew Stromstad (encore un one-man-band, à croire que j’ai le nez creux pour le MA16 !) nous transporte dans absolument tous les sens ! La première écoute m’avait laissée de marbre, tant l’album m’a paru décousu. Il est en fait très riche et étonnant dans la multitude de genres qu’il aborde. Ainsi, l’opus s’ouvre par du gros death-trash avec « Succumb », pour se poursuivre avec le musclé et quasi-indus « Pulse ». « Soft Is The Motion » confère à l’opus son attribut prog, tandis qu’à partir de la plage tutélaire, l’album se mute en délire darkwave qu’il ne quittera alors plus vraiment jusqu’à ses dernières secondes. On en regretterait presque qu’après de telles expérimentations, plus de la moitié de l’album s’engouffre dans un style unique. Cela reste plaisant ceci dit, avec un côté moins horrifique et brut de décoffrage que la plupart des titres d’un genre désormais allègrement poncé. En fait, ces titres « darkwave » gardent un côté assez épique et grandiose jusqu’à « Devayne’s Lament », pour ensuite avoir ce côté plus sombre et dansant que peuvent avoir les successeurs de l’EBM sur « Spread ». « Liberate » enfin, cumule les deux genres précédents, pour un titre plus lent, et à la fois grandiose et noir. Un album particulier donc, mais de très bonne facture pour quiconque est un peu ouvert sur ce qu’il ou elle écoute !
NOVA TWINS - "Supernova"
Il faut le dire d’emblée : le nouvel album des Nova Twins n’a qu’un seul défaut, celui d’avoir une fin (et de ne durer qu’une demi-heure, aussi). Tout le reste est 100% pur sucre. Leur premier album (d’une durée équivalente) avait récolté pleinement mes faveurs, et rajoutait une référence majeure à ma longue liste de jeunes artistes à suivre (et de punk féminin explosif). Ce second parvient à faire mieux sur pratiquement tous les points, tout en ne rendant pas le premier album caduc, loin de là. Mais ce « Supernova » est tellement puissant, tellement énervé, tellement inventif, tellement revendicatif et versatile aussi, qu’on a du mal à imaginer que seules deux personnes puissent être derrière un tel projet. L’album débute par « Power », une courte intro qui met littéralement la machine en route. Et elle ne s’arrêtera alors plus. Que ce soit le diabolique « Cleopatra » et son rythme s’agglutinant à nos oreilles, « Puzzles » qui semble tout droit sorti de la BO du jeu « Madworld » et le feu d’artifice que représente « Choose Your Fighter », titre le plus court mais possiblement le plus féroce, il y a vraiment de tout et tout est de haute qualité autant que de haute puissance. Si Amy Love et Georgia South ont eu la malchance de gagner en attention à l’aube des confinements, gageons que ce « Supernova » rattrapera le temps perdu. Si elles ne sont pas encore sur vos radars… Foncez !
SOMALI YACHT CLUB - “The Space”
“Plus c’est long, plus c’est bon » ? Dans tous les cas, ce sont dans les extrêmes que je prends mon pied dernièrement ! Entre titres Garage Rock/Punk bien abrasifs dépassant rarement la minute et grosse épopée contemplative en trois actes comme sur du post-rock, du psyché ou du stoner… Mon petit cœur balance et flanche ! Inutile de préciser que c’est du second cas que l’on va parler aujourd’hui.
D’emblée, le groupe interpelle par son nom qui n’a rien d’un cadavre exquis : il illustre le contraste entre les pirates des temps modernes et les super-riches qui se dorent la pilule dans leurs forteresses aquatiques. Pas besoin de chercher beaucoup plus loin dans les revendications ou symboles du groupe : les textes sont simples et le chant sporadique, usés généralement comme d’un élément supplémentaire, rajoutant de la couleur au son, que comme vecteur d’une histoire. Non pas que le trio ukrainien n’ait rien à dire bien sûr, seulement il faudra aller plus loin que les énigmatiques titres de leurs six chansons, se résumant à un « Gold », « Silver » ou « Obscurum » pour guider nos pensées.
En comparaison à d’autres groupes œuvrant dans la musique atmosphérique et majoritairement instrumentale, Somali Yacht Club ne bascule pratiquement jamais dans l’angoisse, dans le très lourd ou même l’emballement de rythme. Le tout est assez doux, reposant même, et semble hors du temps… et hors du monde aussi (peut-être l’origine du nom de l’album finalement !). J’utilise souvent ce terme « introspectif » en abordant ces genres plus posés et déployant leurs atouts sur le long terme, mais « The Space » est peut-être l’un de ceux illustrant le mieux ce que je veux dire par là : il invite à se déconnecter, à se vider la tête et à simplement savourer. Les voix caverneuses sont douces, les guitares invitent au voyage, et même la batterie nous berce plus qu’elle nous réveille… C’est un pur nuage de rondeur, qui n’a pas ce côté « feel-good » d’un album plus dynamique, mais bien l’effet apaisant d’un voyage initiatique offert par des chansons qui prennent bien leur temps. Le dernier titre, « Momentum », en est le distillat parfait. Douze minutes trente alternant entre quatre rythmiques très différentes : un début lent et impactant, une suite plus en douceur et luminosité, un troisième quart minimaliste au possible… Avant une dernière montée d’adrénaline pour mieux clore l’album, et le triptyque constitué au préalable de « The Sun » et « The Sea ».
Comme souvent pour le style, en disant peu, ils racontent en fait énormément. Et même pour le genre, on est sur une formule d’une sérénité rarement acquise. Mais entamer une écoute doit être un investissement… Écoutez le d’une traite et avec un bon son ! Nul doute que « The Space » sera une parenthèse des plus bienveillantes et bienvenues dans votre journée de métalleux !
PRINCE DADDY & THE HYENA - "Prince Daddy & The Hyena"
À bien des égards, cet album ne devrait pas me toucher autant. Je ne peux pas dire être gros client de ce type de rock introspectif, triste et déprimant. Non pas que ce genre de texte soit chiant, inintéressant ou manquant de richesse, loin de là. Simplement, je préfère voir ces émotions gueulées par un crêteux, ou noyées sous les nappes d’un synthé bien froid et gothique. En matière de rock, je dois bien le dire, ce qui m’émoustille c’est plutôt des rythmiques qui donnent envie de tout casser, des bridges pompeux et de la disto exagérée. Tout le contraire de la douceur désenchantée de Kory Gregory, chanteur et tête pensante du projet. Et pourtant…
Si stylistiquement, on reste sur quelque chose de plutôt sobre et classique, tout l’apparat autour de l’album est assez singulier. La pochette est une photo du cousin du chanteur, ce genre d'images innocentes qui pourtant effraie. Ce noir et blanc semblant faire perdre l’image dans les limbes du temps, et ce déguisement de clown faisant frémir bien des gens à la simple idée de découvrir ce visage maquillé dans un magasin de disque (ou une miniature YouTube, on reste en 2022 hein). La durée des morceaux est très variable : cela va d’une petite minute et demie à plus de huit minutes, en passant par des durées plus usuelles. Les textes sont tantôt crus et outranciers, en atteste un « Jesus Fucking Christ » par exemple. Tantôt, ils font preuve d’une candeur presque juvénile, d’une fragilité émouvante. Mais la vaste majorité de la galette lorgne plutôt du côté du rock léger, un peu punky et ensoleillé du début des années 2000. Ou bien vers ce « rock à road trip et barbecues » que j’évoquais pour le dernier-né des Skeggs. Une description très floue, mais qui signifie, à peu de choses près, que les chansons mettent du baume au cœur, rappelle des jours meilleurs passés entre amis, et quelques souvenirs pas forcément grandioses, mais juste très agréables.
Il est maintenant temps de parler du gros événement ayant influencé la gestation de ce projet : l’accident du chanteur. Un carambolage routier dans lequel il a failli mourir. La source de bien des tourments et d’une fameuse remise en question. Les plus cyniques pourraient questionner le besoin de mentionner un tel trauma dans la promo d’un album, s’il s’agit d’une façon de jouer sur la corde sensible pour mieux le vendre. J’ai envie de croire le contraire, qu’il s’agit plutôt d’une clé de compréhension, d’une mise en perspective. Et surtout : d’une profonde mise à nu. Si l’on peut se demander si un intitulé comme « In Just One Piece » est une touche d’humour noir ou une thématique toute différente, le trio final ne laisse que peu de place au doute : minimalistes, intimistes et tristes, ils ferment l’album de fort belle manière. À la première écoute, je me suis vu froncé les sourcils en découvrant « Baby Blue » après « Black Mold », tant ce dernier et ses presque NEUF minutes m’ont charmée de leur puissance évocatrice. Mais le choix de setlist paraît plus judicieux si l’on perçoit « Baby Blue » comme un épilogue, et « Discount Assisted Living » comme le prélude de cette fin en apothéose. Mais que vous choisissiez de croire que Black Mold est la vraie fin ou non, j’imagine que beaucoup seront d’accord pour dire qu’il s’agit du titre le plus impressionnant, fort et travaillé de l’opus. Une merveille, et sans doute celui que je retiendrai le plus une fois cette chronique refermée.
Alors certes, tout le monde n’est pas client de « journaux intimes musicaux », moi le premier. Et si la plupart des titres sont bons, avec une bonne petite patate et la perspective de souvenirs d’insouciance… Leur sincérité est peut-être aussi leur point faible, car un peu trop lisse dans leur construction. Mais c’est un album touchant, et rien que pour « Black Mold » en clôture, le périple vaut grave la peine d’être parcouru une fois.
KING SATAN - "Occult Spiritual Anarchy"
Si la Finlande arbore souvent une étiquette de « pays du metal », avec son quota de groupes par nombre d’habitants largement plus élevé que la moyenne, et surtout des noms n’ayant plus aucune preuve à fournir en termes de black et de death (c’est que, contrairement à leurs lointains cousins suédois et danois, le heavy et le power ne sont pas trop les styles de la maison). Le genre de l’indus lui reste plus nébuleux, ne comptant généralement que quelques groupes peu connus, en dehors des viviers américains et allemands. À titre personnel par exemple, le seul nom finlandais me parlant au sein de ce style est « Turmion Katilot », qui a déjà eu l’occasion d’apparaître entre nos pages. Et même si je considère leurs deux premiers albums comme des monuments sous-estimés, le reste de leur discographie s’est embourbée dans un classicisme des plus ennuyeux. Dommage.
Autant dire qu’à la réception du troisième opus de King Satan, j’étais bien tiraillé entre deux réflexions préliminaires opposées. D’une part, l’envie réelle et enthousiaste de découvrir un groupe plutôt jeune, pas encore bien connu et provenant d’un milieu peut-être moins susceptible de s’autocannibaliser. Et de l’autre, la peur vraisemblablement partagée par bien des chroniqueurs de tomber sur du désespérément classique, surtout avec un nom comme « King Satan ».
Fort heureusement, le résultat s’apparente davantage à un mélange des deux. Certes, les influences de King Satan sont indéniables (des confrères évoquent Rob Zombie et Ministry de la grande époque, et j’y adhère plutôt fortement), mais c’est un style d’indus qui est sous-représenté de nos jours, tout en restant toujours plutôt cool. On retrouvera moins le côté froid, mécanique et expérimental des artistes les plus fous, mais à l’inverse ils ne lésinent pas sur les instruments plus classiques, notamment de la grosse guitare bien saturée et lourde. Parfois même, on a l’impression de se retrouver face à du power bien musclé et au chant hargneux plutôt que clair. C’est le cas sur « This Is Where The Magic Happens » ou encore le somptueux « The Faces Of The Devil », dansant à souhait, avec un bridge surprenant et où le synthé s’emballe totalement ! Ce dernier est la continuation du morceau d’ouverture, « The Left Hand Path », qui possède des qualités similaires et redonne tout son sens au genre que l’on a parfois baptisé « Dance Metal » (ou « Tanzmetal », tant ces attributs se retrouvent en majorité dans la NDH). « Spiritual Anarchy ‘22 » est encore plus loufoque : il semble tout droit sorti du milieu des années 2000, comme une version plus metal d’un titre de Pendulum. C’est pêchu à l’extrême et n’aurait pas renier sa place dans un jeu de sport de la même période (voire un party game urbain bien obscur sorti qu’au Japon… pour celleux qui voient de quoi je parle)
En bref, j’attendais bien pire de King Satan en préparant cette critique. Les échos de leurs albums précédents faisaient état de chansons déjà entendues ailleurs. Impossible en l’état de vous corroborer ces impressions, le reste de leur discographie me faisant défaut. Mais sur ce « Occult Spiritual Anarchy » en tout cas, j’avoue être conquis. C’est varié, c’est rythmé, et ça ne part pas dans quelque chose de trop edgy ou larmoyant. C’est une pure barre vitaminée distillée sur quarante minutes de fracas. Ne vous arrêtez donc pas au nom… Il y a du bon !
VARIOUS ARTISTS - "Forever Reigning - A Tribute To Slayer"
Les covers, c’est rarement mon truc. Non pas qu’elles soient toutes nulles bien sûr, mais simplement parce que l’accès à l’original est désormais si évident par le biais du net et de ses nombreux outils que je n’y vois pas bien d’intérêt. Pour m’appâter dans ce genre d’exercice, il faut une plus-value. Une relecture des paroles par exemple, qu’il s’agisse d’une parodie ou d’une modernisation. Un changement complet de genre éventuellement, transformant le plus bruyant morceau de metal en sympathique chanson de jazz lounge. Ou encore, pourquoi pas, plonger pleinement dans la fracture d’image, en voyant de gros bonshommes plus proches du guerrier viking que de la pop-star reprendre un titre mielleux et dégoulinant de couleur. « Forever Reigning » ne va pas si loin, mais il ne se contente pas non plus du best of du pauvre.
Certains éléments choquent et d’autres non. Tout d’abord, il s’agit du premier projet lancé par « Satyrn Studios », une idée assez saugrenue. Si surfer sur l’aura incassable des maîtres du Thrash paraît pertinent pour se lancer, il paraît étonnant que personne n’ait trouvé à redire là-dessus, et que l’idée ne provienne pas de Nuclear Blast ou autre label ayant travaillé avec la clique à Tom Araya. Puisqu’on évoque ce dernier, on crève l’abcès tout de suite : aucun des groupes présents ne peut se targuer d’arriver à son niveau. Simple question d’habitude ou élitisme toxique, vous en serez juge. On se contentera de parler d’une différence de style, et du simple fait que personne ne peut chanter du Slayer que Slayer lui-même. Dernier élément au rang des surprises : la plupart des groupes présents sont relativement peu connus de la communauté metalleuse. Même avec ma casquette de chroniqueur, seul « Over Enemy » me disait quelque chose, après avoir remis une critique il y a quelque temps sur un album que j’avais trouvé simplement correct. Les sept autres m’étaient totalement inconnus, mais il n’est pas impossible que j’aille y tendre une oreille curieuse. Ce choix de line-up est enthousiasmant, mais ce qui aurait été encore plus formidable aurait été d’être plus international encore, à la manière d’un « Dirt Redux ». La musique de Slayer et leur rôle de fer de lance du genre auraient mérité de laisser leur chance à des groupes talentueux issus de contrées oubliées. Mais je chipote. C’est déjà cool d’avoir opté pour des groupes aussi diversifiés et méritants ce coup de projecteur. D’autant plus que les États-Unis, pays déjà gigantesque, n’ont déjà pas dû faciliter l’entreprise.
Quant aux côtés moins choquants, il y a déjà la setlist : on commence par South Of Heaven, on termine par Raining Blood. L’évidence même donc, mais qu’est-ce qu’on aurait pu inclure d’autres ? Les dix titres du milieu sont plus variés : il y a du connu et du plus obscur. Toujours une bonne idée pour un album « best-of » que j’appelle aussi parfois « album synthèse ». Certes on ne peut faire sans les classiques, mais présenter 2-3 fonds de tiroir permet justement d’ouvrir le grand public (et aussi les fans « de surface » !) à un catalogue plus large. Bon point donc. Le style des différents groupes se marie aussi plutôt bien au thrash de Slayer : il y a un peu d’indus avec Skrog, de sludge avec « Eulogy in Blood », de death avec Disinter et inclassable avec « Slokill ». Et tout fonctionne plutôt bien, sans trancher de trop avec les originaux (pas de jazz lounge au menu donc). Mentions spéciales pour « Spill The Blood », « Divine Intervention », « South Of Heaven » et le somptueux « Delusions of Savior ». Assurément, mes deux pépites à surveiller de l’album sont Skrog et Distal Descent (et par chance, ils reprennent deux et trois morceaux respectivement !) Mais rien n’est honteux, même sur les morceaux plus anecdotiques ou tout simplement « moins bien » (désolé à Skull Fuckers Inc., mais Raining Blood est vraisemblablement intouchable).
Pour finir, à qui s’adresse l’album ? Ôtez-vous l’éventuelle idée d’une compilation du pauvre, on est loin de ça ! La plupart des reprises sont de bonnes factures et permettent la redécouverte, à défaut de se réapproprier pleinement les différents titres. On est dans l’hommage, pas la réinterprétation. Cela devrait donc plaire aux fans absolus de Slayer ayant déjà tout écouté mille fois, autant qu’aux nouveaux venus ne sachant pas trop par où commencer.
DIAMOND DOGS - "Eye Of The Storm"
« Les néerlandais, pas les suédois » précise le label. Impossible de savoir s’il y a du David Bowie dans l’air par contre. Quoiqu’il en soit, par pure fainéantise, je pourrai recopier presque entièrement ma critique du premier album de Plizzken, tant le travail des Diamond Dogs m'a charmé de la même façon. Pas besoin de me répéter, vous connaissez mes goûts en matière de punk : un rythme éreintant, un type qui gueule, beaucoup de disto et une durée bien concise permettant à la fois de balancer son propos sans fioritures, de ne pas s'ennuyer et de consommer un titre (ou un album entier) comme une praline enflammée par un tourbillon de grosses patates dans la face. Et les Diamond Dogs cochent toutes ces cases ! Mais au-delà de ce cahier de charges rempli à la perfection, il reste une particularité du groupe assez énigmatique : leur univers basé sur le monde médiéval. Courant dans le metal, rarissime dans le punk, cette thématique se retrouve jusqu'à l'esthétique de leur artwork, représentant un templier ou un croisé brutal au milieu d'une bataille d'envergure. Même certains intitulés des titres de l'album semblent lorgner davantage vers le power ou le heavy que le punk traditionnel ("Crusher Of Souls" ou "Eye Of The Storm" notamment, ce dernier entamant l’album par une drôle de litanie). Mais musicalement, on est loin de la joyeuse troupe de troubadours. Ou alors, elle est constituée de trolls énervés. Sitôt les 30 premières secondes de la galette écoulée, on est partis pour une bonne vingtaine de punk qui décoiffe (ha ha), mais qui garde une charpente souvent hard rock dans ses parties instrumentales, lui conférant un côté certes pêchu, mais aussi facile d’appréhension et tout bonnement agréable à écouter. La voix de « Johnny » est peut-être celle qui s’en écarte le plus, avec son chant rocailleux devant poussé pour être entendu derrière la guitare ! La basse n’est d’ailleurs pas en reste, ne brillant souvent que quelques minuscules secondes sur un titre (souvent en début, pour pas perturber les habitudes), mais leur conférant un petit truc en plus, qui met en jambes et permet de reprendre son souffle avant une nouvelle rafale de deux minutes. Citons cependant aussi Neon Nights, qui se permet des passages plus calmes, avec un leitmotiv assez simple mais qui marche. Ou alors « One Track Mind » et ses effets sur le chant ou encore une basse « sautante » du plus bel effet.
Mais assurément, mes deux chansons préférées sont « Crusher Of Souls » et End In Sight » tant elles transpirent la fête, la bonne humeur, les copains, et la bière renversée sur les cheveux. Mouillés de la crête aux pieds, on manque de se fracasser par terre pendant que la musique nous rend sourds. C’est le genre d’ambiance qui fait l’essence même d’un concert punk, quand bien même le concept s’est exporté à la grande niche metal.
Alors oui, à titre personnel, le seul point qui fâche vraiment c’est bien évidemment cette durée. Même s’il est rude de pogoter pendant une heure (et pour un artiste de tenir une telle cadence !), à peine plus de vingt minutes c’est un peu court pour un LP. On aurait volontiers aimé 3-4 titres de plus. Mais c’est du chipotage. Il n’y a plus qu’à espérer que le groupe nous revienne vite, avec une niaque tout à fait semblable. C’est une pure injection de fun !
DEVIL MASTER - "Ecstasies Of Never Ending Night"
Décidément, après King Satan il y a quelques jours, j’ai l’impression de m’acharner sur les noms de groupes faisant appel au Malin. Si on ajoute des morceaux aux titres énigmatiques tels que « Enamoured In The Throes Of Death » ou « Shrines In Cinder », plus encore l’intitulé de l’album et la pochette de celui-ci… J’avoue que je ne pourrai pas vous reprocher si, comme moi, vous vous attendiez à quelque chose d’un peu différent. Plus proche de VR Sex ou de Lebanon Hanover par exemple. Mais exit ici le post-punk, et bonjour le punk tout court ! Assez surprenamment, le groupe déploie ses thématiques occultes sur fond de punk thrashouille plutôt pas dégueu, mais pas toujours très inspiré non plus. Non pas que le clash soit choquant ou inintéressant, au contraire, je suis plutôt client des acoquinements saugrenus, donnant parfois des résultats formidables (nombreux sont les vidéastes autant que les musiciens professionnels en ayant fait une spécialité d’ailleurs). Non, ce qui démange un peu, c’est le fait de ne pas savoir exactement sur quel pied danser. Il s’agira peut-être davantage d’une appréciation subjective qu’une critique pertinente, mais l’album m’aurait bien plus goûté si chaque morceau ressemblait un peu plus à celui d’entrée et celui de clôture (« Ecstasies… » et « Never Ending Night », de leur petit nom). Ils s’insèrent largement plus dans cette atmosphère « death rock », sorte de punk gothico-horrifique à l’atmosphère lugubre. C’était davantage ce que je recherchais ici, mais on ne boudera pas son plaisir face à l’un ou l’autre titre entêtants, comme l’énervé « Acid Black Mass » par exemple. Une chose est certaine en tout cas, le groupe m’a emmené là où je ne l’attendais pas, et rien que cela mérite le détour ! Quant à moi, je ne balaye pas le travail de Devil Master au contraire : ils m’ont intrigué. Et j’espère qu’un éventuel troisième opus viendra s’insérer plus fermement dans l’un ou l’autre genre.
ANIMALS AS LEADERS - "Parrhesia"
La musique classique déployait déjà des morceaux colossaux. Longs, grandioses, tout en démesure et alternant judicieusement les rythmes et les sons pour nous faire vivre un récit. Chaque titre devenant alors une microhistoire, s’imbriquant souvent au sein d’un concert entier. Par cette construction, les compositeurs pouvaient alors nous émouvoir sans pour autant faire usage de la parole. Ce drôle de préambule n’apprendra strictement rien aux fans de musiques progressives, de post-rock et autres stoner-ies, mais il paraît important de le rappeler. Notamment pour les quelques mélomanes pensant encore qu’un morceau de plus de cinq minutes est un titre chiant. Ou que toute la musique électronique n’est « que du bruit ».
Fort heureusement, si vous êtes lecteur de Metal’Art, j’ose croire que votre curiosité et votre ouverture d’esprit sont suffisamment grandes que pour balayer ces préconceptions éculées. Car dans ce cas, le nouvel opus d’Animals As Leaders vous attend pour un fabuleux voyage.
Les fans de la première heure ne seront pas dépaysés. Si j’ai eu la « chance » de ne découvrir le groupe qu’il y a quelques mois à peine, les fans auront dû attendre six longues années pour retrouver le trio, pourtant si prolifique à ses débuts (quatre albums en sept ans, c’est propre !). À ce sujet, il y aura sans doute les deux catégories habituelles : celles et ceux ravis de retrouver quelques nouveaux titres à ajouter à leurs playlists. Et les autres, un peu déçus d’avoir attendu si longtemps pour voir une formule presque inchangée. Difficile néanmoins de croire que toute personne amatrice de leur musique restera sur sa faim face à cet album qui s’écoute tout seul.
On y retrouve du pur flex à la basse, source d’admiration autant que de jalousie pour tout bassiste en herbe (dont je fais partie !). C’est de rigueur dans tous les genres instrumentaux « post-quelque chose », mais ça fait toujours plaisir après avoir avalé divers albums plus mainstream où elle est si discrète. AAL ne lésine pas sur la virtuosité et nous régale pleinement. Les différents titres, aux noms évocateurs, ne tranchent pas non plus avec la tradition du groupe. Ne rêvez-vous pas de découvrir ce qui se cache derrière « Monomyth » ? Ou bien l’énigmatique « The Problem of Other Minds » ? Des exemples où l’on verrait bien des longues tirades lorgnant entre la thèse académique et le discours effrayant d’un culte fou. On se contentera ici de faire parler la musique, et elle le fait impeccablement bien. Le non moins surprenant « Asahi » se veut très ambiant, presque réconfortant. Donnant l’impression d’être paisiblement en train de contempler le ciel ou la mer. « Gestaltzerfall » et son nom plutôt inquiétant (« chute de la forme », ou « décrépitude de l’être », si on le traduit de manière approximative) tranche avec son rythme bicéphale. Il s’emballe parfois dans un cataclysme de percussions, pour revenir ensuite à une relative accalmie avec quelques riffs à la fois entêtants et qui groovent.
Alors, comment conclure tout cela ? Sans doute en vous réclamant de vous munir du plus grand confort d’écoute possible, de limiter les distractions au maximum et de simplement vous vider la tête en vous préparant pour ce beau périple. Ce n’est pas trop osé que de parler de la musique d’AAL comme d’une expérience. Ils sont incontournables si le genre vous parle, et ce nouvel album est autant une porte d’entrée impeccable qu’une occasion de replonger dedans.
OTTONE PESANTE - "…And The Black Bells Rang"
Si dans presque un mois pile nous retrouverons le trio italien à Gand (enfin un peu de concerts que diable !), ce nouvel EP pourrait aisément servir de carte de visite à ce groupe atypique… Ou un avant-goût de ce qui nous attend peut-être sur leur prochain album. Quoiqu’il en soit, cette nouvelle salve surprend par son caractère très pluriel. Moins linéaire que DoomooD, leur album précédent (qui avait reçu une belle critique de la part de votre serviteur), il mise au contraire sur la versatilité, sur le déploiement d’horizons nouveaux comme anciens, avec quatre titres à la musicalité fort différente. Seul le dernier morceau, baptisé « Rules of War » (ou « Scrolls of War » dans le press kit… allez savoir…) rappelle les meilleures heures de Doomood. Totalement atmosphérique, épique à souhait et avec des cuivres sonnant comme des appels au combat. Fabuleux !
Le reste de l’EP n’est pas du tout en reste. « Black Bells of Destruction » est un joyeux bazar sombre, accompagné d’une voix éraillée qui donne un côté sauvage, presque death metal à l’ensemble. Et la folle batterie n’est pas étrangère à ce sentiment. « Carne Marcia » garde un côté puissant et effréné, mais s’assagit par à-coups, pour mieux faire beugler les cuivres, de manière presque jazzy cette fois. Si l’on ôtait l’apparat obscur de ce morceau, il pourrait sans peine faire office d’apothéose d’un concert jazz tout ce qu’il y a de plus classique. « Die Ewige Wiederkunft Des Gleichen » (à vos souhaits) est le plus planant de la galette, et se garde bien de nous livrer ses plus puissantes cartouches pour son dernier quart. Avant cela, on se tape cinq minutes de préliminaires délicieuses, oniriques à en crever avant de basculer dans le plus noir cauchemar. À la manière d’un film à suspens, il aime prendre son temps et il a bien raison. Il nous berce pour mieux nous bousculer… Il est froid et lugubre, mais aussi diaboliquement envoûtant. Un véritable exemple.
Alors je l’admets : la constance de Doomood m’a goûté un rien de plus. Si ce n’est parce que l’album donnait davantage l’impression d’un tout, racontant pratiquement une histoire avec une économie de mots exemplaire. Mais que cela ne vous freine pas du tout : Ottone Pesante déballe tous ses talents sur la table et montre que l’idée n’a rien d’une blague ou d’un délire vite essoufflé. Les possibilités sont manifestement nombreuses, et il nous tarde de voir quelle(s) direction(s) ils emprunteront ensuite.
LE TUNNEL DE L’ENFER - "A Tribute To Daylight"
Le concept de « concept album » est généralement une lame à double-tranchant. Que l’on soit fan du principe ou pas, il y a toujours un risque de lasser son public en traitant des mêmes thèmes, surtout si on reste musicalement sur quelque chose de constant aussi. « Le Tunnel De l’Enfer » nous prouve qu’il n’y a pas grand-chose à craindre. Déjà parce que leur EP fait environ la durée de deux chansons alors qu’il en compte sept (ça m’apprendra à vouloir du punk à l’ancienne !), mais aussi et surtout parce qu’ils sont pratiquement un groupe-concept, basé sur les films d’actions à l’ancienne, bien burnés, aux one-liners de brutasses bien ringardes et aux explosions nombreuses.
L’idée est loin d’être neuve, et on pourrait même dire que les années 2010s se sont efforcées de jouer sur cette corde nostalgique spécifique. Expendables au cinéma (quand ce n’était pas la continuation de franchises héritées de cette époque, Terminator ou Rambo en tête). Broforce ou la présence de Robocop en jeux vidéo. Et c’est sans compter les croisements avec la synthwave, néons et autres mouvements plus esthétiques, où l’on se retrouve alors avec des Kung Fury, des Far Cry Blood Dragon et j’en passe…
Ici pourtant, on a quand même l’impression de quelque chose de réellement neuf. D’une part, le groupe s’intéresse ici au film « Daylight » (ou « Le Tunnel de l’Enfer » au Québec… malin !) qui n’est pas forcément le métrage le plus connu du bon vieux Stallone. Mais en plus, ils chantent le film dans une cacophonie fracassante, dégoulinante même, qui ne nous accorde que de courtes accalmies lorsqu’ils emploient des voix samplées… Pour mieux nous retabasser derrière, évidemment ! Cela en fait un produit finalement assez difficile à évaluer franchement : peut-on juger des chansons si courtes, voire un album si court ? La musique proposée est austère pour le non-initié, mais c’est presque là le but avoué. Le groupe nous crache presque au visage, sans que l’on comprenne bien ce qui nous arrive, et on en redemande volontiers ! Le faut-il vraiment cependant ? Pas sûr que l’on tiendrait un album entier face à une telle cavalcade auditive… C’est bon, c’est puissant, c’est éreintant. Mais fiou, que ça fracasse !
Pour couronner le tout vis-à-vis de ce projet atypique, ce dernier est né et a évolué sous le prisme du covid… Ce qui signifie, dans les grandes lignes, que chacun s’est enregistré chez soi. Pour ensuite façonner ce drôle de patchwork bouillonnant à distance. Alors oubliez ce « 4/5 » : cet EP est inclassable et in-chroniquable. Il est un concentré de rage pure. Par contre, pas de doute : si les ingrédients sont connus, on n’avait rarement entendu quoique ce soit de ressemblant. Et rien que pour cela, y tendre une oreille prudente peut valoir la peine. Sans doute moins pour les fans de Sly que les keupons à la crête grisonnante qui veulent slamer sans interruption pendant la durée de cuisson d’une pizza surgelée. Et il y a peut-être que chez nous qu’on percevra ça comme un compliment !
TURKEY VULTURE - "Twist The Knife"
Il y a quelque chose de résolument beau et courageux dans l’idée de l'homemade. Oser le pari de tout faire soi-même, quand bien même on aurait l’une ou l’autre faiblesse, pour ensuite le diffuser aux yeux de tous… C’est tout bonnement admirable, et si tant est que la démarche soit sincère, on ne pourra qu’attribuer à ces artistes téméraires (et un peu fous) des critiques constructives, des conseils avisés et la petite lueur d’espoir qu’ils arriveront à faire de grandes choses, si tant est que cela soit là leur ambition. Fort heureusement, il ne faut pas voir dans cette courte introduction une quelconque mise en garde ou une quelconque marque de pitié. Le travail du couple derrière Turkey Vulture paraît étonnamment propre, délicieusement énergique et accompagné d’une bonne dose d’auto-dérision.
« Trop punk pour être metal et trop metal pour être punk », disent-ils de ce troisième EP. Et je dois bien l’admettre : si le monde du metal recèle encore de nombreux mystères et genres inexplorés, celui du punk, par contre, m’est plutôt connu, en tant que premier amour (et responsable de mon incursion dans le rock de manière plus générale). De fait, cela aura perverti mon jugement de manière particulièrement sévère, poussant à fustiger de nombreux « travers », convenances et autres caractéristiques somme toute subjectives de ce que le punk est ou n’est pas. Dans le cas de « Twist The Knife », cela me pousse donc à grossir le trait sur la dimension metal des morceaux, éloignée d’une conception rigoriste flirtant avec le gatekeeping… Ce qui paradoxalement est tout sauf punk.
Mais ce côté plus lourd n’a rien d’un parasite, loin de là. Totalement assumé, ce croisement des genres fonctionne plutôt bien au sein de la musique de Turkey Vulture. « Livestock On Our Way To The Slaughter », seul titre à dépasser les trois minutes, est une petite bombe qui groove, avec ses gros riffs qui font rouler des épaules dans un style à la fois old-school et totalement énervé ! Le chant clair s’acoquine d’un peu de growl, pour un effet saisissant. Les paroles donnent également l’impression d’un texte engagé, dénonciateur… Du moins jusqu’à ce que l’on apprenne qu’il s’agit d’une référence à « They Live » ! J’aime à croire que ce sentiment n’a rien d’anodin, et que ce double-niveau de lecture renforce le titre. Ce n’est pas la seule référence à la pop-culture qui se soit glissée sur l’EP : Fiji évoque quant à lui « The Truman Show », et se veut un rien moins écrasant que « Livestock… », mais plus péchu. Lui aussi n’est pas excessivement explicite dans l’hommage, et c’est un très bon point : hormis dans la parodie, les références à outrance ont tendance à m’ennuyer car souvent trop faciles, cannibalisent leur source jusqu’à en faire disparaître leur touche personnelle. Ajoutons que le pont du titre, avec ses passages distordus, est un vrai bonbon dont on regrette seulement qu’il soit si court ! C’est peut-être le plus gros point noir de l’EP : chacune des chansons, « Livestock… » mise à part, aurait gagné à avoir une demi-minute supplémentaire pour consolider leurs bases solides, et finir avec davantage d’aplomb. Cela aurait permis de pousser leurs idées plus loin encore.
« Where The Truth Dwells » surprend encore, avec une basse plus marquée et une thématique loup-garou cette fois ! Mais le vrai clou du spectacle (et le plus punky de tous !) reste le titre de clôture : « She’s Married (But Not To Me) ». C’est le titre foutraque, celui de la bonne humeur, celui qui rigole dans l’adversité. Un titre pareil annonce déjà la couleur, et le duo ne déçoit aucunement. Il donne envie de sauter, de coller des patates qui renversent la moitié de la bière de ses potes, le tout en s’amusant de cette situation pas vraiment drôle, mais dont il vaut certainement mieux en rire.
Soulignons encore une fois la production très clean de l’ensemble avant de clore cette chronique. Non, décidément, ce plaidoyer en faveur de l' homemade ne quémande pas l’indulgence auprès de ces artistes. Il invite au contraire à se pencher sur le méconnu, sur l’honnêteté, sur la simplicité. Turkey Vulture possède assurément un charme, et « Twist The Knife » est une friandise aussi brève que survoltée, que l’on ne peut qu’écouter avec le sourire. Après trois EPs, on ne peut que leur souhaiter l’impossible : un album complet !
AT THE MOVIES - "The Sound Of Your Life Vol.1 & 2"
La promesse d’At The Movies est relativement simple : proposer des covers de musiques de films célèbres de notre enfance/adolescence (ou celle de nos parents… On parle des années 80 et 90 après tout !). Il ne s’agit pas forcément de bandes originales, mais parfois simplement des titres iconiques rendus populaires grâce à leur présence dans des films aussi divers que Rocky IV ou Collège Attitude. Personnellement, j’associe plutôt les années 1990 à de la grosse techno un peu kitsch, je dois bien avouer que je ne vois pas comment ils auraient pu transposer Matrix, Blade ou Mortal Kombat sans avoir un résultat à la KMFDM. Et ce n’est pas trop le style de la maison.
En effet, si le résultat s’apparente un peu à la myriade de reprises metal que l’on peut trouver sur Youtube depuis une bonne dizaine d’années, « At The Movies » n’a rien du zickos amateur qui amuse la galerie avec des covers de morceaux pop dans un style volontairement excessif, bien que leur qualité puisse varier du plaisir coupable à la surprise pleine de talents… En passant par le « ironiquement mauvais, et donc drôle ». Non non : At The Movies est un super groupe, comportant des pointures allant de Soilwork/Night Flight Orchestra à King Diamond et Hammerfall. Avec un tel line-up, il semblait difficile de faire autre chose que du hard rock bien mélodieux, touchant du bout des doigts le heavy aux relents sympho et le power. Mais il en résulte une petite déception venant ternir le résultat : les deux disques sont assez monotones.
Loin de moi l’idée de prêter au projet des ambitions qu’il ne tient pas. Il est très probable qu’il s’agisse d’un délire de potes musiciens, d’une envie de jouer sur la corde nostalgique pour le simple plaisir de le faire et plus généralement : de proposer deux opus légers, faciles d’écoute et rappelant de beaux souvenirs aux cinéphiles (ou non) de la communauté metalleuse. Et en ce sens, le pari est bigrement réussi. La sélection de titres est plus que pertinente, avec un bon mélange de films et rien de trop obscur pour quiconque allait au cinéma dans ces années-là. Mais il faut avouer qu’une fois qu’on a écouté deux ou trois morceaux, on les a tous écoutés. Il aurait sans doute été bénéfique, mais bien sûr plus compliqué, de varier les styles et donc proposer un véritable patchwork de ce que la scène metal peut proposer. Mais tout dépend aussi de ce que l’auditeur cherche : la créativité au prix de reprises parfois ratées ? Ou la cohésion d’un produit total, au risque d’une petite lassitude ? Mon avis se range plutôt du côté de la première option, d’autant plus que les bons exemples ne manquent pas (le mythique « For The Masses » rendant hommage à Depeche Mode avec des groupes aussi divers que Hooverphonic et Rammstein. Plus récemment « Dirt Redux » ou « Black Waves of Adrenochrome », albums-hommages à Alice In Chains et Sisters Of Mercy respectivement, dont le line-up gargantuesque proposait des variations de style exemplaires).
Ce n’est d’ailleurs pas faute de retrouver cela sur Youtube non plus : si un Erock, un Frog Leap Studios ou un Pellek affichent un style comparable à ce que propose « At The Movies », quelqu’un comme Anthony Vincent et sa célèbre série des « Telle chanson en X nombre de styles » évoque la seconde de fort belle manière. DJ Cumberbund, s’il ne se limite pas au metal, propose aussi des mashups hallucinants : Rammstein croisé avec Wild Cherry ? Il l’a fait ! Ozzy mélangé à Earth, Wind And Fire? Pareil ! Ils valent clairement la découverte, et correspondent davantage à ce que je cherche.
Mais le fait est qu’en tant que chroniqueur, on n’écrit pas pour soi, et donc la constance d’At The Movies vous parlera peut-être davantage. De plus, il serait malhonnête de blâmer ces artistes pour avoir fait ce qu’ils font de mieux : du mélodique, du chant clair et de la musique plus accessible que ce que les trve et autres metalleux plus extrêmes souhaiteraient. Accessible ne voulant par ailleurs pas dire mauvais ou commercial… Ce projet reste tout à fait convenable et appréciable.
La conclusion serait donc, d’une certaine façon, qu’il ne faut pas chercher trop loin vis-à-vis de « The Sound Of Your Life », ce n’est pas le but. Il n’a probablement jamais été pensé comme l’album du siècle, mais vraiment comme de la musique plaisir. Et il remplit totalement son office.
SCHWARZER ENGEL - "Sieben"
Il n’y a que peu de temps que j’ai perdu tout espoir de retrouver un jour le son primal de la Neue Deutsche Härte (celles et ceux ayant lu ma chronique sur le dernier Schattenmann savent que ça date plus ou moins de ce moment-là). En poussant la critique à son paroxysme, on se demanderait presque si le genre à un jour tenu sur ses deux jambes, tant on a l’impression que seuls les débuts de carrière d’Oomph ! et Rammstein portent l’estampe de ce « tanzmetall » aussi expérimental que froid, aussi lié à ses racines industrielles qu’harnaché à de gros instruments qui tabassent, ce côté martial renforçant l’aspect biomécanique lugubre de la musique. Même les deux gros noms ont mal supporté le passage à l’an 2000, et il en va de même pour les groupes qui les ont suivis.
Pourquoi diable persister dans cette voie qui de toute évidence ne me plaît pas ? Difficile à dire… Dans l’espoir de retrouver au moins un fragment de ce terreau sous-exploité sans doute. L’envie d’y retrouver un simple style indus aux textes germaniques, d’y retrouver du metal qui fait mumuse sur des synthés et autres outils informatiques pour donner l’illusion de sons produits par on ne sait quelle machinerie lourde. D’y retrouver un metal qui donne envie de tortiller du cul en cosplay de Matrix. Pour qu’au final… Le résultat ne comporte, au mieux, que l’influence noire des textes les plus glauques que le genre a pu offrir. Bien souvent, on se retrouve surtout avec du larmoyant en allemand. Et malheureusement, vous l’aurez compris, Schwarzer Engel en fait totalement partie.
J’ai eu l’occasion de chroniquer « Kreuziget Mich » (« Crucifiez-moi ») il y a un peu plus d’un an de cela. Un simple EP, doté d’un remix du single et de deux autres titres, dont un orchestral. J’en avais été assez peu impressionné, avec un aspect industriel trop peu mis en avant, et les deux titres accompagnant la chanson phare relevant de l’anecdotique. Je suis assez surpris de revoir l’EP (débarrassé toutefois du remix) en tête de gondole de « Sieben », même si ce dernier était en fait censé sortir fin 2020 (d’où le choix curieux de sortir un premier jet à l’époque et la suite en 2022). Plus exactement, il est étonnant de le revoir en l’état, sans modifications majeures et dans l’ordre ! Mais cet EP était aussi annonciateur des défauts à venir. Mes méconnaissances sur la discographie plus large du groupe appauvrissent mon opinion, mais le manque de folie sur la partie électronique me dérange fortement. Cela manque de peps, d’inventivité. À la place, on se tape beaucoup de morceaux plutôt émotionnels, lents et que l’on imagine poétiques. Sans juger de la qualité des textes (mon allemand étant ce qu’il est), je jugerai plutôt de la relative redondance dans les « atmosphères » proposées. Avoir des instants plus relaxés, plus sensibles n’est pas un mal en soi. On a parfois même des albums entiers dédiés à l’intimité d’un auteur, à une approche plus minimaliste ou tout du moins plus calme. Ici néanmoins, on ne peut s’empêcher d’avoir un peu l’impression de tourner en rond et dans le « romantisme noir » pourtant promis. Nul doute qu’une bonne compréhension du texte devrait rattraper les quelques lacunes instrumentales. Parce qu’en l’état, la ritournelle entêtante de « Vollmond » est un peu faible pour sauver le tout.
Reste alors les quelques titres usant d’un peu plus d’électronique donc. Ce qui fait paradoxalement de « Kreuziget Mich » l’un des meilleurs de la galette. Copie conforme de son pendant 2020, il ne rivalise pas avec les classiques mais s’en sort pas trop mal. « Ewig Leben » fait cracher les guitares, et ça fait DU BIEN ! Son côté indus reste faiblard mais il est moins timide. Mais paradoxalement, mon morceau préféré, c’est celui de la fin (proprement nommé « Endzeit »). Il donne tout ! Il est plus musclé, plus efficace (il a même des « HEY ! » digne d’un hymne de stade !) et avec un petit côté épique en plus qui le rend… franchement sympathique. Sans renoncer à l’émotionnel teinté de poésie noire, semblants si cher au style de l’Ange Noir, gagner un ou deux titres de plus de cette trempe aurait fait plaisir. Ne serait-ce qu’en guise de pause jouissive, de titre plus dansant.
Alors voilà, j’ai pu mentionner à plusieurs reprises mon profond respect pour les artistes réalisant tout en solo. Dave Jason n’échappe pas à cette règle et je salue son audace. Mais il n’est pas un cas isolé, pas même dans le monde de l’indus ou du gothique (loin de là, ça semble presque être une norme, en attestent Assemblage 23, Hante ou Author & The Punisher). Une telle répétitivité et un tel manque d’audace est donc difficilement justifiable. Les membres de Rammstein parlaient d’eux comme d’une « thérapie » ou d’une « démocratie » pour expliquer la force de leur barque, au line-up inchangé depuis presque trente ans. Implicitement, ils évoquaient aussi l’apport créatif que peuvent avoir six têtes plutôt qu’une. Peut-être Schwarzer Engel serait plus incisif et mémorable dans la tête de plusieurs artistes. Mais dans celle de Dave Jason… On s’y ennuie fortement. L’album est-il interchangeable dans la discographie de SE ? Je ne saurai vous le dire. Il l’est en tout cas dans la grande masse d’artistes évoluant dans le genre depuis une bonne quinzaine d’années.
KREATOR - "Violent Revolution"
Lorsqu’on évoque le genre, on aura tendance à parler de ses deux âges d’or : les fastueuses années 80, et le retour en force au milieu des années 2010 (qui se poursuit aujourd’hui). On parle parfois des années 90 comme de l’âge sombre, mais la décennie 2000 semble totalement occultée. Comme si rien de bien signifiant n’était sorti ces années-là. Il y a eu quelques sorties sympathiques pourtant, comme ce « Violent Revolution » qui vient de souffler ses vingt bougies. Il nous a gratifié de quelques titres mémorables, repris en tournée par la suite (la plage tutélaire, mais aussi « Servant In Heaven » ou « All Of The Same Blood »). Fait assez remarquable, tant les groupes « traditionnels » semblent se reposer sur leurs classiques pour caresser les fans dans le sens du poil. Je leur donnerai volontiers quelques autres titres tout aussi bons mais plus rarement mentionnés comme « Replicas Of Life » ou « Slave Machinery », avec leurs bridges mémorables et leurs passages un peu plus calme (pour du Thrash du moins… !) C’est d’ailleurs une force de Kreator : celle de pouvoir sonner bien tout en poussant moins dans les aigus et en gardant un tempo raisonnable, parfois même fort mélodieux, comme retrouvant ses racines Heavy (non pas sans exception, comme l’excellent « Bitter Sweet Revenge » qui semble jouer sur tous les fronts !). Je doute que « Violent Revolution » soit l’album le plus obscur du catalogue des allemands… Mais replonger dedans est toujours un plaisir, même deux décennies après.
Nanowar of Steel
Nanowar, comme pas mal de groupes de rock/metal parodiques, a connu le succès un peu tardivement avec un album plus facile d’accès, parlant à un plus grand nombre. Ultra Vomit a eu son Panzer Surprise, Nanowar a eu son Stairway to Valhalla. Voir donc le quintet revenir à la charge avec un album respirant totalement l’italianité était quelque peu surprenant. Si cela a été le point d’ancrage de l’interview, une analyse approfondie des paroles rend compte d’idées parfois drôlement engagées, enracinées dans l’histoire et la culture historique et moderne d’un pays pas toujours bien connu au-delà des cartes postales. On en a discuté avec Edoardo, alias « Gattopanceri666 »
Salut ! Bravo pour ce nouvel album ! Pour directement lancer mon pavé dans la mare, je voulais comprendre pourquoi vous vous êtes mis en tête de sortir un album 100% italien, avec des chansons traditionnelles, des références et même un chant totalement lié à l’Italie ! Après avoir explosé avec « Stairway to Valhalla », c’est un choix audacieux ! Pourquoi avoir décidé de faire ça maintenant ? Hello ! Cela fait partie de notre projet à long-terme, celui de commencer une école de langue itinérante pour apprendre l’italien autour du monde. Après tout, nous n’avons aucun talent hormis celui de parler notre langue maternelle, c’est la seule chose que l’on peut offrir ! Donc on s’est dit que l’on pourrait en profiter en donnant envie aux gens de l’apprendre. Ainsi, les gens viendront nous voir en concert, mais la leçon ne durera qu’une heure et demie !
Je vois ! Et votre label s’est-il opposé à cette idée de sortir un album purement italien ? Avez-vous rencontré le moindre obstacle vis-à-vis de ça ? Ils nous ont juste dit « scusa ragazzo no parlo italiano pizza mafia arrivederci » [sic] !
L’album conserve malgré tout votre humour si particulier qui a su plaire aux gens. Même en ne parlant pas italien, j’ai trouvé « La Polenta Taragnarok » et « Gabonzo Robot » vraiment funs tout en étant sympas à écouter par exemple. Était-ce votre espoir pour vos fans ne parlant pas forcément votre langue ou non-familiers avec la culture italienne ? Oui, c’était notre façon de penser. Mais comme je le disais, on espère surtout que nos fans viendront assister à nos cours… c’est-à-dire nos concerts !
Puisqu’on en parle, vous avez sorti un clip pour « La Polenta Taragnarok » il y a quelques semaines. En fait, vous avez sorti pas mal de vidéos pour vos deux derniers albums ! Est-ce un exercice que vous appréciez particulièrement ? Comment se passe la réalisation d’un clip pour Nanowar ? Je trouve d’ailleurs que “Norwegian Reggaeton” est toujours l’un des meilleurs clips de votre vidéographie ! On aime bien sortir des clips parce qu’en plus de notre statut de professeurs d’italien, nous avons toujours rêvé d’être youtubeurs. Et si je peux te révéler un secret ancestral : pour être un bon youtubeur, il faut sortir des vidéos ! C’est uniquement pour cela qu’on le fait. Dans tous les cas, notre processus de création se passe à peu près comme ça : « On a une idée ! Est-ce qu’elle est stupide ? Oui ! Est-t-elle bizarre ? Oui ! Est-t-elle gênante ? Oui ! Est-t-elle coûteuse ? Oui ! Alors c’est parti, on fait ça ! »
Dans « L’assedio di Porto Cervo », une amie italienne (qui m’a beaucoup aidé à préparer cette interview !) m’a dit qu’elle parlait énormément d’antifascisme, avec de fameux boulets rouges tirés sur l’extrême droite. Et je n’évoque même pas « La Marcia Su Piazza Grande » qui en parle encore plus ! Je ne vais pas m’avancer outre-mesure puisque je connais très peu la vie politique italienne, mais je suis surpris de trouver des thématiques aussi fortes dans vos chansons. Je suppose que ce sont des sujets qui vous tiennent beaucoup à cœur malgré tout ? Mon amie se demandait aussi pourquoi parler de la Sardaigne en particulier ? Je suppose que t’évoque plutôt « La Marcia su Piazza Grande » en parlant de chanson anti extrême droite ? Il y a un peu de ça, je veux dire se moquer de la rhétorique fasciste, mais ce n’est pas le plus important pour nous. On voulait surtout se marrer. Je veux dire… La chanson parle de Giancarlo Magalli, un présentateur italien très connu (et quelqu’un d’assez simple et amusant de ce qu’on en sait). Et ouais, on en a fait un dictateur fasciste ! Simplement parce qu’on trouvait ça drôle d’en faire un dictateur sans pitié. Quant à la Sardaigne… Et bien l’album parle du pays dans son entièreté, donc on DEVAIT parler de la Sardaigne, il s’agit probablement de la plus belle région d’Italie.
Il y a aussi votre premier single « Der Fluch des Kapt’n Iglo »… Pourquoi avoir choisi de faire un clip pour la version allemande du titre et non l’italienne ? D’ailleurs, j’ai eu l’impression à la lecture des paroles d’une pique lancée à la pêche intensive et aux géants de l’agroalimentaire. En comparaison à Stairway to Valhalla, on dirait que vous vous lâchez davantage sur les idées politiques ! En fait, on a fait deux vidéos pour la chanson… En allemand comme en italien ! J’avoue ne pas trop comprendre ce que t’entend par chanson politique, sauf si t’estimes qu’il est politique de faire une chanson sur un vieux mec qui vend des bâtonnets de poissons surgelés !
Oh désolé ! Ceci dit, je suis aussi étonné de trouver un titre en allemand et même un autre en espagnol sur un album aussi « italien ». Bien qu’impressionné par les capacités de votre école de langue, je me demande les raisons de ces auto-reprises : un défi ? Pour la frime ? Avez-vous beaucoup de fans dans ces pays ? Tout simplement parce que ça sonnait bien et que ça paraissait avoir du sens ! J’ai vécu en Allemagne et en Espagne et j’étais familier avec le Kapt’n Iglo. Et aussi parce qu’en Espagne, il est courant de se moquer des petits vieux qui passent leur journée à épier les sites de construction… Une curiosité que l’on retrouve aussi chez les vieux italiens ! Cela nous semblait pertinent de traduire cet humour dans ces deux langues.
Pour revenir une fois encore sur « La Polenta Taragnarok », c’est un titre qui a fait mourir de rire mon amie italienne, alors que moi j’étais juste occupé à kiffer le morceau sans rien comprendre ! Elle paraît aussi être la chanson la moins directement critique de l’album. Oh c’est très clairement la chanson la plus importante de notre album parce que d’une part Giorgio Mastrota, le héros de notre enfance, nous accompagne au chant dessus. Et d’autre part parce que nous vendons de la polenta sur notre webshop ! Ce n’est d’ailleurs pas une chanson très politique selon ta définition car elle ne parle pas de fish sticks.
Pour aborder le dernier clip, celui sur Gabonzo Robot, j’ai cru comprendre qu’il mettait en scène un robot très connu en francophonie également. On l’appelle « Goldorak » ici ! Néanmoins, votre robot ne paraît pas très sympathique… Qui est-t-il précisément ? Il fait référence à quoi ? Gabonzo est un robot qui est apparu pour la première fois dans les bande-dessinées de Dr.Pira en 1999. C’est un robot avec une grande éthique, qui détruit tout et tout le monde, sans se soucier de leur âge, de leur genre, leur ethnie, leur santé physique, leur nombre de jambes ou leur groupe préféré. C’est le robot du futur, qui permettra d’atteindre la société la plus parfaite possible.
Vous avez réuni une liste impressionnante d’invités pour l’album aussi ! Fleshgod Apocalypse, Trick or Treat, Frozen Crown… L’album est très clairement italien à 300% ! Comment sont nées ces collaborations, qui a contacté qui ? Était-ce chouette à faire ? C’était super plaisant ! On était déjà en contact avec la plupart d’entre eux, donc ça s'apparente plus à une réunion de famille. C’était un honneur de pouvoir réunir autant de musiciens de talent pour chanter des bêtises.
J’espère que c’est une fausse impression, mais j’ai souvent la sensation que la musique « parodique » ou « comique » est souvent mise à l’écart et même diminuée par l’industrie et les mélomanes, comme s’il n’y avait rien au-delà de la blague. Est-ce quelque chose que vous avez déjà ressenti en tant qu’artistes ? Est-ce qu’on a pu diminuer votre talent en tant que musiciens à cause de ce que vous faites ? On a pu ressentir cela par le passé, mais les temps changent. Les gens pensaient que nous étions de piètres musiciens, mais maintenant ils apprécient le côté fun de notre musique. Et ils ne peuvent alors plus dire que nous sommes de mauvais musiciens parce que ce serait discriminatoire envers tous les musiciens officiant dans ce genre-là ! En mode « quoi, tu trouves notre musique fun mais on est de mauvais musiciens ? Cela n’a aucun de sens si toi tu kiffes ! » Et comme le plus important dans la vie c’est de voir nos opinions validées par les autres, surtout sur les réseaux sociaux, on se dit que le résultat en vaut la chandelle !
…d'accord ! Je n’ai pas tout suivi mais je pense que nous sommes d’accord ! En tout cas c’est une idée d’autant plus idiote quand on réalise à quel point l’album est diversifié et recherché, puisque vous avez mélangé plusieurs styles très différents de musique traditionnelle italienne. Puisque je suppose que vous n’êtes pas de tous les coins d’Italie, comment vous y êtes vous pris pour aligner autant de genres sur un seul album ? Est-ce que vous avez dû apprendre de nouveaux instruments ou de nouvelles techniques ? Oui… on a eu à écouter beaucoup de musique de merde que l’on déteste ! C’était la pire chose de tout le processus créatif !
Une autre couche de difficulté est peut-être venue du Covid aussi, non ? Comment vous y êtes vous pris pendant cette période ? Cela m’a changé en critique très bruyant vis-à-vis des politiques mises en place pendant cette période, notamment en ce qui concerne les confinements… Et sur bases scientifiques hein ? Enfin, mis à part cela, cela nous a surtout permis de donner naissance à plusieurs nouvelles idées débiles…Certaines se retrouvant sur ce nouvel album, et d’autres qui se retrouveront sur le prochain !
Je suis celui qui s’est occupé de chroniquer vos deux derniers albums pour Metal’Art, donc j’ai pu avoir un regard (et une oreille !) rapproché de vos dernières productions. J’ai remarqué que vos deux pochettes sont assez similaires, avec un air de bande dessinée symbolisant l’intégralité des éléments de l’album. Qui s’est occupé de ces artworks et avez-vous un mot d’ordre précis vis-à-vis de ceux-ci ? Les deux pochettes (et la plupart d’entre elles en fait) sont dessinées par notre chanteur, qui est illustrateur professionnel. Il a fait beaucoup de bandes dessinées ! Et c’est devenu notre propre style, notre marque de fabrique.
C’est une question un peu bizarre, surtout avec l’album qui vient de sortir, mais vous pensez qu’on pourrait voir un Volume 2 avec des chansons italiennes plus modernes ? Avec des reprises de groupes de metal italiens par exemple ? Cela pourrait être cool comme ça pourrait ne pas l’être tant que ça. Je crois que ça dépend beaucoup de notre inspiration, si l’on parvient à rassembler suffisamment d’idées pour produire un autre album en italien. Mais si ce n’est pas le cas, alors ça n’arrivera pas, tout simplement.
Enfin, nous avons une diaspora italienne assez importante en Belgique, notamment suite au passé que nous avons en commun. Est-ce qu’un nouveau concert chez nous est éventuellement prévu bientôt ? Avez-vous quelque chose à dire à vos fans belges ? On adore le Manneken Pis, nous pensons qu’il s’agit du monument ultime, le meilleur de tous les temps ! On adorerait revenir chez vous, je pense que notre dernier concert doit remonter à 2009 ! Et pour les fans, je ne dirai qu’une chose : « Bilbo Baggins Carabiniere ! » [sic]
Merci à Danai pour l’aide précieuse apportée à la réalisation de cette interview !

ÜLTRA RAPTÖR - "Tyrants"
Après un premier EP qui m’était totalement inconnu, Ültra Raptör revient avec son premier vrai album qui propose plus de … tout en fait. Plus fou, plus beau, plus épique, plus déconneur. Avec un nom pareil, on s’attendait déjà à un délire assumé, tandis que la pochette (nettement plus belle que celle de l’EP éponyme, il faut bien le dire) donne le ton : ce sera de la bonne grosse référence à la pop-culture des années 80 comme elle a été mille fois parodiée au cours de la dernière décennie. Il n’y a rien de plus cool que des cyber-dinosaures, si ce n’est des guerrières peu vêtues et les vaisseaux spatiaux. Au risque de vous spoiler encore plus, les titres se présentent à peu près comme suit : « Cybörg-Rex », « Nightslasher », ou encore « Caustic Shower ». Autant de combinaisons de mots des plus évocateurs, façonnant immédiatement une image mentale forte à celui qui s’apprête à les découvrir.
Pour autant, ce « Tyrants » m’a surpris par ce processus que j’ai tendance à appeler « l’élastique », qui est une variante de la trajectoire « en cloche » : dans ce dernier cas, la sauce grimpe progressivement jusqu’à culminer pour ensuite doucement redescendre. Dans le cas de l’élastique, cela signifie plutôt que le début de l’album m’a un peu ennuyé. Certes, c’est de la grosse réf’ présentée comme telle. OK, ça va très vite et ça pète de partout. OK, ça joue un peu plus dans la cour du speed/power que du speed/heavy à la Judas Priest (époque Painkiller), et ça confère un aspect épique à la moindre ânerie que pourrait balancer le chanteur. Mais il faut bien le dire… Même si c’est bon délire et pêchu, cela manque d’un petit je-ne-sais-quoi pour que vraiment les morceaux nous accrochent. C’est marrant tout en étant bon. C’est bien foutu tout en étant drôle… Alors qu’est-ce qui dérange ?
Et bam ! «Gale Runner» se met à jouer et là, l’élastique part ! On croirait que le niveau final ou qu’une boss fight s’est enclenchée. Le chant de Phil T. Lung paraît soudainement un brin plus grave, un peu plus éraillé, et son refrain semble parler non plus d’un supervilain comme sur «Nightslasher» mais au contraire plutôt d’un anti-héros sorti de l’imaginaire détraqué d’un dessinateur anglais des 90s. Au côté épique et fou-fou se rajoute des éléments plus incisifs, un ensemble plus lourd. Le heavy tant promis ? Peut-être ! La guitare semble « moins propre » et plus audacieuse. Même chose sur le titre qui suit : « The Quest for Relics », qui semble presque former un diptyque. Une guitare plus crasseuse encore, un rythme toujours plus fou…Il passe enfin le nitro pour continuer leur course ! La guitare de «Winds of Vengeance» fait presque orientale, tandis que le chant prend presque des airs d’opéra. Son bridge, plus long que les autres, fait aussi belle figure. « Caustic Shower » devient pratiquement Thrash ! C’est furieux, inarrêtable. On attend fébrilement que le dixième et dernier titre se lance, sans trop savoir à quoi nous attendre. Malheureusement, il peine à aller encore un cran au-dessus dans le registre de la surenchère… Il revient même un peu à ce côté un peu ringard, mais touchant d’adulescence du début de l’album : c’est là où l’élastique pète. Mais pas sans avoir encore quelques belles vocalises et un chouette bridge passant un peu par toutes les émotions. De la cavalcade de riffs survoltés à une rythmique plus doucerette et annonciatrice de la fin approchante. Il ne rehausse pas le niveau, certes… Et peut-être fait-il bien pour ne pas nous laisser sur notre faim avec un plaisir à son apex sans possibilité de retrouver ses esprits. En tout cas, il reste sympa ce Spacefighter, on espère qu’il reviendra dans notre système solaire.
Alors oui, toute cette review se base beaucoup sur le ressenti. Sans doute plus encore que d’habitude alors que c’est déjà le cœur de mon style de chronique, la technique me faisant parfois défaut. Mais qu’on se le dise : les québécois nous proposent bien davantage qu’une blague ou un énième hommage. L’album met un peu de temps à démarrer, mais il ne nous lâche plus du tout dans sa seconde moitié, et ça laisse déjà présager de belles choses. Et venant de quelqu’un qui en a un peu sa dose… Cela devrait vous donner matière à creuser ! Poussez le délire encore plus loin les gars : même humour, avec plus de férocité encore… Cela ne peut que donner des merveilles.
THE LUCID FURS - "Damn ! That was easy"
Argonauta prouve encore son talent inégalable pour dénicher des vraies petites perles. Le label s’écarte pourtant de son catalogue usuel, fait de sludge, de doom et de stoner pour nous présenter un projet blues bien groovy qui n’a pas peur non plus de faire grimper les décibels. Rien que les trois premiers titres, en plus de débuter l’album avec fracas, se montrent plutôt variés et aptes à faire une première bonne impression réussie. « Right On My Level » propose une guitare bondissante, qui vient nous caresser l’échine entre les puissants refrains. « Five Finger Disco » met davantage en avant la batterie et la basse pour nous faire rouler des épaules, avec un chorus lui aussi très efficace. Certainement mon titre préféré de l’album. « Explain » est plus doux, presque langoureux même. On croirait presque voir apparaître un nuage de fumée de cigares et quelques verres de whisky oubliés sur une table défraîchie… au moins jusqu’à la seconde moitié du morceau, où la chanteuse explose, comme incapable de préserver sa façade plus longtemps ! On ne va pas tous les faire, mais citons aussi brièvement « A One Time Investment », aux percussions plus minimalistes (pour ne pas dire tribales). Ou encore « Another Page », dans la lignée « d’Explain » au niveau de l’ambiance… mais qui réussit à ne pas nous lasser malgré des ficelles très similaires. Son bridge phénoménal vient sans doute nous préserver d’une totale redite, et rend le titre presque plus marquant que son grand frère. Est-ce parce que le monde du blues m’est moins familier que celui du hard rock que je me montre plus clément ? Ou bien est-ce parce que les Lucid Furs ont vraiment frappé une corde sensible, une sensation simple de morceau bien fichu et qu’il est agréable d’écouter tout en ayant une bonne dose de peps ? À vous de me le dire ! En tout cas ici, c’est totalement approuvé.
SCHATTENMANN - "Chaos"
La NDH est un cas d’étude intrigant. Prenant le monde par surprise lors de la seconde moitié des 90s, elle semble patauger dans la semoule depuis le nouveau millénaire, y compris chez les pontes du genre que sont Rammstein et Oomph ! Non pas que le succès n’y soit plus, loin de là, mais la forme est bien différente, donnant plus souvent son sens au titre alternatif de «Tanz/Dance Metal» et moins à ses racines indus plus froides et mécaniques, martiales et sexuellement brutales. Très grossièrement, on pourrait scinder ça en « école de Die Krupps » et « école de KMFDM », encore que cela serait fort réducteur. Mais bref, la scène se cannibalise pas mal, devient même consanguine à force de se concentrer en terres germaniques (sauf rares exceptions) et il faut bien le dire : ça fait longtemps qu’on n’a plus eu de grosse onde de choc dans ce bazar. Et ce troisième Schattenmann reprend peu ou prou la même formule que le précédent. La mauvaise foi nous ferait sourire de voir des titres intitulés « Spring » et « Jetzt Oder Nie », ajoutant encore un peu de crédit à l’idée que le genre copule avec ses cousins. Mais plus sérieusement, il est loin le temps où le genre faisait encore peur et se montrait audacieux dans ses sonorités. Mais dire que « Chaos » est à jeter serait injuste. Le titre éponyme est par exemple une bouffée d’air frais, presque un hymne pop-punk en fait ! «Alles Auf Anfang» possède un côté plus épique presque heavy (notamment par son bridge) , tandis que «Extrem» est simple et efficace, avec un refrain à l’efficacité agaçante. À défaut de sauver la NDH, Chaos se sauve lui-même. L’album est généreux et sans réelle fausse note, si ce n’est un manque de riffs vraiment marquants. Le chant, ainsi qu’une bonne énergie viennent compenser un album un peu lisse.
B-SQUADRON - "Everything You Hate"
L’album commence un peu à plat cependant, avec deux titres certes funky mais dont les instruments manquent de peps. Est-ce une façon de rendre hommage à la qualité d’enregistrement de l’époque ? Aucune idée, mais c’est un rien dommage. Heureusement, la pure vélocité de «Small Circles» et «1982» viennent dissiper nos peurs ! Et après ça, ça y est : le groupe est parti, la disto nous accompagne de même qu’une batterie aussi simple qu’efficace. La voix, pas tellement mélodieuse, mais parfaitement adaptée au genre avec ses relents british bien marqués, rajoute encore de la crédibilité à l’ensemble. Le tout manque un peu de folie, de moments où tout part dans tous les sens… En fait, leur musique est très épurée, très primale. On est dans du punk sans artifices et totalement honnête. C’est plus à l’ancienne qu’à l’ancienne, et ça plaira sûrement aux fans des premières scènes du genre. À titre personnel, j’apprécie davantage le punk lorsqu’il se lâche encore un cran en plus, musicalement j’entends. Ici, même si « 6644 » et « LNCCBB » continuent sur une trajectoire énergétiquement revendicative, ça manque un peu de force et de créativité. Un trait qui empoisonne décidément tout l’album. Il s’adresse donc vraiment aux plus vieux crêteux, ou ceux appréciant leur punk allant le plus droit au but possible. Et ce n’est déjà pas si mal d’être si trompeur ! B-Squadron se place comme une vraie capsule temporelle.