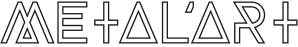Chroniques (703)
Cher lecteur, je me dois de te conter une histoire, celle de la découverte de l’album dont je m’apprête à te parler et de la bêtise que j’ai failli faire après seulement 2 titres en ayant l’intention de lui octroyer une note en dessous de la moyenne. Mais les découvertes musicales étant ce qu’elles sont, toi comme moi savons que la surprise peut surgir de partout pour autant qu’on soit ouvert et qu’on ait la faculté de reconsidérer ses avis primaires qui manquent souvent du recul nécessaire. Et c’est justement ce qui est arrivé ici avec ce premier opus des Allemands de The Alligator Wine. Ce jeune groupe, créé en 2016, a la particularité d’être un duo formé d’un batteur et d’un claviériste qui se partagent également les voix. Oui, tu as bien lu, batterie et clavier uniquement. Ce qui veut dire pas de guitare ni de basse (un clavier Moog Bass se charge des fréquences graves si tu veux tout savoir) donc des manquements béants pour un groupe présenté comme rock psychédélique. Et c’est peut-être là qu’a résidé ma première erreur, m’attendre à un énième ersatz de tout ce qui a pu être proposé ces dernières années en matière de groupes se disant grandement influencés par les 70’s. C’est ainsi que durant les premières minutes d’écoute, la sauce ne prend pas et un faux sentiment de lassitude me gagne, sentiment agrémenté d’une impression de prétention de la part des musiciens, seconde erreur de ma part puisque The Alligator Wine ne fait que jouer avec les ingrédients du passé, mais aussi du présent (pop rock, voire electro, pour l’accroche) histoire de proposer sa propre recette. Me voilà donc petit à petit en train d’apprivoiser ce « Demons Of The Mind » qui m’apparait finalement comme une découverte tout à fait surprenante tant l’originalité et le talent transpirent des neuf morceaux qui le composent. Le groupe se dit influencé autant par le rock que par les musiques de film et cela se traduit par un sens de la mélodie et de l’atmosphère assez bluffante sur l’ensemble de l’album qui compte aussi bien des morceaux groovy (« Shotgun », « The Flying Carousel »…) que mélancoliques (le très beau « Lorane » et ses nappes à la Zack Hemsey). Repéré rapidement par la grosse écurie Century Media après seulement un EP 2018, le duo frappe un grand coup avec ce premier album à côté duquel, cher lecteur, j’ai failli passer. Il fallait donc que je t’en parle.
Ce quintet nous fait découvrir un metal qui inclut des touches « contemporaines » dans leur musique : des notes instrumentales électroniques çà et là. Bien que l’on puisse distinguer les sources d’inspiration du groupe (Korn, Distrubed, Faith No More, Slipknot, Thy Art is Murder), ce n’est pas pour autant du plagiat forcené. Lumière sur ce troisième titre ; « Wasting my time » qui se distingue des deux premiers par son originalité : par exemple, lorsque le morceau touche à sa fin, on peut nettement entendre une mélodie de boîte à musique - ce qui, entendons-nous bien- est très audacieux dans un album de metal. Quant à la cinquième chanson, chantée par Alexander Soules (chanteur du groupe) et Anneke van Giersbergen (chanteuse de « Agua de Annique » et anciennement de « The Gathering » en guest), est assez décevante par sa platitude, malgré que les deux voix s’accordent harmonieusement. Heureusement, la chanson suivante vient totalement contrecarrer le titre précédent : en effet, « Treat me bad » is a blast. Étant sans doute la perle rare de cet album malgré moi, elle se démarque de par la construction instrumentale principalement (riffs de guitare, basse et batterie puissante), mais aussi vocale (moments de scream & solos plus calmes). Scarlean, en bref, ce sont des morceaux assez obscurs, voire parfois nostalgiques, tout en étant énergiques à souhait. Sans oublier comme cerise sur le gâteau, l’excellence maîtrise technique du chant et des instruments.
Amateurs de mélopées, vous pouvez allègrement passer votre chemin puisqu’il n’en sera aucunement question dans ces lignes. En effet les chefs de file canadiens du war black metal sont de retour et les concessions ne semblent toujours pas figurer dans leur agenda. L’auditeur se trouve toujours pris en tenaille dans une mixture alliant black et death outrageusement chaotiques et quelque peu désaccordés relevée d’une bonne rasade grind en matière de voix tantôt hurlées tantôt pitchées. Revenge reste le groupe qui saura accompagner vos moissons de champs de crânes en char d’assaut et n’a pas encore décidé de changer son lance-roquettes d’épaule si ce n’est au niveau de la production qui permet maintenant de distinguer davantage les riffs qui, auparavant, n’avaient tendance à rester qu’au stade de bouillie inintelligible. Tout ça ne veut bien sûr pas dire que le groupe a répondu aux sirènes de l’exécution musicale policée. La seule chose qui lui reste propre est sa démarche hautement respectable et l’intégrité dont il témoigne depuis maintenant 20 ans. Cette nouvelle offrande est sale et méchante, point à la ligne.
Si avec un tel nom vous vous attendiez à du pirate metal, sans doute que le fait que le groupe soit suédois sera un meilleur indice sur la musique qu’ils entendent déployer. En effet, une fois n’est décidément pas coutume, nous voilà encore face à un groupe de hard rock bien cheesy venu de Suède. Mais ce côté kitsch (pleinement assumé, au cas où la Pontiac sur la pochette n’était pas suffisamment équivoque !) en fait sa plus grande force, et catapulte directement Captain Black Beard aux côtés de leurs compatriotes du Night Flight Orchestra. Avec des titres cosmiques, puissants et diablement efficaces pour nous rester dans la tête, la musique du quatuor n’est pas qu’une énième ode à une période passée. Elle ne pioche pas des éléments, visuels comme thématiques, sortis tout droit des 80s. C’est carrément la décennie entière que le groupe étend sur les dix titres, non sans un certain panache… Et non sans pléthore de synthés, de paroles épiques et de titres fleurant bon les teen movies et la SF de cette époque (« Midnight Cruiser »… ça fait déjà voyager avant même de l’écouter, non ?). Alors certes, faudra apprécier le côté un peu niais des jeunes amoureux de « Young Hearts », ou le refrain un peu facile du néanmoins magistral « Disco Volante ». Mais avec une plage tutélaire comme « Sonic Forces », sortie tout droit d’un dessin animé à la « Ulysse 31 » ou « Jayce, conquérant de la lumière »… On leur pardonne tout. On pourra se plaindre que la nostalgie donne une image tronquée de l’époque visée. Mais avec des albums comme ça… Comment avoir envie de sortir de sa Delorean ?
Il existe une forme d’injustice qui condamne certains albums, souvent loin d’être mauvais, mais sortant bien après le magnum opus d’un groupe et faisant donc tomber lesdits albums dans l’oubli… Le dernier album de BÖC en est un triste exemple. Car oui, l’histoire est connue : après des ventes décevantes, le quintet s’est gentiment fait éjecter de son label et n’a plus rien sorti depuis. De quoi percevoir « Curse of the Hidden Mirror » comme l’album de la honte ? Certainement pas… Cette redécouverte presque vingt ans après atteste que le groupe n’était clairement ni en perte de vitesse ni à court d’idées. Les titres groovent sévères et il y a une belle alternance de morceaux plus softs, portés par la voix posée d’Eric Bloom… Et d’autres titres nettement plus hargneux, montrant tout le savoir-faire de Buck Dharma, véritable colosse infatigable et pilier de nombreux titres cultissimes du groupe. Mais là où ça coince, maintenant comme à l’époque, c’est par un manque d’éclat. Un manque de vraies perles. Les titres mythiques du groupe se comptent par dizaines : Buck’s Boogie, Astronomy ou Sinful Love (pour éviter sciemment les plus évidents). Mais ici, aucun ne se démarque réellement, malgré le talent de l’écrivain John Shirley (déjà présent sur l’album « Heaven’s Forbid ») et dont les thématiques s’imbriquent parfaitement avec celles du groupe. Pourtant, les chansons « The Old Gods Return », « Stone of Love » ou « Eye of the Hurricane » ne feraient pas tache au milieu d’une bonne playlist. Tout comme l’album mérite amplement de faire partie de la riche discographie du groupe. Simplement, il est rare pour un artiste de finir mieux qu’il n’a commencé. Et déjà à l’époque, la formule classique du BÖC se faisait quelque peu vieillissante. Efficace, mais doucement éculée. Doit-on craindre l’album à venir cette année ? Rien n’est moins sûr, au contraire ! Ce retour, presque inespéré, ne peut que nous faire espérer le meilleur. Un ultime feu d’artifice de l’un des plus grands groupes du genre. Et cette ressortie de leur dernier né, boudé et mal-aimé, n’est qu’une occasion supplémentaire de redécouvrir un album loin d’être dénué d’intérêt. Dernier petit reproche : on aurait peut-être aimé un ou deux petits bonus en l’honneur de cette ressortie. Mais tant pis… Le fait d’expérimenter onze titres, sans doute pour la première fois pour la plupart, est déjà un beau cadeau en soi.
Nouvel album live pour les vétérans de Blue Öyster Cult, et quel concert ça devait être ! En plus d’avoir une qualité impeccable, la setlist est des plus alléchantes… tant pour les petits nouveaux que pour les aficionados ne parvenant toujours pas à se lasser de « Don’t Fear The Reaper » (peut-être dans l’une de ses meilleures versions ici d’ailleurs). En effet, on y retrouve des titres moins cultes, mais tout aussi bons comme « The Vigil » sorti sur l’album Mirrors (en 1979 tout de même !) ou le plus doux et onirique « Shooting Shark » et son synthé langoureux ! Non, les titres les plus porteurs se retrouvent à la toute fin, avec bien sûr « Godzilla », ou le mythique et cosmique « Black Blade », injustement boudé à sa sortie en 1980 et depuis l’un des immanquables de la formation. Mais n’attendez pas de ce modeste onze-titres un goût d’inachevé ou une sensation de trop peu. Que du contraire, dans la plus pure tradition d’alors, la vaste majorité des morceaux se permettent dans leur seconde moitié de groover sévère, remisant les paroles pour une démonstration de force entre les différents zickos. Un classique du hard rock de l’époque, qui se retrouve toujours sur les albums ? Oui… Mais pas que ! « Cities On Flame With Rock And Roll » se garnit ainsi de près de 2,30 minutes en plus ! Idem pour « Don’t Fear The Reaper » et ses deux minutes d’outro supplémentaires… et une plus sage demie-minute pour « Golden Age of Leather ». Et c’est peut-être ce qui sépare le mieux cet album d’un simple énième best of du groupe : rien ne fait plus plaisir que voir des rockeurs ayant déjà tout fait, se permettre d’encore se surpasser. Et voir leur personnalité transparaître entre chaque titre est également une friandise fort appréciable. Vous savez à quoi vous attendre… Et c’est exactement pour ça que cet opus en vaut, une fois de plus, pleinement le coup !
C’est dans un univers dérangé et dérangeant que nous convie Gabriel Palacio, cerveau du projet floridien Antimozdebeast. Et une chose est sûre à propos de lui lorsqu’on effectue quelques recherches, c’est que le bougre ne chôme pas puisque « The Red River » représente ni plus ni moins que sa troisième sortie sur Bandcamp rien qu’en 2020 et sa quatrième depuis mai 2019. Mais il ne s’arrête pas là puisqu’à l’heure où nous rédigeons ces lignes, un autre EP a déjà vu le jour sur la célèbre plateforme de streaming. Alors bien sûr, certaines mauvaises langues pourront se dire que sortir de l’électro noise sur le net à un rythme effréné n’est probablement pas compliqué quand on se débrouille un tant soit peu avec ses machines, mais Antimozdebeast fait davantage en instaurant une réelle ambiance par ses « riffs », ses fonds et ses hurlements souvent sursaturés. Nous sommes donc ici au-delà de la simple ponte de morceaux sans intérêt ayant pour simple objectif de remplir un profil sur le net. Il y a de l’idée chez cet artiste bercé aux Nine Inch Nails, Skinny Puppy et fan de The Body ou encore Author & Punisher. Rien que cela mérite qu’on y jette une oreille, et ce, même si la production ou la finition ne sont pas encore totalement au rendez-vous.
Non seulement l’Écosse est un pays magnifique, mais en plus, dans le monde du black atmosphérique, elle constitue un véritable terreau fertile de groupes ou projets dotés de solides compétences en matière de réalisation musicale. Tout digne amateur de ce courant apprécie certainement Saor, Bròn, Fuath ou encore Falloch. La terre des Scots n’a pas fini de nous livrer ses secrets et un autre projet mérite toute votre attention, c’est celui de Tom Perrett, véritable cheville ouvrière de son entité « Ruadh », comprenez par-là « Rouge », symbolique du sang, mais aussi griffe naturelle celte chez certains chevelus. C’est déjà le second album depuis une récente création de 2 années.
Franchement, cet opus mérite d’être écouté tant l’artiste parvient à nous placer dans une légèreté certaine, nous promenant dans des atmosphères aux superbes mélodies. 4 morceaux sortent véritablement du lot tant leur taille nous amène à les considérer comme de véritables joyaux. Tel est le cas d’« Embers », ouvrant l’opus au pas de course tout en portant une sorte de florilège de sonorités prégnantes. Le chant martial haché garde une marque légèrement Black qui est dominée par la lumière qui se dégage des mélodies plutôt épiques. Toujours dans ce même morceau, à la 4e minute, un tout autre univers lève son fin voile de pureté… et c’est une merveilleuse entrée dans le folk qui nous étreint, non sans une petite pointe de mélancolie pour s’envoler en apothéose dans la 6e minute.
Seconde pépite, « Winter Light » qui explose dans un registre plus orienté dans l’excentricité, mais contrôlée. La dimension Folk est plus vivifiée et votre envol se fera dans avec plus de célérité, mais toujours dans un havre portant assurément des dimensions magiques. Nous sommes plus ici dans une énergie d’ancrage.
Que dire aussi de ces 2 magistrales parties I et II du véritable chef-d’œuvre qu’est « Only Distant Echoes Reign » qui incite au recueillement sous la posture d’une grande humilité. La voix féminine et son chant mi-éthéré renforce davantage le travail d’orfèvrerie musicale.
Le titre éponyme m’a produit une étrange sensation, celle de glisser sur des terres plus mystiques avec des espaces typés « Anathema » et vers la 5e minute, une glissade plus shoegazienne dans l’univers d’Alcest ou des Discrets. Notons qu’il ne s’agit point dans mon esprit d’un reproche quelconque vu que le voyage est assez agréable.
Sur « Fields Of Heather », les riffs de guitare offrent un cadre assez souple, laissant la batterie tracer les balises et les garde-fous de ce superbe morceau qui capte véritablement votre âme. Le chant en voix claire vous immerge dans la méditation.
Au final se second opus montre un solide talent et me conforte dans vision très positive de l’école Black Ecossaise.
Écouter Ruadh, c’est voyager dans un parfait équilibre entre les 5 éléments.
Quelque part en Belgique : « Dis Papa, c’est quoi la différence entre le Death Black et le Black Death ? » - « Hein ! Tu en as d’autres des questions de la sorte ? » - « Non, mais concrètement ? » – « Écoute en gros lorsque la base musicale repose davantage sur le Death et que ce qui est véhiculé provient de l’essence du Black, on dit que c’est du Death Black et lorsque c’est l’inverse, on dit que c’est du Black Death… » — un long silence — « Tu as compris ? » – « Pas vraiment !!! » - il est l’heure d’aller coucher fils – du Death Black c’est Belphegor et du Black Death c’est Belphegor… Bonne nuit !!! »
Plus sérieusement, le groupe sur lequel je devais me pencher alors qu’est apparu le terrible Covid-19 n’aura pas attendu que je libère du temps pour sortir son album. Je ne connaissais pas ce quatuor australien et me suis donc empressé d’aller faire les recherches d’usage pour tenter de prendre meilleure mesure de leur parcours en 7 ans de carrière. Ces briscards en sont déjà à leur 4e opus d’une carrière dédiée au death black. Diantre, je retrouve Jared, ex-bassiste et ex-chanteur d’un groupe de black death symphonique que j’affectionne « Advent Sorrow ». Chez Earth Rot, au diable la basse, il sévit dans le chant. Allez, on teste le produit…
En toute honnêteté, il ne faut pas 5 écoutes pour découvrir la puissance destructrice de ces artistes. C’est une véritable claque. Les titres défilent : « Dread Rebirth », « New Horns », « Towards a Godless Shrine » qui fait penser à de l’Entombed croisant du Gorefest, du Grave avec une touche très core. Le groove n’est pas laissé au placard et l’on peut apprécier la superbe complicité entre le bassiste et le batteur. La rythmique déménage tandis que les riffs perforants de Tom et Colin viennent vous botter les fesses avec une sacrée dose d’énergie. Sur « Unparalleled Gateways To Higher Obliteration », on peut savourer une approche plus mordante tant dans le chant que dans l’architecture acérée du morceau. Là, ça fait plus mal que les excellents Vital Remains. Des fibres plus black, je les trouve dans l’essence du très engagé « Ancestral Vengeance » qui garantit un décapage en bonne et due forme. « The Cape Of Storms », confirme la prédominance des notes Death Old School qui sont assez bien maîtrisées techniquement. Le son est propre aussi. Autre belle expérience de déluge sonore sur « Serpent’s Ocean ». Il est très difficile de rester stoïque sur cette ode virulente. « Mind Killer » vous donne la clé sur les intentions réelles de ces musicos, simplement vous éclater les neurones. Earth Rot est excellent dans ce registre plus brutal. La galette se ferme sur un surprenant très bluesy « Out In The Cold » qui suinte les fragrances australiennes à plein nez. Non, nous ne perdons pas notre esprit dans cette immersion de leur univers très typé et le pire, c’est que ces bougres sont doués et qu’ils peuvent accrocher un large auditoire musical par leur capacité syncrétique à brasser les sous-genres.
« Gamin, descends, un exemple pour te faire comprendre la différence entre le death black et le black death…viens écouter Earth Rot, tu vois, ça, c’est du bon Death Black »… « Ha oui, comme Belphegor ? » « Rooh, t’as rien compris gamin, retourne te coucher ».
Dans le monde très germano-américain de l’indus’, Turmion Kätilöt fait presque office de curiosité. Vocals en finnois, volontiers expérimentateurs dans leurs sonorités et proposant des tempos plus rapides que leurs homologues aux thèmes plus martiaux ou plus sombres… ce qui n’empêche pas le groupe de déployer une esthétique et des thématiques bien trash, bien sûr. Plutôt productifs (on parle de six albums en dix ans quand même !) et avant-gardiste, on a l’impression d’avoir un TK un brin moins vénère et péchu, mais beaucoup plus lourd. Le plus gros reproche que l’on puisse faire, c’est de n’avoir qu’assez peu de titres marquants, malgré leurs excentricités. Oui, l’intro sur un air de tango de « Mosquito à la carte » est sympa, mais le reste du morceau est plutôt classique. Oui, le hook sur « Ikävä » est diablement efficace, mais cela ne fait pas tout. À titre personnel, seul le single « Kyntövuohi » est parvenu à capter l’attention, et à s’insérer profondément parmi les classiques du groupe. Un album médiocre donc ? Pas du tout, simplement un opus moins incontournable. Mais il plaira assurément aux amoureux du groupe autant que d’indus. Ils y retrouveront tout ce qui fait le sel du groupe.
Plus...
Depuis ses débuts, Pyrrhon a bien fait comprendre qu’il n’était pas le genre de groupe à entrer dans le moule et ce n’est certainement pas ce quatrième opus qui changera la donne tant ce dernier n’est pas à mettre entre toutes les oreilles. Bien loin d’une démarche musicale élitiste, le quatuor de Brooklyn continue son bonhomme de chemin à travers ses expérimentations (improvisations ?) dédiées à un death metal noisy hyper technique et lourd à souhait l’amenant même parfois vers des mesures à la limite de la cacophonie. Amateurs de prouesses techniques, « Abscess Time » saura sans doute vous ravir pour autant que vous vous y prépariez, car ne croyez pas être ici face à un brutal death à la Obscura ou Abysmal Dawn où chaque note pourrait être décortiquée tant la production est propre. Non, Pyrrhon choisit clairement son camp et officie dans un registre bien plus cru et old school au niveau du son, bien plus proche d’un Immolation des débuts. Un album pour musiciens diront sans doute certains. Nous pencherons plus ici pour une œuvre à la démarche artistique honnête. Un véritable ovni confectionné avec les tripes. Toutefois, même si la prise de risque fait l’objet d’une certaine admiration de la part de votre serviteur, celui-ci ne saura pas nier la difficulté d’entrer véritablement dans le délire et ce à cause du manque d’accroche dont « Abscess Time » lui a semblé faire preuve.
Déjà actifs lors de l’âge d’or du Thrash dans les 80s, les Suisses de Poltergeist cultivent un curieux mélange de Thrash et de Power, avec éventuellement quelques relents Heavy proposés dans le lot. En ce sens, on pourrait être amusé de voir sur un même opus un titre nommé « The Godz of Seven Rays » et un autre au sobriquet quasi-Glam « Saturday Night’s Allright for Rockin’ ». Ne vous y méprenez pas cependant : l’album traite davantage de concepts et de mythes que de guerre ou de problèmes sociétaux… Sans s’enfoncer pieds joints dans le lyrisme mythologique si cher au power (et contrairement à ce que la jaquette laisserait croire… quoiqu’on ne cracherait pas sur un album-concept sur l’Égypte Antique). Quoiqu’il en soit, Poltergeist déploie une solide charpente thrashy sur l’ensemble des titres qui, bien que solide et ayant fait ses preuves, nous laisse un peu sur notre faim. Nous dirons qu’elle manque de fulgurances plus que d’efficacité. On aurait aimé plus de riffs distordus, des bridges plus longs ou un chant plus énervé. Quelque chose de peut-être un peu moins pris dans un étau en somme ! Car malgré des chorus aussi simplistes qu’efficaces (« Ambush » ou « Megalomaniac » surtout, reposant pratiquement sur un seul mot… mais qu’on crie volontiers en même temps que A.Grieder !), toute la partie instrumentale est bien… Sans plus. Mais après une sacrée période creuse d’une vingtaine d’années, ça fait plaisir de voir Poltergeist revenir avec plus qu’une série de concerts sous le coude. Pas un mais bien DEUX albums après vingt ans…cela mérite qu’on y tende une oreille !
Onirique, cosmique, d’un autre monde… Peu importe le qualificatif, cet album de Plight Radio fait voyager. Et pas du tout dans le registre trippant, mais bien relaxant et doux. Tout en ne manquant pourtant pas d’énergie, surtout sur les fins de morceaux… Toujours en apothéose ! Chaque titre est également très coloré, malgré une totale absence de vocals sur chacune des cinq chansons qui composent ce premier opus. En effet, ne vous laissez pas méprendre par ce cinq-titres : d’une durée de six à huit minutes, les chansons au nom doucement poétique (« Rising Wind », « Astronomical Horizon » ) ont pleinement le temps de déployer leurs meilleurs et nombreux atouts. Que ce soit la boucle hypnotisante nous suivant tout du long sur « Rising Wind » ou la progression magistrale sur « Eleonora » : on a un rythme tribal qui échange sa place par une cavalcade de percus puissantes contrastées par une guitare très tendre, pour finir avec force et fracas ! Tandis que « Olimpia » est un semi-retour au calme… en demi-teinte seulement, puisqu’encore une fois la seconde moitié du titre ne manque pas de peps et de nuances pour nous transporter dans des dimensions astrales ! Clairement une excellente surprise, sur laquelle vous pouvez vous jeter immédiatement… L’album vient de sortir !
Ce groupe, maîtrisant dignement toutes les cordes à son arc, est originaire de Cleveland. Ses membres sont présents sur la scène depuis 1993, nous en met plein la vue durant ses shows en mêlant art et hard rock, d’une part par la recherche artistique, et d’autre part par cette théâtralité bien à eux. Au niveau des compositions musicales, nous nous trouvons dans un majestueux croisement : chant jonglant entre death et grind, instrumentaux heavy et mélodiques, scansion rap, claviers ambiants inspirés du gothique, et samples rythmiques penchant vers l’indus. Dans le champ lexical des paroles, la mort, les guerres et la religion sont souvent évoquées, ce qui apporte une intrigue indéniable. Ce 8e album de Mushroomhead débute avec « A Requiem For Tomorrow », sublime entrée en matière mise en lumière par ce chant de chorale mélodique a capella. Il introduit la suite du morceau, qui se transforme en metal alternatif poignant. Je vous propose désormais de nous attarder sur « Heresy », chanson encore une fois très réussie où il est sujet notamment d’une guerre qui se prépare, de Poséidon (étant le dieu de la mer dans la mythologie grecque), de marée et d’avenir. Personnellement, j’ai jeté mon dévolu sur le 6e track de l’album, « Pulse ». Mystérieuse et envoûtante, la voix de Jackie aka Ms. Jackie (une des vocalistes) nous berce pendant l’introduction du morceau accompagnée d’un piano durant les premiers instants. Le groupe a cette délicieuse habitude de démarrer ses chansons en douceur par le biais de mélodies intrigantes, pour ensuite nous déverser un flot de jolie violence musicale.